02/11/2010
Jocelyne François
Bloc-Notes, 2 novembre / Les Saules

Il arrive que nous oubliions certains êtres parmi ceux qui nous ont été proches. Personne ne sait d'où vient l'oubli. Je n'ai pas oublié René Char. N'avais-je pas écrit à la fin de mon roman "Les Amantes ou tombeau de C": "et que je meure si je l'oublie"? Je suis vivante. Il me reste peu de temps, sept ans seulement, pour atteindre l'âge qu'il avait à sa mort. Ce n'est pas considérable et je vois plus clairement ce que signifient les dernières années d'une vie.
Ainsi commence ce court récit, consacré à sa rencontre avec René Char, par le lien de la poésie - cette fragile, forte et inexplicable passerelle. De ces années passées à Saumane-de-Vaucluse avec son amie Marie-Claire Pichaud et sa fille Dominique, non loin de L’Isle-sur-la-Sorgue - où résidait le poète - Jocelyne François parle avec beaucoup de pudeur, de délicatesse et de clairvoyance de son amitié avec René Char, qui fut immédiate. En lui, elle loua la simplicité, la justesse, la générosité, le naturel; de même l'expression de son visage, son regard, ses mains, sa voix.
Sa pièce de travail, assez petite, abritait une grande table presque entièrement couverte de papiers, de livres, de documents, de courrier reçu ou en partance, mais toujours avec une place vide pour une ou quelques fleurs. Sa bibliothèque tenait dans un meuble modeste où tout était visible, mais par une discrétion qui m'est naturelle envers toutes les bibliothèques, je ne m'en approchais jamais. (...) Le plus souvent nous parlions l'un en face de l'autre, lui derrière sa table et moi assise en biais devant la cheminée, mais parfois il se levait et venait s'asseoir auprès de moi. Lorsqu'il allait chercher un livre pour m'en lire un passage, il se tenait debout contre un angle de la table.
Leurs échanges, qui durèrent huit ans, ressemblaient à un très bon vin que l'on ne se dépêche pas de boire et sur lesquels l'âge ne pèse pas. Puis un jour, peu après le décès de sa soeur préférée, Julia, René Char tenta de transgresser leur belle amitié, et ce fut la fin. Je ne reviendrai plus...
Demeure, au fil du temps, ce chant de reconnaissance qui ne guérit pas les intimes blessures mais s'élance pourtant vers le ciel, pour cette confiance réciproque qui lui permit de grandir et tout dire, pour la préexistence que permet l'écriture, pour le mouvement assuré de leur rencontre, ce signe étrange venu de très loin et qui conduit à la clarté.
Deux passages bouleversants illuminent ces pages d'une sensibilité et d'une douceur à fleur de peau: J'écris à l'orbe de la mort, où Jocelyne François parle du décès de sa fille Dominique, ainsi que Trente ans déjà, poème dédié à René Char, à titre posthume.
Jocelyne François a publié plusieurs romans, parmi lesquels Les bonheurs(1970), Les amantes ou tombeau de C (1978 et 1998), Joue-nous Espana (1980 - prix Femina), tous parus aux éditions du Mercure de France et en coll. Folio/Gallimard. Avec Signes d'air (1982), elle se consacre à la poésie : un magnifique recueil qui n'est pas sans rappeler l'univers de René Char - recommandé! - auprès du même éditeur. Enfin, son Journal, constitué à ce jour de trois volumes - Le cahier vert, Une vie d'écrivain et Le solstice d'hiver - couvrant la période 1961 à 2007 mériterait certainement mieux que le timide accueil qui lui fut réservé.
Jocelyne François, René Char - Vie et mort d'une amitié (La Différence, 2010)
03:47 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Jocelyne François, Littérature francophone, René Char | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature; essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2010
Propos sur le bonheur
Bloc-Notes, 28 octobre / Les Saules

Le bonheur, c'est un peu comme la communication en entreprise: plus on en parle et plus on s'en éloigne! Au point que ces deux thèmes très représentatifs de notre société - de ses interrogations, de ses doutes, de ses appréhensions - sont devenus l'objet de toutes les convoitises: on voudrait pouvoir acheter les réponses à ce désarroi des temps modernes - qui passe souvent par les livres - comme on irait chez le boulanger pour résoudre le problème de la faim ou dans les salons pour venir à bout de celui de la solitude. Une quête de satisfaction, en somme, plutôt qu'une volonté de bonheur...
Pourtant, l'homme - vous, moi, tous les autres - change si peu au fil des siècles. Il suffit de relire la Bible, Platon, les Stoïciens, Pascal et tous les anciens pour s'en convaincre. Plus près de nous, prenez Alain - de son vrai nom Emile-Auguste Chartier - philosophe et professeur, contemporain de Paul Valéry: entre 1925 et 1928, il publie ses Propos sur le bonheur. Pas de recettes universelles, de méthodes prétendues infaillibles, de vérités opposées au mensonge comme on tend à le démontrer si souvent de nos jours. Par des approches variées, sur le mode d'une conversation entre amis, il ouvre des voies, réduit notre cécité, prodigue çà et là quelques conseils non dépourvus d'humour, sans démagogie ni suffisance. Il s'adresse à l'homme qui ne sait pas: celui qui hésite, celui qui cherche, laissant à d'autres, heureusement, le mirage des certitudes en toutes choses.
Chacun peut y trouver matière à sa réflexion personnelle: qu'il s'agisse de la mélancolie - on prend son chagrin comme un mal de ventre -, de la volonté - ne regardez pas au-delà de vos mains -, de la passion - cette activité physique qui nous échappe -, des voyages - ne pas s'endormir dans la coutume -, de la destinée - cette puissance intérieure qui finit par trouver passage -, de l'avenir - jeter du lest et se laisser porter au vent -, de la mort - l'imaginaire toujours est notre ennemi -, thèmes choisis parmi une centaine de chapitres courts consacrés à bien d'autres domaines encore et qui, ensemble comme dans un kaléidoscope aux couleurs inestimables saisies dans un rais de lumière, donnent un sens à la vie.
Le point commun de ces Propos sur le bonheur? L'action, toujours, exprimée par la bienveillance, le sourire ou la générosité: Dans cet art d'être heureux, auquel je pense, je mettrais d'utiles conseils sur l'usage du mauvais temps. Au moment où j'écris, la pluie tombe; les tuiles sonnent; mille petites rigoles bavardent; l'air est lavé et comme filtré; les nuées ressemblent à des haillons magnifiques. Il faut apprendre à saisir ces beautés-là. Mais, dit l'un, la pluie gâte les moissons. Et l'autre: la boue salit tout. Et un troisième: il est si bon de s'asseoir dans l'herbe. C'est entendu; on le sait; vos plaintes n'y retranchent rien, et je reçois une pluie de plaintes qui me poursuit dans la maison. Eh bien, c'est surtout en temps de pluie, que l'on veut des visages gais. Donc, bonne figure à mauvais temps.
Le bonheur serait-il, finalement, plus simple que nous le pensons, semblable à un feu qui n'attend qu'un allumette - la nôtre et non celle des autres - pour s'épanouir dans la cheminée et réchauffer toute la maison? Alain nous montre le chemin: Ne laisse pas ton bois pourrir dans ta cave...
Alain, Propos sur le bonheur (coll. Folio Essais/Gallimard, 2000)
00:07 Écrit par Claude Amstutz dans Alain, Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature: essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2010
Jean-Michel Maulpoix
Bloc-Notes, 24 octobre / Les Saules

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jean-Michel Maulpoix est l'auteur d'ouvrages poétiques, parmi lesquels Une histoire de bleu, L'instinct de ciel, Boulevard des capucines, et Pas sur la neige, publiés aux éditions du Mercure de France. Il a également consacré des études critiques à Henri Michaux, Jacques Réda et René Char.
Il nous revient aujourd'hui avec un récit aussi poétique qu'une empreinte de pas dans la neige, Journal d'un enfant sage. Il y donne la parole à Louis, son fils, âgé de trois ans. Et nous voilà transportés, comme par enchantement, dans le monde féerique de l'enfance, terrain fertile et propice aux observations des grandes personnes, ainsi que témoignage de l'amour infini d'un père envers son fils. N'ayant pas atteint l'âge de la majorité, je confie à mon père, qui a déjà fait paraître un certain nombre de livres, le soin de signer ce volume. Je sais qu'il ne manquera pas de corriger certaines étourderies et qu'il saura se garder de trop mêler sa voix à la mienne.
Dans le premier cahier, Louis tient un journal intitulé Le cahier de Louis, dans lequel il nous confie ses impressions sur l'âge, le temps, l'écriture, la famille. Les pages consacrées à son père, empreintes de tendresse et d'admiration, sont extrêmement attachantes: Je vous parlerai de mon père (...) reproduisant ses gestes, ou poursuivant à sa place, la grande et mystérieuse aventure d'écrire, cette étrange affaire d'encre qui commence par tant de tracés hésitants et de lignes brisées. Un peu plus loin, il note: En vérité, il me semble que le bonheur parfois s'étrangle en lui, douloureux comme une lumière trop vive ou un excès de beauté. Peut-être est-il entré dans cet âge où le souvenir de ce qui fut et le regard posé sur ceux qui commencent de vivre tiennent désormais d'aventure. (...) Il est ma force, je suis la sienne. Me voici devenu l'alibi inespéré de son existence. Il n'avait plus de raison d'être. Rien d'autre que poursuivre pour rien, ou en vue d'une "gloire" aussi vague que vaine, cette entreprise d'écrire qui lui avait jusqu'alors tenu lieu de vraie vie.
Le second cahier porte bien son titre: Leçons de choses. Il y consigne ce qu'il a appris sur les merveilles du monde qui l'entoure, voué à aiguiser le regard de ses petits camarades. Là aussi, que de belles images impressionnistes: L'arbre attend que passe un Noël. La neige recouvre ses épaules. Parfois, des aiguilles de pin pendent au bout de ses branches. Il a fermé ses portes et ses volets de liège, calfeutré ses bourgeons. Il s'est endormi, un écureuil et deux hiboux sur le coeur. Ou encore: Les pétales sont les paupières des fleurs. Mais point n'est besoin de les farder, non plus que d'en recourber les cils avec une brosse ou un petit pinceau. Où sont cachés les yeux? Bien malin qui saurait le dire... Sans doute n'en ont-elles qu'un seul où les abeilles viennent se poser. Tantôt jaune, odorant et rond, tantôt si bien dissimulé qu'on ne l'aperçoit plus... De leur oeil immobile, les fleurs à tout jamais cherchent le bleu du ciel...
Le dernier cahier - Proses pour Adrien - est composé de drôles de contes ou fables destinés à son petit frère. Il se fait tard, petit frère. Un bruit et une voix après l'autre, le jour se tait. Les chevaliers ont rentré dans les écuries leurs chevaux. Les princes et les princesses de nos livres d'images vont refermer les yeux. Je range mes contes et mes poèmes. La nuit qui tombe est sans étoiles. Ne crains pas les sorcières de la forêt lointaine: contre ton coeur d'amour, leur pouvoir est sans force. Avec mon bouclier en carton et mon épée, je te protège. Bonne nuit, petit frère.
Une invitation à remonter le temps, à retrouver avec délices ces instants de découverte du monde qui ressemblent - dans notre imaginaire perclus de rhumatismes - aux premières gambades sur le sol lunaire...
Jean-Michel Maulpoix, Journal d'un enfant sage (Mercure de France, 2010)
08:56 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Jean-Michel Maulpoix, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2010
Fatou Diome
Bloc-Notes, 12 octobre / Les Saules

Les conditions de vie difficiles des émigrés dans la clandestinité et l'exil, loin des leurs, ont été souvent abordées en littérature, avec leur cortège d'espoirs, leurs rêves d'eldorados improbables, leurs désillusions au fil du temps qui passe. Les victimes, c'étaient eux, débarqués quelque part au sud de l'Italie ou de l'Espagne. Avec Fatou Diome - et sans atténuer le moins du monde leur chemin de croix - l'originalité du récit de Celles qui attendent tient dans l'évocation de ces femmes qui sont restées au pays. Epouses ou mères, réduites à la dépendance, à l'attente incertaine, au silence, au manque d'amour, à la solitude. Elles portaient jusqu'au fond des pupilles des rêves gelés, des fleurs d'espoir flétries et l'angoisse permanente d'un deuil hypothétique; mais quand le rossignol chante, nul ne se doute du poids de son coeur. Longtemps, leur dignité rendit leur fardeau invisible. Tous les suppliciés ne hurlent pas.
Cela se passe sur l'île de Niodior, au large du Sénégal, où l'auteur a vu le jour. Arame vit aux côtés d'un mari aigri qu'elle ne s'est pas choisi, qui pourrait être son père, dont la déchéance physique augmente encore ses rancoeurs: Figés dans la haine, comme deux prisonniers s'accusant réciproquement du même crime, mais condamnés à partager la même cellule. Son amie Bougna, quant à elle, vit très mal son statut de seconde épouse dont la progéniture ne connaît pas la réussite des enfants de la première. Quand le flacon est brisé, seuls les effluves du parfum demeurent. Maintenant que la deuxième épouse avait perdu les appas de sa jeunesse, le mari comprit très vite que sa première était d'une bien meilleure essence. Son tempérament placide en faisait naturellement un refuge idéal pour un homme vieillissant, fatigué des affres de l'amour.
Elles persuadent leurs fils respectifs, Lamine et Issa, que pour leur propre avenir et celui de leurs familles, il leur faut partir en Europe afin de trouver du travail, gagner de l'argent avant de revenir au pays, la réussite au bout de leurs souliers. Ils accueillirent la proposition des deux femmes comme une libération, car chacun d'eux redoutait le fait d'avoir à annoncer un voyage aussi risqué à sa mère. Soulagés et heureux de se savoir ainsi soutenus, leur futur départ pour l'Europe devint leur seul horizon. Pour une durée indéterminée, ils abandonnent ainsi dans l'île leurs épouses, Coumba et Daba...
Chronique sociale autant que portrait de familles attachant qui cerne avec beaucoup de réalisme et parfois d'humour ce coin de terre voué à l'indigence, Celles qui attendent est aussi un réquisitoire contre les méfaits de la polygamie et autres manifestations d'une société à l'africaine, construite par et pour les hommes. Fatou Diome, au passage, règle aussi quelques comptes avec cet ailleurs où l'herbe paraît si verte et plein d'espoir, alors que sans éducation ni instruction, on n'y est rien du tout. Enfin, elle pointe du doigt une certaine mentalité européenne en mal d'exotisme, compréhensive mais condescendante dont la fille de porcelaine avec laquelle Issa débarque un beau jour dans lîle, est la plus détestable illustration.
Servie par une écriture riche en couleurs qui verse rarement dans l'excès ou la complaisance, Fatou Diome cerne avec ardeur et sincérité ce quotidien des femmes et d'un pays, le Sénégal que, malgré quelques coups de griffes, elle aime tant et lui voudrait une perspective d'avenir plus salutaire.
Fatou Diome, Celles qui attendent (Flammarion, 2010)
04:37 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature: roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2010
Laurent Terzieff 1b
Bloc-Notes, 3 octobre / Les Saules

Voici quelques extraits de Seul avec tous. Il y manque - hélas - la voix, la douceur et la respiration de Laurent Terzieff...
Le passé est un avenir qui n'a pas tenu ses promesses.
*
La condition humaine, c'est de choisir dans l'ignorance, et c'est d'ailleurs ce qui rend possible les valeurs morales. Où serait le courage, où la responsabilité et la solidarité, si tout était clair et déterminé, si on savait ce que nous réserve l'Histoire?
*
Il n'est pas bon pour l'artiste de mettre des barrages, d'être protégé par des certitudes. Bien sûr, tout le monde tend naturellement à la clarté, rêve d'un monde globalement expliqué. Mais on n'a pas les clefs de l'existence. Et l'artiste, comme le savant, progresse en découvrant sans cesse davantage l'étendue de son ignorance.
*
Les loups me passionnent par-dessus tout. Il se dégage d'eux la force de l'indompté. On ne peut rien en faire. C'est ce que j'ai vu de plus sauvage. De plus irréductible.
*
On ne devient pas libre en passant par le compromis.
*
Je refuse de faire partie de la race des seigneurs qui écrase les petits, mais tout autant de la race des signeurs, qui pétitionne à tout va.
*
Je lui dois tout! Mon amour du théâtre, de ce théâtre visionnaire que j'étais fait pour aimer, le respect du texte, l'engagement au service d'auteurs inconnus (...) Je le voyais comme un éternel jeune homme avec une mystique de rebelle. Personne n'a incarné comme lui le refus du compromis. (sur Roger Blin)
*
Aucun ne pousse aussi loin le besoin fou de l'amour, la haine de la contingence, le dégoût et l'éblouissement devant la vie. (sur Oscar Venceslas de Lubicz-Milocz)
*
Il suffit de quelques phrases pour vous réconcilier avec l'humanité. (...) Il n'écrase jamais personne. Un des miracles de Tchehov, c'est de rendre les médiocres fraternels. (sur Anton Tchekhov)
*
Eloquence négative fondée sur l'élimination du sens, la neutralité affective, l'apparente et massive banalité du constat. (...) Une tragédie où il ne se passe rien, où les acteurs n'ont pas appris leur texte, d'ailleurs il n'y a pas de texte. On a planté le décor, le metteur en scène n'est pas venu, ni l'auteur, ni le public. (sur Edward Hopper)
*
Il aura été le dernier pour moi à faire entendre la beauté en tant que produit pur du langage. (...) Il est le seul à me faire poser cette question: La poésie française a-t-elle eu raison d'abandonner la rime? (sur Louis Aragon)
*
Il réunit dans un même amour les forces de conservation et de destruction, tout ce qui illustre le passage de l'homme sur terre: l'ordre, la révolte, le bruit et la fureur, la tendresse et la douceur, la force maîtrisée. (...) Pas un, à mon avis, ne l'égale en France, aucun poète de la scène n'atteint cette luxuriance poétique et son souffle colossal. (sur Paul Claudel)
*
Dans la poésie, l'homme cherche cet autre qui gît dans le coeur de son coeur, plus lui-même que lui, et pourtant inconnu, le moi profond de son être, de son âme humaine, et en même temps tout ce qui vaut la peine de vivre pour lui tend vers un seul but: dépasser les frontières de son moi personnel, crever l'opacité de sa peau qui le sépare du monde.
Laurent Terzieff, Seul avec tous (Presses de la Renaissance, 2010)
11:35 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : auteurs; citations; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
Laurent Terzieff 1a
Bloc-Notes, 3 octobre 2010 / Les Saules

Laurent Terzieff nous a quitté le 2 juillet dernier, à l'âge de 75 ans. Cet être d'exception, révélé au cinéma par Les tricheurs et Tu ne tueras point de Marcel Carné, doit sa célébrité à une vie toute entière vouée au théâtre dont il aimait à dire: L'une des raisons qui me font aimer le théâtre, c'est que, contrairement au cinéma, il ne laisse pas de traces. (...) C'est l'art de l'instant présent, intensément vécu. Et j'aime qu'il ne reste rien de mon travail. Retour au texte pur."
Exigeant, d'une insolente liberté face aux modes et aux courants de son époque, il a crée à la scène ou interprété Sophocle, Pierre Corbeille, Henrik Ibsen, Mikhaïl Boulgakov, Luigi Pirandello, Paul Claudel, Arthur Adamov, Slawomir Mrozek, Eugène O'Neill, John Arden, Edward Albee, James Saunders, Murray Schisgal parmi tant d'autres. Sur la mise en scène - à l'école de Roger Blin - il nous a laissé une très belle réflexion: Je voulais sentir le goût de l'époque et en exprimer la saveur. Participer à cette mutation constante de la vie. Me mettre à l'écoute du monde. En devenir la caisse à résonance.
Toutes ces approches sensibles au service du texte, vous pouvez les retrouver dans le livre Seul avec tous qui s'ouvre avec un émouvant témoignage de Fabrice Luchini et de Marie-Noëlle Tranchant, suivi d'un florilège consacré aux thèmes majeurs de sa quête existentielle. Il y évoque sa jeunesse, son parcours politique, les événements qui ont secoué sa vie - la tragédie algérienne qui l'a transpercé au plus intime, les pages bouleversantes consacrées à sa compagne Pascale de Boysson - assumant ses contradictions avec un rare souci d'honnêteté, sans renier quoi que ce soit de son parcours, comme si chacun de ces repères biographique avait laissé s'épanouir une ride supplémentaire intégrée à sa personnalité, exigeante et douce, dont nous conservons le souvenir.
A Marie-Noëlle Tranchant reviennent les derniers mots de ce discret hommage. Je reprends dans votre dernier récital poétique, Florilège, ces vers d'Aragon qui mènent si bien vers vous: Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre, mon amour.
Sur Dailymotion, vous pouvez retrouver un moment exceptionnel de télévision, sur le plateau d'Apostrophes de Bernard Pivot, où Laurent Terzieff récite un poème inoubliable de Rainer Maria Rilke: Pour écrire un seul vers ...
http://www.dailymotion.com/video/xnet0_pivot-terzieff-recite-rilke_news
Laurent Terzieff, Seul avec tous (Presses de la Renaissance, 2010)
09:45 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone, Rainer-Maria Rilke, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature: essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
30/09/2010
Robert Bober
Bloc-Notes, 30 septembre / Les Saules

Connaissez-vous cet auteur aussi discret que ses personnages, Robert Bober? Il est né à Berlin en 1931 de parents juifs, d'origine polonaise. Fuyant le nazisme, sa famille se réfugie en France. En juillet 1942, prévenus par des amis, ils parviennent à échapper à la rafle du Vel d'Hiv. Quelques années plus tard, il entreprend un apprentissage de tailleur, métier qu'il exercera jusqu'à l'âge de 22 ans, pour se tourner ensuite vers la poterie. Par la suite, il dispense l'été des cours dans des résidences secondaires et mène parallèlement des projets thérapeutiques avec des enfants malades. Il aidera notamment des enfants ayant perdu tout lien social à la suite de la guerre.
Dans les années 50, il rencontre François Truffaut et devient son assistant sur les films Les Quatre Cents Coups, Tirez sur le pianiste et Jules et Jim. En 1967, il réalise son premier documentaire pour la télévision, Cholem Aleichem: un écrivain de langue yiddish. Dans les années 60 et 70, ses documentaires pour la télévision explorent pour l'essentiel la période de l'après-guerre et les conséquences de l'Holocauste.
A partir des années 80, en collaboration avec Pierre Dumayet, il réalise des portraits d'auteurs tels que Paul Valéry, Gustave Flaubert ou encore Georges Perec, avec lequel il était également ami. Son premier roman, Quoi de neuf sur la guerre ? est publié en 1993. L'auteur est alors âgé de soixante ans et reçoit pour ce livre, le Prix du Livre Inter. L'histoire se déroule lors de la première année d'après-guerre et met en scène un atelier de confection pour dames de la rue de Turenne, à Paris. Robert Bober nous raconte, d'un ton en apparence léger, presque réjoui, la manière dont les différents personnages mis en scène ont été épargnés, survivant ainsi à la guerre.
Suit Berg et Beck en 1999 - l'auteur nous y raconte la vie d'enfants juifs après la déportation de leurs parents ainsi que leur survie à la perte de ces êtres chers - et Laissées-pour-compte en 2005, une des créations les plus originales de ces dernières années - sur un thème plus léger que celui des titres précédents - et déjà évoquée dans ces colonnes.
Il nous revient aujourd'hui avec On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux, titre emprunté à l'auteur de La plupart du temps, Pierre Reverdy. Avec son style magique de conteur, il nous entraîne cette fois-ci sur le plateau du tournage de Jules et Jim où le personnage central du roman, Bernard - un double de son ami Robert, à la fois inventé et bien réel - se voit confier un rôle de figurant. Cet événement sert de prétexte à décrire, de Belleville à Ménilmontant, le Paris des années 60, ses cafés, ses artistes, les chansons d'Aristide Bruant, les films de Marcel Ophüls, de Jacques Becker et bien sûr de François Truffaut. A la manière d'un Robert Doisneau, le regard de Robert Bober nous entraîne avec beaucoup de tendresse, d'humour et de nostalgie, dans ce récit truffé d'anecdotes pittoresques, qui n'en est pourtant qu'à ses balbutiements.
A la fin du tournage, en effet, Bernard tout fier d'apparaître dans le film, invite sa mère au cinéma pour partager avec elle ce moment de bonheur. A la sortie de la salle, sa mère bouleversée, s'accroche à son bras et lui confie que Jules et Jim - un ménage à trois, disait François Truffaut - c'est son histoire... Il va ainsi plonger dans le passé, sur la trace de son père qu'il a perdu trop jeune - mort en déportation - et de son beau-père - disparu dans l'avion qui coûta la vie à Marcel Cerdan - tous deux amoureux de la même femme, sa mère, amis depuis leur jeunesse en Pologne. La correspondance avec sa tante des Amériques, Esther - la soeur de son père, nous immerge une fois encore dans le monde du cinéma, des Ziegfeld Follies à Harpo Marx, renouant par ce biais les liens familiaux qui, pour un temps, s'étaient malencontreusement interrompus.
Au dernier chapitre de ce livre, le narrateur entreprend un voyage à Auschwitz, pour rejoindre son père, une dernière fois: Je n'ai pas noté le numéro du block consacré aux déportés venant de France. Celui où naturellement on nous conduisit d'abord. Je n'ai pas entendu ce que dans ce lieu le guide nous disait. Il y avait là, devant moi, la photographie de mon père. Celle que je connaissais et que j'avais toujours vue dans son cadre de cuir brun posée sur le buffet de la salle à manger. Sur cette photo, considérablement agrandie, mon père avait retrouvé sa dimension d'homme. Nous étions là, ensemble, debout, tout près, l'un en face de l'autre, dans la même immobilité. Nous avions le même âge. Il me souriait.
Beaucoup d'émotion contenue, de délicatesse et de pudeur dans ce roman de Robert Bober qui évite soigneusement les pièges du mélodrame, avec cette infinie douceur d'un funambule qui foule la neige, atténuant les rumeurs alentour, les yeux tendus vers le ciel et les étoiles.
Robert Bober, On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux (P.O.L., 2010)
sources biographiques: Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bober
00:09 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2010
Philippe Claudel 1a
Bloc-Notes, 23 septembre / Les Saules

Un des thèmes majeurs de l'oeuvre de Philippe Claudel, repose sur la conscience de l'individu confronté à celle de la société, habile à le blesser, le broyer, le détruire. Il nous l'a brillamment démontré avec Les âmes grises et, plus récemment, avec Le rapport de Brodeck. Il en va de même pour L'enquête, sauf que l'auteur n'interroge plus le passé - les horreurs des guerres de 14-18 et 39-45 - mais le monde d'aujourd'hui ou, pour les plus optimistes, celui d'un futur proche.
Dès les premières lignes de ce roman exceptionnel, on songe à Franz Kafka et son court texte intitulé Devant la loi: Un homme est envoyé dans une ville inconnue - par qui, nous ne le saurons jamais - afin d'enquêter au sein d'une Entreprise sur une vague de suicides inexpliqués. A peine parvenu à destination, il réalise que tout concourt à l'empêcher de mener à bien sa mission. Aucun interlocuteur ne répond à ses questions, tantôt le menaçant, tantôt lui prodiguant une sympathie déconcertante. Les lieux eux-mêmes lui semblent inquiétants, hostiles ou irréels.
Toute la ville paraissait se résumer dans l'Entreprise, comme si celle-ci, peu à peu, dans un processus d'expansion que rien n'avait pu freiner, s'était étendue au-delà de ses limites premières, avalant ses périphéries, les digérant, les assimilant en leur instillant sa propre identité. Il se dégageait de tout cela une force mystérieuse qui donna un bref vertige à l'Enquêteur. Lui qui depuis très longtemps avait conscience que sa place dans le monde et la société relevait de l'échelle microscopique découvrait, face à ce paysage de la démesure de l'Entreprise, une autre forme de malaise, celui de son anonymat. En plus de savoir qu'il n'était rien, il se rendait compte soudain qu'il n'était personne.
Avec la désagréable impression d'être constamment épié par des yeux invisibles, d'être transparent pour tous ceux qu'il côtoie, en proie à des cauchemars dont il se demande s'ils sont le fruit de son imagination ou le reflet de la réalité, notre Enquêteur va, avec l'énergie du désespoir, s'obstiner à vouloir lever le voile de cette pieuvre qui absorbe tout - jusqu'aux âmes - et le fait ressembler à une souris de laboratoire qui s'égare de plus en plus loin - jusqu'à la perte de son identité - dans un monde qui l'écrase. Notre monde? Il n'est plus temps de descendre dans les rues et de couper la tête aux rois. Il n'y a plus de rois depuis bien longtemps. Les monarques aujourd'hui n'ont plus ni tête ni visage.
Voyage au coeur de l'absurde, de l'aliénation et du doute, cette histoire se lit comme une fable cruelle et terrifiante sur l'individu incapable désormais de tirer la moindre des ficelles à son avantage, à force de ne plus chercher un sens à sa vie, de n'oser dire non à l'intolérable, à l'humiliation, à l'indifférence, devenu un robot à la voix synthétique tel celui que nous entendons chaque matin dans les autobus, les gares ou les aéroports.
On l'aime bien, cet Enquêteur pourtant ordinaire, mais consciencieux, honnête. On s'accroche à lui, seul contre tous semble-t-il capable encore d'éprouver de la compassion ou un sursaut de révolte malgré tous les obstacles qui lui sont tendus, soucieux d'accomplir sa mission: Son unique raison de vivre. Mais pour lui aussi, n'est-il pas déjà trop tard? Avez-vous conscience que vous ne parlez que par fonction depuis le début de notre entretien? Vous êtes l'Enquêteur, vous évoquez le Policier, le Guide, le Veilleur, le Serveur, le Garde, le Responsable, le Vigile, le Fondateur. Vous n'employez jamais de noms propres, ni pour vous, ni pour les autres. (...) Vous déniez toute humanité, en vous et autour de vous. Vous regardez les hommes et le monde comme un système impersonnel et asexué de fonctions, de rouages, un grand mécanisme sans intelligence...
Un dernier personnage, l'Ombre, délivrera la clef à notre homme, mais à quel prix? Chapitre manquant au meilleur des mondes possibles, ce livre à peine refermé, on s'interroge: Avons-nous traversé un mauvais rêve ou nos pieds foulent-ils les eaux immobiles d'une réalité qui nous colle à la peau et se révèle à nous dans toute sa monstruosité? Certains chapitres, dont celui consacré aux Déplacés, ne laissent planer aucun doute...
Philippe Claudel, L'enquête (Stock, 2010)
00:15 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Franz Kafka, Littérature francophone, Philippe Claudel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2010
Jean d'Ormesson
Bloc-Notes, 9 septembre / Les Saules
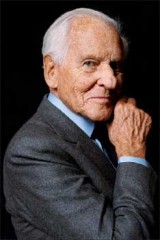
Je ne me suis jamais ennuyé avec Jean d'Ormesson, parce qu'il aime la vie, parce qu'il aime le monde et que je partage bon nombre de ses valeurs: l'insolence, l'ironie, la gratitude, l'ordre, l'admiration, la gaieté, le présent, les contradictions de l'existence, les commencements, la Méditerranée, Saint Augustin, Ernst Lubitsch, George Cukor...
Il en parle avec ardeur, passion et humour, souvent: Je mourrai. J'aurais vécu. Je me suis souvent demandé ce que j'avais fait de ma vie. La réponse était assez claire: je l'ai aimée. J'ai beaucoup aimé ce monde. (...) Je sais que j'y ai été heureux. Intarissable, dans son dernier ouvrage, C'est une chose étrange à la fin que le monde, il embarque ses lecteurs pour un formidable tour du monde de la pensée qui s'étend des origines de l'univers à nos jours, croisant la route des philosophes, des religieux, des scientifiques, des bâtisseurs, des conquérants, des écrivains, dans ce labyrinthe du réel qui prétend tout expliquer mais échoue devant le mystère de la vie, de la raison d'être, du sens de tous ces bouillonnements de la création. Sous l'oeil parfois amusé du Vieux - dans son livre - c'est-à-dire Dieu en personne.
Vallée de larmes et de roses - selon sa propre expression - il réserve à la vie des pages éblouissantes: Le présent est une prison sans barreaux, un filet invisible, sans odeur et sans masse, qui nous enveloppe de partout. Il n'a ni apparence ni existence, et nous n'en sortons jamais. Aucun corps, jamais, n'a vécu ailleurs que dans le présent, aucun esprit, jamais, n'a rien pensé qu'au présent. C'est dans le présent que nous nous souvenons du passé, c'est dans le présent que nous nous projetons dans l'avenir. Le présent change tout le temps et il ne cesse jamais d'être là. Et nous en sommes prisonniers. Passagère et précaire, affreusement temporaire, coincée entre un avenir qui l'envahit et un passé qui la ronge, notre vie ne cesse jamais de se dérouler dans un présent éternel - ou quasi éternel - toujours en train de s'évanouir et toujours en train de renaître.
Le Temps, comme dans la plupart de ses écrits, occupe une place prépondérante, mais par une approche à la fois ingénieuse et légère, un style épuré qui se concentre sur l'essentiel de ses interrogations: Tout ce qui est né mourra. Tout ce qui est apparu dans le temps disparaîtra dans le temps. Au commencement des choses, il y a un peu moins de quatorze milliards d'années, il n'y avait que de l'avenir. A la fin de ce monde et du temps, il n'y aura plus que du passé. Toute l'espérance des hommes se sera changée en souvenir. En souvenir pour qui?
Un bon livre, ce Jean d'Ormesson? Le meilleur - à mon avis - depuis C'était bien (Gallimard 2003) car pour paraphraser son auteur, j'en sors changé, bousculé et moins égaré, conscient de ma chance inouïe d'être vivant, de connaître des fragments d'espérance, de bonheur et de confiance.
Pour terminer, une anecdote un peu caustique du Vieux à qui il fait dire: Il n'y a que les Suisses dont j'aurais un peu de mal à raconter quoique ce soit. Ils sont heureux dans leurs montagnes où ils passent leur temps à élever des vaches et des comptes en banque. Dieu est un peu sévère! Cela dit, Jean d'Ormesson se rachète une conduite en citant L'usage du monde de Nicolas Bouvier, que plus jeune, il emportait avec lui...
Jean d'Ormesson, C'est une chose étrange à la fin que le monde (Laffont, 2010)
00:05 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Jean d'Ormesson, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2010
Sophie Fontanel
Bloc-Notes, 6 septembre / Les Saules

La narratrice de ce récit a beaucoup de chance. auprès d'une mère comme la sienne - avec son sourire qui donne accès à la splendeur du monde - et elle le lui rend bien, à ce moment crucial de l'existence que nous redoutons tous, pour autant que nous aimions nos parents: La vieillesse, les accidents, la maladie, la dépendance réciproque, la proximité de la perte, le deuil.
A la première chute de sa maman, elle est désemparée. Le ciel lui tombe sur la tête: Une mère à terre, je pensais qu'il suffisait de la soulever (à deux, avec la gardienne de l'immeuble), de la remettre dans son lit pour que ça se tasse. Que le rétablissement se goupille de lui-même. Eh bien, j'ai appris. Dans son lit, avec deux fractures et des ligaments déchirés, ma mère se laissait mourir. Elle refusait que j'appelle une ambulance. Refusait le médecin. Refusait les soins. Refusait la nourriture. Refusait l'eau comme s'il se fût agi d'un breuvage où l'on aurait glissé des gouttes susceptibles de tuer sa résistance. Une porte blindée, ma mère. Refusait bien sûr de sourire, et quelle naïveté aussi j'avais de le lui demander dans une pareille détresse.
Pourtant, elle tient bon. Par amour pour sa mère de quatre-vingt six ans, indépendante, qui n'aime pas déranger, elle accepte de s'occuper d'elle au quotidien, subissant de plein fouet ses chutes répétitives, ses pertes de mémoire aussi. Elle connaît les couloirs des hôpitaux, les infirmières et les aides ménagères - dont elle parle avec une bienveillance naturelle - puis les maisons de repos, les soins. L'équilibre de sa propre vie s'en trouve mis à rude épreuve. Un jour, une de ses amies donne un sens à sa douleur et à son impuissance, en lui confiant: Ta maman est tombée encore une fois? Pauvre, pauvre, maman, je sais ce que tu ressens. Oh je sais que la vieille personne c'est toi-même. C'est à toi dans ces moments-là chaque minuscule vertèbre qui sort du dos de la personne âgée, des épines d'hippocampe, et ça lui fait si mal si on oublie de lui mettre les coussins. C'est à toi cette défaite, c'est ta pesanteur, et c'est toi aussi qui pèses ce poids de la vieille personne, et je sais que même la plus légère est insupportable, c'est à toi cette fin de vie...
Si le sujet du livre de Sophie Fontanel - probablement une autofiction - est grave, il est cependant parcouru par un formidable élan d'amour et de gratitude qui, la plupart du temps, transfigure jusqu'aux instants les plus pénibles. S'y ajoute une écriture pleine de fraîcheur qui vole de page en page comme une canne invisible auprès de cette mère qui ne veut pas disparaître: Sa meilleure amie sur terre. Elle saisit avec beaucoup de tendresse et d'humour les petits riens de ce quotidien à l'étroit qui font toute la différence: Sa gourmandise, ses coquetteries, ses espiègleries, ses rêves, ses désirs de croquer la vie à pleines dents, aujourd'hui, auprès de sa fille chérie.
Cette dernière grandira. Elle apprendra qu'être solidaire, c'est anticiper; que ce temps qui s'inverse, où la mémoire s'en va, paradoxalement s'accompagne d'une lucidité accrue; qu'une mère à de droit de céder au découragement; que l'amour partagé distille la force, le courage, le rire. Reste l'interrogation, à l'adresse de nous qui pour un temps encore foulons avec allégresse la terre sous nos pieds: Je pense qu'un jour moi aussi, je serai âgée, moi aussi je passerai un cap et je devrai m'en remettre à la bienveillance d'autrui. Lorsque ce jour viendra, qui dans ce monde pourra faire pour moi ce que je fais pour ma mère? Qui sera présent? Qui me soutiendra quand, à mon tour, je serai une personne vulnérable? Et est-ce que je me tuerai un jour, pour cause de ce manque d'amour très particulier qui est le manque d'aide?
L'amour vrai est éternel, selon Balzac, infini et toujours semblable à lui-même. Il est égal et pur, sans démonstrations violentes: On le voit avec les poils blancs et est toujours jeune au coeur.
Une première clef qui ouvre bien des tiroirs secrets...
Sophie Fontanel, Grandir (Laffont, 2010)
00:02 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












