22/05/2011
Dany Laferrière
Bloc-Notes, 22 mai / Les Saules

En Haïti, il y eut un certain 12 janvier, comme ailleurs un 11 septembre. Avant, il y avait l'insouciance, puis soudain ce jour de séisme terrible. Dany Laferrière, écrivain haïtien résidant au Canada, se trouvait dans son pays au moment du drame. Un an après, il tente de faire revivre ce qu'il a vu, observé, partagé. Le pire comme le meilleur concentré dans cet instant crucial dont le monde entier a été le témoin, à travers un prisme déformé, il est vrai: Tout cela a duré moins d'une minute. On a eu huit à dix secondes pour prendre une décision. Quitter l'endroit ou rester. Très rares sont ceux qui ont fait un bon départ.
Comme souvent devant un choc d'une telle cette amplitude - les exemples sont nombreux dans l'histoire contemporaine - il témoigne de la difficulté de témoigner du moment de la catastrophe en elle-même, tant la blessure intime est grande et la surprise, totale. Son récit, Tout bouge autour de moi, est habité d'une retenue bienveillante, généreuse et lucide pour dire les émotions brutes qui ont affecté sa famille ou leurs proches: Certains voient s'envoler, en une minute, le travail d'une vie. Ce nuage dans le ciel tout à l'heure c'était la poussière de leurs rêves.
Ce qui rend ce livre particulièrement attachant tient à cette page douloureuse de l'histoire d'Haïti où se juxtaposent le temps de l'auteur avec celui de ces anonymes pour la plupart, armés d'un grand appétit de vivre, portant l'espérance jusqu'en enfer. Ce sont eux, les véritables héros de ces éclats de mémoire que nous livre Dany Laferrière: Certaines personnes parviennent à danser sur les braises. On les traite d'insouciants ou d'irresponsables sans savoir que ce sont pourtant des êtres d'une force d'âme exceptionnelle. S'ils ont traversé cette époque sanglante avec une humeur égale, c'est qu'ils estiment qu'on n'a pas besoin d'ajouter son drame personnel au malheur collectif.
Il trouve le ton juste pour évoquer la culpabilité des rescapés ou ironiser - sans méchanceté aucune - sur la couverture médiatique des événements et son cortège d'images fortes: Le pire n'est pas l'enfilade de malheurs, mais l'absence de nuances dans l'oeil froid de la caméra...
Quel est le secret de cet auteur pour qu'au-delà de cette fracture existentielle, se dégage de son livre une force si tranquille et déterminée? De sa mère, de sa tante Renée, de ses amis, ainsi que de la poésie qui résonne comme un violon dans ses ténèbres passagères et qui, seule, le console des horreurs du monde.
On dit qu'un malheur chasse l'autre. Et les journalistes ont beau se précipiter ailleurs, Haïti continuera d'occuper longtemps encore le coeur du monde.
Eteignez vos téléviseurs à l'heure des actualités et plutôt que de suivre les péripéties de l'affaire DSK qui semble secouer la planète aujourd'hui - une agitation indécente qui donnerait pour un peu raison à Louis-Ferdinand Céline, quand il affirme, dans Voyage au bout de la nuit, que le monde n'est qu'une immense entreprise à se foutre du monde - lisez Tout bouge autour de moi: un chant pudique de larmes, de gratitude et d'espoir. Les gens sans importance ont parfois tant de choses à nous dire...
Dany Laferrière est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages parmi lesquels Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer (1999), Le goût des jeunes filles (2005) et L'énigme du retour (2009). Avec ce dernier, il reçoit le prix Médicis. Il participe aussi au magnifique collectif Serpent à plumes pour Haïti (2010).
Dany Laferrière, Tout bouge autour de moi (Grasset, 2011)
publié dans Le Passe Muraille no 86 - juin 2011
00:57 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Le monde comme il va, Le Passe Muraille, Littérature francophone, Louis-Ferdinand Céline | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; document; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2011
Lettre à un jeune libraire 3/3
Bloc-Notes, 16 mai / Les Saules

Les saisons se sont succédées avec un bonheur semblable aux années de la vigne, tantôt exceptionnel dans sa limpidité, tantôt mesuré, quoique jamais ordinaire pour autant. Tu as vu avec tristesse et reconnaissance quelques passeurs de livres s'éteindre à tout jamais, mais quel étonnement bienfaisant à la vue de ces jeunes libraires qui habillent de couleurs nouvelles ce jardin mouvant et enchanteur! Ils t'interpellent, te provoquent, t'émerveillent, insufflant dans tes veines un souffle nouveau, un remède à la mélancolie et au sceau définitif sur les choses, cette mort lente à laquelle tu tournes le dos avec obstination.
Armé de cette ligne claire, tu grandiras ainsi au carrefour des mondes et des générations, et à cette période charnière de ton existence, la tentation te viendra peut-être - encouragée par tes pairs - de gravir les marches vers les sommets - une direction de librairie, par exemple - avec un plan de carrière auquel tu voudras faire honneur, le mieux possible. Dans un élan conquérant, tu connaîtras l'euphorie d'une nouvelle liberté, mais prends garde: personne, durablement, ne te signera un chèque en blanc. Une autre solitude se manifestera alors dans ta vie: celle des solidarités sélectives qui ne valent la plupart du temps qu'entre gens de même statut, modifiant le rapport naturel aux êtres que tu entretenais jusqu'alors. Tu seras apprécié sans doute, de la base au sommet de la pyramide de ton entreprise, mais les valeurs que tu déploieras - accomplir ce qu'on attend de toi - susciteront pour les uns, qui sait, de l'admiration à ton égard, alors que pour d'autres, ces mêmes valeurs pourront te valoir du mépris: tout le fragile équilibre du pouvoir limité dans son rayonnement...
Un chemin difficile aux récompenses incertaines que celui-ci, si tu le choisis. Difficile, mais pas nécessairement impossible à apprivoiser. Certains libraires y seront plus habiles que d'autres, et aucun choix n'est en soi détestable. Tu pourras, à certains jours, briller de mille feux - ceux de ta réussite, de ton enthousiasme et de ton humanité - mais à quel prix?
Si tu doutes de tes capacités - tes subordonnés ont besoin de certitudes, même si, comme en politique elles sont souvent illusoires - tu perdras ton autorité; si tu découvres à tous ta vulnérabilité, ta crainte de l'avenir et des autres - voire ta culpabilité envers eux - tu perdras ta crédibilité; si tu recherches avant tout d'être reconnu et aimé de tous - un vieux rêve de tyran vaniteux qui sévit aux deux extrêmes de l'échiquier - tu seras manipulé... par tous! Si enfin ton coeur s'endurcit - à force de recevoir des coups et de les donner même pour de justes causes - tu perdras jusqu'au souvenir de tes commencements, de tes passions initiales, asphyxiées qu'elles seront par ces cellules grises de la normalité et des prudences collectives, aux dépens de l'imagination, de l'audace et de la créativité individuelles sans lesquelles il ne fait pas bon vivre.
Quoiqu'il advienne de ta carrière - ou de son absence - l'humour dont tu ne manques pas te permettra, avec une juste distance et une autodérision salutaire, d'absorber les multiples contradictions de ce métier - le plus beau du monde! - dont les bourgeons en fleur, dans ta main ouverte, ne cesseront de voir le jour.
N'est-ce pas ce que les poètes appellent un sentiment de bonheur au bord des larmes?
Les hommes, à de certains moments, sont maîtres de leurs destinées. Si nous ne sommes que des subalternes, la faute en est à nous et non à nos étoiles. (1)
(1) William Shakespeare, Jules César (coll. Folio Théâtre/Gallimard, 2007)
image: buste de Jules César
01:32 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, William Shakespeare | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; librairie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
15/05/2011
Lettre à un jeune libraire 2/3
Bloc-Notes, 15 mai / Les Saules

Aujourd'hui, le présent t'accable. On dirait qu'il fracasse tes rêves et te couvre d'une fine pellicule de givre. C'est le signe de la fin des commencements, une aube fertile mais menaçante dans laquelle tu ne reconnais plus ta propre voix. Les parois de ton lieu de travail semblent rétrécir. Pourtant, son ambiance unique - une chaleur, un esprit d'ouverture et une curiosité commune que tu ne retrouverais nulle part ailleurs - te ravit autant qu'au premier jour. Avec un peu d'ironie, tu pourrais ajouter que les rémunérations plutôt modestes au sein de la profession tendent à rassembler plutôt qu'à diviser ces amis du livre qui choisissent le métier de libraire par vocation, rarement par nécessité. Le contraire d'une activité calculatrice ou routinière, en quelque sorte. Mais l'impression d'essoufflement te saisit malgré tout, te malmène et décharge toute passion de sa substance. Ce n'est pas rendre compte qui est difficile, mais durer sous la mouvance de cet affadissement progressif, lancinant, incompréhensible qui gâche la source, appauvrit la sève. Nageur impénitent, à contre-courant, tu es seul, irrémédiablement seul. La magie, présente et bien réelle, n'y change rien. Ta vue se brouille alors que ton coeur, avide de fulgurances et de signes, ne desserre pas l'étreinte.
Je chante la chaleur à visage de nouveau-né, la chaleur désespérée. (1)
L'heure est au découragement. Pour que le brouillard matinal s'estompe et que la folie lumineuse te gagne à nouveau, il te faut accepter de n'en jamais finir d'apprendre: à mesurer la distance entre le bagage et l'ignorance, entre la suffisance et la croissance, entre la fureur et le jugement, comme la barque qui gagne sa liberté sur le fleuve, en renonçant à ces repères familiers qui l'entraîneraient à s'échouer au premier obstacle. Exposé à tant de merveilles dont bien d'autres - les proches, les auteurs, les maîtres, les lecteurs - balisent l'étroit sentier de ton savoir fragmentaire, il te semble n'être plus rien, pas même une poignée de sable qu'un vent mauvais très vite efface.
C'est pourtant dans ce désespoir nouveau - qui irrémédiablement te ramène à la première pierre - que s'intensifiera ta flamme, dans la vulnérabilité que se dessineront les plus belles de tes découvertes, dans le doute que s'exposeront tes mouvements de l'âme les plus mémorables. La force au contraire, dont tu regrettes de n'être pas assez pourvu - si louée soit-elle parmi tes semblables - limite l'espace, le maîtrise ou le justifie. Rarement elle n'inspire l'infini, l'émotion pure, le renouvellement. Coeur sans joie véritable, elle se suffit à elle-même et à toi, elle ne suffit pas.
Ta raison de vivre sera toujours, au-delà de toute considération extérieure, dans le livre: Si tu brûles le livre, il s'ouvre dans la flamme, à l'absence; si tu le noies, il se déploie avec l'onde; si tu l'enterres, il étanche ta soif de désert; car toute parole est eau pure de salut. (2)
Souris: le temps de la grâce est proche...
(à suivre)
(1) René Char, A la santé du serpent (Voix d'encre, 2008)
(2) Edmond Jabès, Yaël (Gallimard, 1967)
image: François Truffaut, Fahrenheit 451
21:52 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone, René Char | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; librairie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
14/05/2011
Lettre à un jeune libraire 1/3
Bloc-Notes, 14 mai / Les Saules

Autant qu'il m'en souvienne - selon tes dires - cela a commencé ainsi, avec la sonate de Vinteuil: Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que ces parties de l'âme de Swann où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse. (1)
Le vide était pourtant là, intérieur et informulé. Aux contours indéfinis, il n'avait pas changé, ni en pesanteur, ni en intensité. Pourtant, à la sortie de cette librairie de quartier où tu avais acheté ce roman, tu sentais confusément que l'espace s'ouvrait à ton imagination adolescente et que, pour la première fois peut-être, lisant et relisant ces quelques lignes, tu te sentais mieux dans ta peau au sein d'un monde qui ne te suffisait pas - trop étroit, rigide ou banal - auquel le livre venait ajouter une dimension insoupçonnée. Pas le bonheur surgi par surprise, ni la fuite dans un ailleurs séduisant: tout juste une résonance capable de révéler le sens des choses, de l'éclairer, de l'approfondir ou le libérer. Ainsi, la découverte du livre était-elle associée à un lieu habitable, magique et chaleureux. Malgré les tempêtes qui n'ont pas manqué de t'assaillir par la suite, cet étroit sentiment d'appartenance ne t'a jamais quitté.
Envers et contre tout - un métier souvent comparé à celui des saltimbanques - tu as ainsi décidé, très vite, de devenir libraire, par soif d'apprendre, de découvrir, de connaître et d'élargir ton horizon aux dimensions d'un monde où la raison n'aurait jamais le dernier mot. Trop paresseux pour être médecin, trop orgueilleux pour être religieux, trop marginal pour être instituteur, ton choix était fait. L'insoumission fut longtemps pour toi, un mot illustrant au mieux ce milieu étrange du livre. Plus tard, tu l'as remplacé par celui de résistance, plus adapté à toute la chaîne de la création, depuis l'auteur qui invente jusqu'au lecteur qui interprète, en passant par le libraire, messager discret et veilleur du temps des autres.
Malheureusement - un dilemme propre à toutes les métiers artistiques - il t'a fallu ajouter un autre mot: celui de l'ambiguité, délicate balance entre les trésors que tu espérais partager et les besoins dont le grand nombre - employeurs et lecteurs confondus - réclamait la récompense. Autrement dit, la notion haïssable de commerce - disais-tu au cours de tes années d'apprentissage - faisait irruption dans la vraie vie où tu grandissais en expérience moins rapidement que dans l'autre, celle de tes lectures. Temps de l'incertitude et du défi, sur l'aile précautionneuse du vent... mais quelle importance, somme toute, puisque la parole écrite suffisait à ta faim au sein de cette grande famille du livre et te donnait des ailes, comme l'oiseau qui fait trembler la branche sans réaliser encore qu'il réjouit l'arbre tout entier.
Le changement du regard, comme la bergeronnette derrière le laboureur, de motte en motte, s'émerveille de la terre joueuse nouvellement née qui s'offre à la nourrir parmi tant de frayeur... (2)
(à suivre)
(1) Marcel Proust, Du côté de chez Swann - A la recherche du temps perdu (coll. Livre de poche/LGF, 2008)
(2) René Char, Fenêtres dormantes et porte sur le toit (Gallimard, 1979)
illustration: manuscrit de Marcel Proust (Bibliothèque nationale de France)
03:09 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone, Marcel Proust, René Char | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; librairie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
08/05/2011
Rosa Montero
Bloc-Notes, 8 mai / Les Saules

Si vous aimez qu'on vous raconte des histoires où la magie, le rêve et la lumière crue de la réalité se fondent en un ballet aux desseins imprévisibles, lisez vite le dernier roman de Rosa Montero qui, comme dans Instructions pour sauver le monde - déjà commenté dans ces colonnes - déploie ses talents de conteuse incomparable, dans un foisonnement de vie extrêmement attachant.
Dans Belle et sombre, Baba évoque pour nous le monde de l'enfance d'une toute jeune fille retirée de l'orphelinat qui aboutit dans un quartier marginal au sein d'une famille de saltimbanques. Elle grandit ainsi, sous la protection de Dona Barbara la grand-mère, une femme de caractère; d'Amanda, sa tante et de son mari au mauvais oeil Segundo; de Chico son cousin, témoin silencieux et d'Airelai, la naine partagée entre son imagination fertile et sa magie; enfin de Maximo, ce père absent, admiré de tous, dont Baba est persuadée qu'un jour, il reviendra la chercher.
Ce récit allégorique s'ouvre sur la confidence de Dona Barbara faite à Baba qui imprègne toute l'ambiance du livre: Quand je suis née, le monde a commencé. (...) Il va finir, mais toi, tu inventeras un monde nouveau. Même si le décor est souvent menaçant ou sordide, Baba saura le nourrir de mille rêves et senteurs, avec l'aide d'Airelai - le personnage le plus émouvant de Belle et sombre -, ses malles, ses accessoires de magie, ses robes brodées d'étincelles de lumière, ses aventures extraordinaires: Nous sommes capables de nous raconter, et même de nous inventer notre propre existence. (...) La première chose que tu dois savoir c'est que, quand quelqu'un s'est gagné un destin et s'est attiré une infortune, la seule façon de l'éviter, c'est de la remplacer par une autre sorte de malheur. C'est-à-dire qu'il faudra choisir entre la grâce et la douleur. (...) J'ai finalement choisi, et j'ai préféré la grâce. Parce que je préfère la connaissance, même avec les malheurs, à un bonheur stupide et sans conscience.
La barbarie des hommes, sourde et omniprésente dans toutes les histoires d'Airelai, nous vaut quelques pages inoubliables: J'ai été témoin d'horreurs au-delà des mots. J'ai vu des boiteux lapidés parce qu'ils étaient boiteux, des noirs brûlés vifs parce qu'ils étaient noirs, des vieillards affamés par leurs enfants, des filles violées par leurs propres pères. J'ai vu égorger pour un paquet de cigarettes et éventrer au nom de Dieu. Il y a des gens qui se délectent de cet enfer et je les connais bien, parce que je me suis souvent vue obligée de cohabiter avec eux. (...) Mais moi je possède la grâce et je suis puissante. C'est pour ça que je leur ai toujours survécu. De toutes les cruautés que j'ai connues, la plus répandue est celle de celui qui ignore qu'il est cruel. Les êtres humains sont comme ça: ils détruisent et torturent, mais ils se débrouillent pour se croire innocents.
C'est encore Airelai qui lui livrera, à propos de l'amour, ses confidences en clair-obscur: La passion est une maladie de l'âme qui vous fait irrémédiablement perdre votre liberté. Il n'y a pas de passion sans esclavage, et si vous aimez quelqu'un sans ce sens de la défaite, sans cette dépendance anxieuse de l'être aimé, alors c'est que vous ne l'aimez pas pour de vrai. L'amour est la drogue la plus forte et la plus perverse de la nature. C'est un mal lumineux, qui vous dupe avec ses étincelles de couleur pendant qu'il vous dévore. Mais une fois que vous avez connu la vie fébrile de la passion, vous ne pouvez pas vous résigner à retourner au monde gris de la vie raisonnable.
Dans l'ombre inquiétante du Portugais et de l'homme-requin, dont le rapprochement avec Segundo n'augure rien de bon, Baba grandit, se fortifie sans renoncer à ses rêves. Avec son ami Chico, dans ce monde de la nuit où les taches de sang les plus obscures se mélangent au besoin effréné de gagner sa liberté, Baba cherchera et attendra son père, de même que l'étoile magique prédite par la naine: cette boule de feu aveuglante qui dévorera d'un seul coup toute l'obscurité et préfigurera une vie heureuse.
La douceur et l'horreur sont si proches l'une de l'autre, dans cette vie si belle et si sombre...
Tout simplement magnifique!
Rosa Montero, Belle et sombre (Métailié, 2011)
publié dans Le Passe Muraille no 86 - juin 2011
11:22 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Le Passe Muraille, Littérature espagnole, Rosa Montero | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2011
Lettre à ma fille
Bloc-Notes, 1er mai / Les Saules
pour Catherine P et Jean-Pierre O
Les paroles des albums de Fabien Marsaud - alias Grand Corps Malade - sont parfois a cappella mais elles sont, globalement, accompagnées d'une mélodie minimaliste en arrière-plan qui souligne le texte; texte qui est dit et non chanté. écrit toujours sans musique. Celle-ci est toujours créée après, en fonction des textes.
En voici un exemple tout à fait bouleversant intitulé Lettre à ma fille: Une lettre qui résonne au-delà des frontières, celles des contours d'un pays, d'une religion, d'une langue, d'un coeur... ces frontières extrêmes du langage, où la parole est la demeure de l'être, comme le dit si bien Hector Bianciotti.
La vidéo ci-dessous est suivie du texte écrit, si cela vous intéresse... Beau dimanche à tous!
Comme tous les matins, tu es passée devant ce miroir, ajuster ce voile sur tes cheveux, qui devra tenir jusqu'à ce soir; tu m'as dit au revoir d'un regard, avant de quitter la maison; le bus t'emmène à la fac, où tu te construis un horizon.
Je suis resté immobile, j'ai pensé très fort à toi; réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit; c'est vrai, je ne te l'ai jamais dit - ni trop fort, ni tout bas - mais tu sais ma fille chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.
Je t'ai élevée de mon mieux, et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition; comme l'ont fait mes parents (crois-moi sans riposter), comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée.
Je t'ai élevée de mon mieux comme le font tous les nôtres mais était-ce pour ton bien ouu pour faire comme les autres? Tous ces doutes qui apparaissent et cette question affreuse: c'est moi qui t'ai élevée, mais es-tu seulement « heureuse »?
Je sais que je suis sévère, et nombreux sont les interdits: tu rentres tout de suite après l'école et ne sors jamais le samedi; mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée: Tu songes à quoi dans ta chambre, quand tes amis vont danser?
Tout le monde est fier de toi, tu as toujours été une bonne élève; mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire sur tes lèvres? Tout ça je me le demande, mais jamais en face de toi; tu sais ma fille chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.
Et si on décidait que tous les bien-pensants se taisent? Si pour un temps on oubliait ces convenances qui nous pèsent? Si pour une fois tu avais le droit de faire ce que tu veux, si pour une fois tu allais danser en lâchant tes cheveux?
Je veux que tu cries, et que tu chantes à la face du monde! Je veux que tu laisses s'épanouir tous ces plaisirs qui t'inondent; je veux que tu sortes, je veux que tu ries, je veux que tu parles d'amour; je veux que tu aies le droit d'avoir vingt ans, au moins pour quelques jours.
Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments, mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches, simplement, que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas; tu sais ma fille chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.
texte: Grand Corps Malade
Interprète: Idir
Album: La France des Couleurs
Label: SMI
Sources: Wikipédia
00:58 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Chansons inoubliables, Littérature francophone, Rosebud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; chanson; variétés |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2011
Quasi une fantasia 3/3
Bloc-Notes, 28 avril / Les Saules
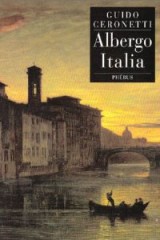
Le livre de Guido Ceronetti est bien plus qu'un compagnon de voyage. D'une humanité sous-jacente à tous ces billets d'humeur, il s'y exprime souvent avec un humour féroce - voir Du nouveau dans la mendicité ou Que sauver d'Italoshima? - mais parfois aussi avec une nostalgie tendre et rageuse, par exemple dans un chapitre émouvant intitulé L'Italie à une lire: La perte des chansons à une lire n'est pas la perte d'une lire. On n'accorde jamais un minimum de perte d'âme à ce qui ne correspond pas à une avancée du front entier des ténèbres. (...) Ce n'est pas la perte d'une lire, parce que la voix humaine qui chante exclut, brise prodigieusement le fini. D'un seul coup le poids qui nous écrase devient moins terrible, moins intolérable; en quelques notes l'infini a fait levier, il soulève le monde, le trop grand mal du monde.
Dans Lettre à une prostituée, je vous partage aussi cette belle réflexion sur l'amour: Il suffit d'une certaine idée de la beauté pour réprimer ce qu'il est nécessaire de réprimer. S'il manque cette idée universelle et la conscience de la douleur, on ne peut sentir le battement revivifiant de l'éventail sublime, de la fraîcheur incomparable de l'amour. Vouloir que tout soit libre est la folie du monde actuel, et la vie n'en devient que plus sombre, plus désespérée.
Un art de vivre et une conscience qui ne peuvent laisser indifférent - surtout de nos jours - quand Guido Ceronetti croque la mort des rizières ou le sens du patriotisme. Le plus beau visage de Albergo Italia est sans doute celui de l'un de ces Iraniens qui vend le journal de ceux qui combattent les crimes du régime, un message jailli de la profondeur de l'océan des douleurs: Je vais vous dire ce que vous perdez en n'achetant pas le feuillet illisible. Moi qui l'achète, je le sais... Non, ce n'est pas pour la lire... C'est pour le sourire. Si vous leur mettez dans la main, avec à peine un signe muet de solidarité, ces mille cinq cents lires, les Iraniens vous en récompensent d'un sourire si rayonnant de sympathie et de douceur, si débordant de reconnaissance, qu'il vous fait rougir à l'idée du peu d'effort qu'il vous en a coûté pour l'obtenir. Le sourire de l'Iranien vous rassure: non, vous n'êtes pas de ces charognes égoïstes, même si vous êtes conscients d'en faire partie. Alors, si vous vous sentez seuls, si l'absence d'âme de la coulée humaine qui vous heurte et vous bouscule vous accable, ne perdez pas cette occasion (...) et vous verrez à chaque fois pointer cette fleur rare, absurde, ce sourire d'humanité vive, massacrée mais vivante, ni pétrifiée, ni vitrifiée, ni éteinte.
Hymne à la beauté autant que croisade désespérée contre l'abrutissement, la vulgarité et le profit, Albergo Italia est précédé, chronologiquement, par Voyage en Italie, paru chez Albin Michel en 1996. Guido Ceronetti, né en 1927 à Andezeno, dans la province de Turin, est à la fois poète, penseur, journaliste, dramaturge, traducteur d'oeuvres latines et marionnettiste. Parmi ses écrits traduits en langue française - outre les deux précédentes - peuvent être cités Le silence du corps, Une poignée d'apparences et La patience du brûlé - carnets de voyage 1983-1987, tous les trois publiés par Albin Michel.
Un mot encore: Un jour peut-être, vous vous hasarderez dans la librairie où je butine depuis de nombreuses années. Derrière mes traits pâles et tirés, vous devinerez que, malheureusement pour vous, ce n'est ni le jour ni l'heure propice aux échanges, aux épanchements, aux sourires. De l'électricité dans l'air? De l'exaspération? De la colère? Ne rebroussez pas chemin, mais ne me parlez pas, ne me demandez rien... Cherchez simplement du regard la section des essais littéraires. Sous la lettre C vous trouverez le livre Albergo Italia de Guido Ceronetti. Achetez-le, lisez-le. Ensuite - et ce sera votre revanche - vous pourrez à votre tour rédiger un billet d'humeur dont les premiers traits de plume diront à peu près ceci: Tout avait pourtant mal commencé, dans une librairie nyonnaise...
Mais je plaisante, bien sûr!
Guido Ceronetti, Albergo Italia (Phébus, 2003)
Guido Ceronetti, Voyage en Italie (Albin Michel, 1996)
00:01 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2011
Quasi une fantasia 2/3
Bloc-Notes, 26 avril / Les Saules

Outre mon attirance naturelle pour tout ce qui concerne l'Italie, ce qui me touche d'emblée dans Albergo Italia de Guido Ceronetti, c'est la mise en perspective de deux mille ans et plus d'art, de culture, d'histoire, de valeurs revisitées dans ces années 80, avec une liberté de pensée et un sens critique très aiguisé devenus si rares en littérature, où les auteurs communément, tantôt font preuve d'une admiration sans discernement, tantôt se livrent à une entreprise de démolition sans fondement. Rien de tel dans cet ouvrage dont il vaut la peine - même si l'extrait peut sembler long - de se laisser imprégner par les premières lignes de ces billets d'humeur publiés à l'origine dans les colonnes de la Stampa, donnant toute la mesure de la tonalité de ces promenades attachantes et érudites à travers l'Italie:
L'Albergo Italia est un hôtel de malaise, de l'ennui et de l'insomnie avec, ici ou là, toujours plus d'anxiété et de peur. Mais il conserve l'attrait des grands hôtels déchus où des plaques commémorent des séjours d'empereurs ou de musiciens. Et c'est aussi le mien... On me connaît et, si je ne suis pas vraiment une personnalité, je n'y suis pas non plus personne. S'il m'arrive de crier dans la nuit, une main se tend. J'occupe une bonne chambre, toujours la même; elle a des rideaux pour voir ou ne pas voir, mais ce qu'il est possible d'apercevoir de la fenêtre a perdu peu à peu une grande partie de sa beauté. Une chose qui change, touchée chaque jour davantage par l'inexplicable. Une colline disparaît et à sa place on ne voit plus que fumée et acier. Une cour et ses cariatides chantantes se sont tues pour devenir un columbarium pour défunts coûteux. Un oratoire pour la Madone est maintenant un dépôt de motocyclettes. Aux bonnes odeurs de cuisine et de jardin ont succédé des miasmes qui brûlent la gorge. Pourtant, si j'ouvre les volets, je me dis qu'il est encore bon de sentir ces odeurs âcres auxquelles nous avons fini par nous habituer, de crainte qu'il nous arrive pis.
Pessimiste, Guido Ceronetti? On le serait à moins, mais contrairement à ce que suggère le quatrième de couverture de Albergo Italia, il n'y pas seulement de l'amertume ou de la nostalgie dans les évocations de son pays pour qui sait - ou veut - savourer, au détour d'une phrase ou d'une citation, l'enchantement certes lézardé, mais encore suffisamment séduisant pour conduire le lecteur attentif à prendre son bâton de pèlerin et le suivre en toute confiance, hors des sentiers battus.
J'aspire à redécouvrir, dans son ombre, certains lieux mal visités autrefois, tels Mantoue dont il dit demeurer surpris de voir que l'âme lombarde - ce qui est aimable, généreux, tolérant, peu enclin à la fatuité, attentif, virgilien - survit encore dans cette ville des brumes; il n'est pas moins généreux avec Trieste - une intense couleur de noblesse morale, une agitation nerveuse venue non des limbes vulgaires, mais d'âmes vivantes en révolte - ou Gubbio - qui a vu Gubbio une seule fois ne peut plus jamais l'oublier - mais se montre sévère avec d'autres lieux.
Naples, par exemple: Une ville de philosophes désormais réduite à un parfait télescopage de vulgarités, à un choc désespéré de grincements qui étouffent toute idée d'une cohabitation humaine décente. (...) Le golfe entier est désormais un véritable cloaque: urbain, administratif, touristique, alimentaire, moral; aucune beauté ne subsiste; le vitriol des camorras a défiguré partout la droiture; s'il vous reste encore un coeur et des yeux, vous pouvez seulement vous en servir pour pleurer. Il n'est pas plus tendre avec Rome: On n'y rêve pas, on n'y prie pas, on prend seulement des autobus dont on descend toujours avant d'être arrivé, en détestant le visage humain.
Pourtant, même en ces deux villes, sa curiosité nous attire dans quelques recoins secrets où vacille encore une faible lumière, comme il le fait avec Assise - qu'un vent inimitable ne parvient pas à blesser (...) Intoxiquée par la foule, elle reste solitaire. Elle s'est avilie, mais l'air la soutient - ou Venise - il y a des coffres enfouis dans les épaves coulées - qu'il n'apprécie guère.
Si je ne partage pas son appréhension de cette dernière, à laquelle j'ai toujours été sensible hors saison - tôt le matin ou tard le soir, longeant des canaux méconnus de l'étranger ou entrant dans une église où je ne rencontrais personne - avec Guido Ceronetti j'ai plaisir à me laisser bousculer, à priori toujours tenté d'idéaliser ce qui parfois ne le mérite pas ou d'effleurer seulement ce qu'il vaudrait la peine de creuser ou d'apprendre.
Mais Albergo Italia, ce n'est pas que cela...
A suivre...
Guido Ceronetti, Albergo Italia (Phébus, 2003)
00:02 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2011
Quasi une fantasia 1/3
Bloc-Notes, 25 avril / Les Saules

Tout avait pourtant bien commencé, ce jour-là. Emergeant d'un sommeil prolongé - recommandé depuis quelques semaines par la faculté de médecine! - écartant les rideaux de ma chambre, je pressentais une belle journée, tandis que le chant multiple des oiseaux, tout alentour, me confortait dans l'idée que le bonheur goûté en silence, me prive de diffuser, de partager ou de fuir tant de niaiseries, de bêtises ou de banalités qui, pour sûr, une heure plus tard, ne manqueraient de fondre sur moi comme un vol têtu de mouches insouciantes de tacher cette magnifique et changeante robe du ciel où s'ébattent ces amis de frère François, auxquels, soit dit en passant - c'est ma forme de gratitude - je fournis le gîte et le couvert, même quand les saisons sont clémentes.
Le temps de glisser une musique pour mes amis sur Facebook, me voici, empruntant le chemin de Ruth où j'habite, afin de rejoindre l'autobus au chemin des Princes. Un premier désagrément aurait dû éveiller ma méfiance et me suggérer de rebrousser chemin: Je croise une femme, plutôt une zombie accompagnée d'un chien bien vivant dont je ne conserve aucun souvenir - entendez par là une de ces nouvelles riches qui prolifèrent à foison depuis le débarquement des oligarques russes - pour qui répondre au bonjour d'un proche voisin, constitue une faute de rang impardonnable. La scène se reproduit à l'arrêt des transports publics, mais avec quelques nuances: Cette fois-ci, il s'agit d'enfants prêts à emprunter le minibus du réputé collège privé de Florimont. A leur propos, je n'ai rien à dire, mais Ils sont accompagnés d'une femme entre deux âges, philippine sans doute, qui imite la zombitude de ma rencontre précédente, comme si ce signe malin - un copier/coller vide et creux - ferait d'elle une des leurs. Une membre de la classe dirigeante. Quelle ignorance revancharde, quelle affligeante imbécillité, et cela, de si bon matin!
Dans mon autobus chéri - qui me réserve souvent des moments de lecture privilégiés - un nouvel incident se produit, à l'arrêt de La Rippaz: Une africaine avec un landau ne prend pas garde que dans les anciens modèles de transport, seule une porte est aménagée pour accéder au véhicule. Elle en emprunte une autre, et là, l'enfer se matérialise. Le chauffeur, une espèce de Rocky VI ou VII manifestement contrarié ou excédé, quitte sa place, se plante devant ladite passagère, la sermonne vertement sur sa responsabilité en cas d'accident, les interdictions à observer dans les transports publics, les retards occasionnés sur l'horaire et que sais-je encore. Elle l'écoute avec attention et respect. Dans le balancement gracieux du cou qui s'harmonise avec son regard discret empreint d'une douce mélancolie, je devine qu'elle a l'habitude de ces dérapages, qu'ils n'ont pas trop d'importance et qu'elle en a probablement connu de bien pires, sous nos latitudes inhospitalières. Un peu plus loin, lui traduisant en des termes un peu plus civilisés les propos du conducteur, j'apprends qu'elle ne comprend que la langue anglaise...
Sur le quai de la gare Cornavin où j'attends le chemin de fer qui m'emmènera à Nyon, je vitupère intérieurement contre tous ceux qui s'acharnent à gâcher ma si belle journée naissante, ici au milieu d'un autre type de zombies: les adeptes de la pensée unique avec leur 20 minutes - quotidien gratuit - ou leur natel manipulé à l'infini, oublieux du silence et de l'immobilité auxquels fort heureusement fait obstacle un club de randonneurs du troisième âge dont l'oeil, malicieux et rieur, témoigne d'un reste d'humanité dans cette foire au béton. Comme pour enfoncer définitivement le clou de mon exaspération, j'apprends par la manchette d'un quotidien lausannois que les fumeurs, sur les quais de gare, incommodent de plus en plus les autres, candidats à l'immortalité. Sinon, pour quoi d'autre? Ah la sage Helvétie au sein de laquelle le mot verboten - interdit - résonne comme un anesthésiant puissant et salvateur. La canne blanche des futurs zombies... complément recherché de la désormais célèbre phrase de Georges Clemenceau reprise par Paul Claudel: la tolérance, il y a des maisons pour ça!
Arrivé sur mon lieu de travail, j'apprends enfin que, la veille, je n'ai pas respecté une procédure quelconque - je les envoie systématiquement valser dans la poubelle la plus proche avec une désinvolture persistante - et voilà: Ma journée est, semble-t-il, définitivement pourrie...
Mais là encore, je me serai trompé. Au cours de la matinée, un de mes jeunes et sympathiques collègues m'apprend qu'une de mes récentes commandes de livres, vient d'être honorée. Il s'agit de Albergo Italia, de Guido Ceronetti, qu'un ami m'avait chaleureusement recommandé et là, j'oublie tout. Un moment de grâce commence...
A suivre...
Guido Ceronetti, Albergo Italia (Phébus, 2003)
00:06 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature: essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2011
Erri de Luca 1b
Bloc-Notes, 17 avril / Les Saules
Erri de Luca parle de Il peso della farfalla (Le poids du papillon) en italien et sans sous-titres, malheureusement...
Erri de Luca, Le poids du papillon (Gallimard, 2011)
13:51 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Erri de Luca, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; interview; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












