09/05/2012
Morceau choisis - Henri Michaux
Henri Michaux

Ralentie, on tâte le pouls des choses; on y ronfle; on a tout le temps; tranquillement, toute la vie. On gobe les sons, on les gobe tranquillement, toute la vie. On vit dans son soulier. On y fait le ménage. On n'a plus besoin de se serrer. On a tout le temps. On déguste. On rit dans son poing. On ne croit plus qu'on sait. On n'a plus besoin de compter. On est heureuse en buvant; on est heureuse en ne buvant pas. On fait la perle. On est, on a le temps. On est la ralentie. On est sortie des courant d'air. On a le sourire du sabot. On n'est plus fatiguée. On n'est plus touchée. On a des genoux au bout des pieds. On n'a plus honte sous la cloche. On a vendu ses monts. On a posé son œuf, on a posé ses nerfs.
Quelqu'un dit. Quelqu'un n'est plus fatigué. Quelqu'un n'écoute plus. Quelqu'un n'a plus besoin d'aide. Quelqu'un n'est plus tendu. Quelqu'un n'attend plus. L'un crie. L'autre obstacle. Quelqu'un roule, dort, coud, est-ce toi Lorellou?
Ne peut plus, n'a plus part à rien, quelqu'un.
Quelque chose contraint quelqu'un.
Soleil, ou lune, ou forêts, ou bien troupeaux, foules ou villes, quelqu'un n'aime pas ses compagnons de voyages. N'a pas choisi, ne reconnaît pas, ne goûte pas.
Princesse de marée basse a rendu ses griffes; n'a plus le courage de comprendre; n'a plus le cœur à avoir raison.
… Ne résiste plus. Les poutres tremblent et c'est vous. Le ciel est noir et c'est vous. Le verre casse et c'est vous.
On a perdu le secret des hommes.
Ils jouent la pièce en étranger. Un page dit Beh et un mouton lui présente un plateau. Fatigue! Fatigue! Froid partout!
Oh! Fagots de mes douze ans, où crépitez-vous maintenant?
On a son creux ailleurs.
On a cédé sa place à l'ombre, par fatigue, par goût du rond. On entend au loin la rumeur de l'Asclépiade, la fleur géante.
…ou bien une voix soudain vient vous bramer au cœur.
On recueille ses disparus, venez, venez.
Tandis qu'on cherche sa clef dans l'horizon, on est la noyée au cou, qui est morte dans l'eau irrespirable.
Elle traîne. Comme elle traîne! Elle n'a cure de nos soucis. Elle a trop de désespoir. Elle ne se rend qu'à sa douleur. Oh, misère, oh, martyre, le cou serré sans trêve par la noyée.
On sent la courbure de la terre. On a désormais les cheveux qui ondulent naturellement. On ne trahit plus le sol, on ne trahit plus l'ablette, on est la sœur par l'eau et par la feuille. On n'a plus le regard de son œil, on n'a plus la main de son bras. On n'est plus vaine. On n'envie plus. On n'est plus enviée.
On ne travaille plus. Le tricot est là, tout fait, partout.
On a signé sa dernière feuille, c'est le départ des papillons.
On ne rêve plus. On est rêvée. Silence.
On n'est plus pressée de savoir.
C'est la voix de l'étendue qui parle aux ongles et à l'os.
Enfin chez soi, dans le pur, atteinte du dard de la douceur.
On regarde les vagues dans les yeux. Elles ne peuvent plus tromper. Elles se retirent déçues du flanc du navire. On sait, on sait les caresser. On sait qu'elles ont honte elles aussi.
Epuisées, comme on les voit, comme on les voit désemparées!
Une rose descend de la nue et s'offre au pèlerin; parfois rarement, combien rarement. Les lustres n'ont pas de mousse, ni le front de musique.
Horreur ! Horreur sans objet!
Poches, cavernes toujours grandissantes.
Loques des cieux et de la terre, monde avalé sans profit, sans goût, et sans rien que pouvoir avaler.
Une veilleuse m'écoute. Tu dis, fait-elle, tu dis la juste vérité, voilà ce que j'aime en toi. Ce sont les propres paroles de la veilleuse.
On m'enfonçait dans des cannes creuses. Le monde se vengeait. On m'enfonçait dans des cannes creuses, dans des aiguilles de seringues. On ne voulait pas me voir arriver au soleil où j'avais pris rendez-vous.
Et je me disais: Sortirai-je? Sortirai-je? Ou bien ne sortirai-je jamais? Jamais? Les gémissements sont plus forts loin de la mer, comme quand le jeune homme qu'on aime s'éloigne d'un air pincé.
Il est d'une grande importance qu'une femme se couche tôt pour pleurer, sans quoi elle serait trop accablée.
A l'ombre d'un camion pouvoir manger tranquillement. Je fais mon devoir, tu fais le tien et d'attroupement nulle part.
Silence! Silence! Même pas vider une pêche. On est prudente, prudente.
On ne va pas chez le riche. On ne va pas chez le savant. Prudente, lovée dans ses anneaux.
Les maisons sont des obstacles. Les déménagements sont des obstacles. La fille de l'air est un obstacle.
Rejeter, bousculer, défendre son miel avec son sang, évincer, sacrifier, faire périr… Pet parmi les aromates renverse bien des quilles.
Oh, fatigue, effort de ce monde, fatigue universelle, inimitié!
Lorellou, Lorellou, j'ai peur… Par moments l'obscurité, par moments les bruissements.
Ecoute. J'approche des rumeurs de la mort.
Tu as éteint toutes mes lampes.
L'air est devenu tout vide Lorellou.
Mes mains, quelle fumée! Si tu savais… Plus de paquets, plus porter, plus pouvoir. Plus rien, petite.
Expérience: misère. Qu'il est fou le porte-drapeau.
… et il y a toujours le détroit à franchir.
Mes jambes, si tu savais, quelle fumée!
Mais j'ai sans cesse ton visage dans la carriole…
Avec une doublure de canari, ils essaient de me tromper. Mais moi, sans trêve, je disais: Corbeau! Corbeau! Ils se sont lassés.
Ecoute, je suis plus qu'à moitié dévorée; Je suis trempée comme un égout.
Pas d'année, dit grand-père, pas d'année où je vis tant de mouches. Et il dit la vérité. Il l'a dit sûrement… Riez, riez, petits sots, jamais ne comprendrez que de sanglots il me faut pour chaque mot.
Le vieux cygne n'arrive plus à garder son rang sur l'eau.
Il ne lutte plus, des apparences de lutte seulement.
Non, oui, non. Mais oui, je me plains. Même l'eau soupire en tombant.
Je balbutie, je lape la vase à présent. Tantôt l'esprit du mal, tantôt l'événement… J'écoutais l'ascenseur. Tu te souviens Lorellou, tu n'arrivais jamais à l'heure.
Forer, forer, étouffer, toujours la glacière-misère. Répit dans la cendre, à peine, à peine; à peine on se souvient.
Entrer dans le noir avec toi, comme c'était doux, Lorellou…
Ces hommes rient. Ils rient.
Ils s'agitent. Au fond ils ne dépassent pas un grand silence.
Ils disent là. Ils sont oujours ici.
Pas fagotés pour arriver.
Ils parlent de Dieu, mais c'est avec leurs feuilles.
Ils ont des plaintes. Mais c'est le vent.
Ils ont peur du désert.
… Dans la poche du froid et toujours la route aux pieds.
Plaisirs de l'Arragale, vous succombez ici. En vain tu te courbes, tu te courbes, son de l'olifant, on est plus bas, plus bas…
Dans le souterrain, les oiseaux volèrent après moi, mais je me retournai et dis : Non. Ici, souterrain. Et la stupeur est son privilège.
Ainsi je m'avançai seule, d'un pas royal.
Autrefois, quand la Terre était solide, je dansais, j'avais confiance. A présent, comment serait-ce possible? On détache un grain de sable et toute la plage s'effondre, tu sais bien.
Fatiguée on pèle du cerveau et on sait qu'on pèle, c'est le plus triste.
Quand le malheur tire son fil, comme il découd, comme il découd!
Poursuivez le nuage, attrapez-le, mais attrapez-le donc, toute le ville paria, mais je ne pus l'attraper. Oh, je sais, j'aurais pu... un dernier bond... mais je n'avais plus le goût. Perdu l'hémisphère, on n'est plus soutenue, on n'a plus le coeur à sauter. On ne trouve plus les gens où ils se mettent. On dit : Peut-être. Peut-être bien, on cherche seulement à ne pas froisser.
Ecoute, je suis l'ombre d'une ombre qui s'est enlisée.
Dans tes doigts, un courant si léger, si rapide, où est-il maintenant... où coulaient des étincelles? Les autres ont des mains comme de la terre, comme un enterrement.
Juana, je ne puis rester, je t'assure. J'ai une jambe de bois dans la tirelire à cause de toi. J'ai le coeur crayeux, les doigts morts à cause de toi.
Petit coeur en balustrade, il fallait me retenir plus tôt. Tu m'as perdu ma solitude. Tu m'as arraché le drap. Tu as mis en fleur mes cicatrices.
Elle a pris mon riz sur mes genoux. Elle a craché sur mes mains.
Mon lévrier a été mis dans un sac. On a pris la maison, entendez-vous, entendez-vous le bruit qu'elle fit, quand à la faveur de l'obscurité, ils l'emportèrent, me laissant dans le champ comme une borne. Et je souffris grand froid.
Ils m'étendirent sur l'horizon. Ils ne me laissèrent plus me relever. Ah ! Quand on est pris dans l'engrenage du tigre...
Des trains sous l'océan, quelle souffrance ! Allez, ce n'est plus être au lit, ça. On est princesse ensuite, on l'a mérité.
Je vous le dis, je vous le dis, vraiment là où je suis, je connais aussi la vie. Je la connais. Le cerveau d'une plaie en sait des choses. Il vous voit aussi, allez, et vous juge tous, tant que vous êtes.
Oui obscur, obscur, oui inquiétude. Sombre semeur. Quelle offrande! Les repères s'enfuirent à tire d'aile. Les repères s'enfuient à perte de vue, pour le délire, pour le flot.
Comme ils s'écartent, les continents, comme ils s'écartent pour nous laisser mourir! Nos mains chantant l'agonie se desserrèrent, la défaite aux grandes voiles passa lentement.
Juana! Juana! Si je me souviens... Tu sais quand tu disais, tu sais, tu le sais pour nous deux, Juana! Oh! Ce départ! Mais pourquoi? Pourquoi? Vide? Vide, vide, angoisse; angoisse, comme un seul grand mât sur la mer.
Hier, hier encore; hier, il y a trois siècles; hier, croquant ma naïve espérance; hier, sa voix de pitié rasant le désespoir, sa tête soudain rejetée en arrière, comme un hanneton renversé sur les élytres, dans un arbre qui subitement s'ébroue au vent du soir, ses petits bras d'anémone, aimant sans serrer, volonté comme l'eau tombe...
Hier, tu n'avais qu'à étendre un doigt, Juana; pour nous deux, pour nous deux, tu n'avais qu'à étendre un doigt.
Henri Michaux, La ralentie - Plume/Lointain intérieur (coll. Poésie/Gallimard, 2007)
09:30 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
07/05/2012
Morceaux choisis - Thomas Sanchez
Thomas Sanchez

Tout est désormais noir et blanc dans mon atelier. Il est sans texture ni saturation. Je rampe continuellement vers toi dans ma peinture. Je raie, je barre, je rature. Quand on ne vit que dans le souvenir, la vie se meurt. Seul toute la journée, je brosse la toile avec mon pinceau pour t'atteindre, mais c'est comme si je faisais l'amour avec des mains attachées. J'ai besoin de sentir ta chair, de glisser mon corps sur le grain, de tatouer la toile. J'ai l'énergie de créer au milieu de cet anéantissement. Un peintre doit conquérir ses yeux. Que je me souviens bien de tes yeux...
Je suis en train de perdre les miens, car je juge frivole de faire de l'art en période de guerre, de peindre un poisson rouge dans un bocal, un bras emporté par une grenade, des fleurs dans un vase, un champ de blé traversé par des chars. Tes yeux s'lèvent du champ dévasté, lui redonnent forme. L'ironie veut qu'après la destruction, seul l'art subsiste. Le travail de l'artiste est acte de guérison. Je dois lutter contre l'inertie de la désespérance, me contraindre à regarder à l'intérieur du volcan, à voir à nouveau la couleur, à reconquérir mes yeux, à observer cette éruption de soufre qu'est la guerre. Mais comment voir une haine si ancienne dans une lumière neuve? Je dois trouver un moyen, découvrir une irrévérencieuse invention. Personne ne sait que je m'efforce de construire à partir du chaos, d'ordonner la destruction de mon coeur, mon effondrement sans toi. La réalité me presse, car chaque guerre est personnelle, chaque bataille est intime.
Thomas Sanchez, Le jour des abeilles (coll. Folio/Gallimard, 2002)
21:07 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
03/05/2012
Morceaux choisis - Erri de Luca
Erri de Luca

J'ai beaucoup parlé seul. Soudain une phrase sortait de ma bouche. Je la disais à la maison qui attendait ma voix. J'ai vécu si longtemps à l'intérieur d'elle qu'un échange s'est établi entre ses pierres et moi. Je sens que je fais partie d'une nature minérale commune. Son silence est le mien, il est intérieur. Le silence du dehors, de la campagne, total certains soirs de brouillard, ne ressemble pas au nôtre capable d'absorber les sons, quand même ma respiration et les battements de mon coeur se dissipent et que je ne les perçois plus. La maison me répond. Sa voix n'appartient pas aux hommes: elle jaillit de la pierre volcanique des murs, née au temps où l'écorce terrestre était en fusion et la matière mère de toutes choses. C'est une voix qui a bouillonné dans les fleuves de feu jaillissant en gerbes de la mare des cratères. Quand le vent balaie sa poussière, l'asperge de gouttes grises et bleues, la pierre murmure des comptines. Parfois c'est un timbre sonore où je distingue des syllabes incohérentes, d'autres fois je comprends des phrases entières. Mon oreille s'est exercée à écouter les pierres.
Je les ai extraites de la terre, je les ai taillées avec mon ciseau, en forçant la fissure, comme si c'étaient des noix. Un éclatement, un souffle, et elles s'ouvraient à demi, l'air passait pour la première fois sur les pores de la pierre, à l'intérieur. Les pierres sont des huîtres pour ceux qui savent les toucher. Je les ai équarries, j'en ai fait des sentiers, des haies, des sièges, me servant des aspérités de l'une pour l'encastrer dans l'autre. Je les rapprochais suivant une géométrie qu'elles présentaient elles-mêmes, chacune prête à n'accepter qu'une seule autre forme, comme par destin. J'avais la mémoire des aspérités et je prenais dans le tas précisément celle qui allait s'ajuster avec un bruit de mains qui se joignent. Pierre noire opaque qui resplendissait entre les doigts, pleine, lourde, au relief dur et pourtant docile pour celui qui le comprend.
Autrefois, je voyais des lettres éparses entre les branches d'un arbre, sur les vitres mouillées, tracées par le vol des mouches. J'étudiais les alphabets de la Méditerrannée pour élargir le catalogue des signes et comprendre toute cette semence d'écriture. Dans les points étoilés de l'univers nos ancêtres ont vu des figures, des bêtes, des chariots, moi je découvrais des lignes d'alphabets. Le monde était écrit, le premier homme n'inventait pas les noms, il les lisait. Sur la matière demeurent les traces résiduelles de cette rédaction, des monogrammes qui ont résisté à un effacement général. La voix rauque de la maison parlait avec ces lettres, prononçait des syllabes simples. Les soirs de tempête, quand je redoutais la force du ciel sur les animaux et les arbres, les murs marmonnaient une complainte et m'apaisaient.
Erri de Luca, Acide - Arc-en-Ciel (coll. Foléio/Gallimard, 2011)
image: Villa Poncini (Curio, Tessin)
07:23 Écrit par Claude Amstutz dans Erri de Luca, Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2012
Morceaux choisis - Graham Greene
Graham Greene

Le docteur ouvrit le tiroir de son bureau. A l'intérieur, il y avait une photographie de femme. Elle gisait là, dans l'attente, cachée aux regards étrangers, protégée de la poussière, toujours présente lorsque le tiroir s'ouvrait.
- Cette chambre me manquera... où que je sois. Vous ne m'avez jamais parlé de votre femme, docteur. Comment est-elle morte?
- Maladie du sommeil. Elle passait beaucoup de temps dans la brousse, au début pour essayer de persuader les lépreux de venir se faire soigner. Nous n'avions pas, alors, contre la maladie du sommeil, les remèdes efficaces que nous avons à présent. Les gens meurent trop vite.
- Mon espoir était de finir dans le même bout de terre qu'elle et vous. Nous aurions composé un coin des athées, à nous trois.
- Je me demande si vous seriez qualifié pour cela.
- Pourquoi pas?
- Vous êtes trop tourmenté par votre manque de foi, Querry. Vous le triturez sans arrêt, comme un bobo dont vous voudriez vous débarrasser. Je me contente du mythe, vous pas... vous voudriez être croyant ou incroyant.
- Quelqu'un appelle dehors, dit Querry. J'ai cru un moment que c'était mon nom. Mais quel que ce soit le nom que l'on crie, nous imaginons toujours que c'est le nôtre. Il ne s'en faut que d'une syllabe pour que ce soit le même. Nous rapportons tout à nous.
- Vous avez dû connaître une foi immense pour qu'elle vous manque à ce point.
- J'ai avalé d'un trait tous leurs mythes, si vous appelez cela la foi. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Maintenant, lorsque je relis ce passage, son symbolisme m'apparaît très évident, mais comment espérer que de pauvres hommes habitués à manier leurs filets et leurs barques aient reconnu le symbole? Ce n'est qu'à mes moments de superstition que je me rappelle avoir renoncé au sacrement avant d'avoir renoncé à la foi et les prêtres y trouveraient sûrement un rapport. Je suppose que la foi est une sorte de vocation et que la plupart des hommes n'ont pas de place, en leur cerveau ou en leur coeur, pour deux vocations. Si nous croyons vraiment à quelque chose, nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas? Il nous faut aller toujours plus loin. Autrement la vie, lentement, effrite et épuise la foi. Mon architecture était statique. On ne peut pas plus être un demi-croyant qu'un demi-architecte.
- Voulez-vous dire que même cette moitié, vous avez cessé de l'être?
- Sans doute ma vocation n'était-elle pas assez forte, dans un sens comme dans l'autre, et le genre de vie que j'ai mené a tué les deux. Il faut qu'une vocation soit très solide pour résister au succès. Le prêtre en vogue et l'architecte en vogue... leurs talents facilement tués par le dégoût.
- Le dégoût?
- Le dégoût de la louange. Comme cela vous écoeure, docteur, à force de stupidité! Les mêmes gens qui détruisaient mes églises glorifiaient ensuite le plus bruyamment ce que j'avais construit. Les livres qu'ils écrivaient sur mes oeuvres, les pieuses intentions qu'ils m'attribuaient, suffisaient à me donner la nausée devant ma planche à dessin. Il aurait fallu plus de foi que je n'en avais pour résister à cela...
- La plupart des hommes semblent supporter le succès assez agréablement. Mais vous, vous êtes venu ici.
- Je crois que je suis guéri d'à peu près tout, fût-ce du dégoût. J'ai été heureux ici...
Graham Greene, La saison des pluies (Laffont, 1960)
image: Léproserie - Nacopa / Mozambique (santegidio.org)
07:47 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2012
Morceaux choisis - Clémence Boulouque
Clémence Boulouque

Les mots dessinent les amandes. Les livres aussi. Le Livre. Je tourne les pages de la Bible, cherche dans les versets un creuset de mémoire. Pas seulement les rites, mais aussi les premières traces de profane, la célébration de nos jours, de la nature, du miel, le lait, les rives à franchir, les terres promises, le monde d'ici et le monde à venir. Ce n'est pas un fantasme de pureté, une caution de tradition que je guette dans les textes sacrés, mais l'âpreté des paysages du Moyen-Orient, le creuset des siècles, les échos d'une célébration de la vie, ici, en attendant, peut-être... En attendant.
En hébreu, l'amande a pour nom shaked. Une désignation est composée des lettres shin, kaf et dalet. Les lettres ont des significations précises, elles correspondent à des mots: shin signifie "dent", kaf "paume de main" et dalet "porte", "ouverture". Les lettres hébraïques ont également une valeur numérique précise, mais cet exercice de guematria, ce rapport entre les mots et les lettres, ne tomberait pas juste si je m'y livrais ici. On peut tout interpréter de façon légère, souriante et alerte: c'est vif, parfois élégant, souvent n'importe quoi. Ce que je dessine ici, ce ne sont que des horizons, des grands traits pour rêver. L'amande, qui irait de la main à la bouche, qui ouvrirait vers des ailleurs. L'amande, qui se glisse dans les premières esquisses de l'humanité.
Elle apparaît à quatre reprises dans le texte biblique, le fruit étant à chaque fois lié au motif de l'élection ou, tout au moins, à un témoignage de magnificence, de déférence. Chacune de ces occurences fait écho dans ma vie. Ce ne sont pas des références coudées, d'improbables liens, mais des résonances. C'est ainsi.
Clémence Boulouque, Au pays des macarons (coll. Le Petit Mercure/Mercure de France, 2005)
09:13 Écrit par Claude Amstutz dans Clémence Boulouque, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2012
Morceaux choisis - Ernest Pépin
Ernest Pépin

Ernest Pépin, Babil du songer (Ibis Rouge, 1997)
image: Sainte Anne/Guadeloupe (http://alainfoix.com)
19:50 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2012
Morceaux choisis - Luc Ferry
Luc Ferry

Sans ce sentiment que la vie passe et qu'il presse, on ne voit pas bien ce qui nous inciterait à nous lever le matin, à travailler, à tenter d'agir sur le monde, à hiérarchiser nos priorités et nos passions. Il se pourrait en dernière instance que ce soit cette réconciliation avec notre condition de mortels, cette acceptation de la finitude qui, d'une part, donne de l'intensité à l'existence et qui, de l'autre, puisse conférer à l'instant présent le statut de fragment d'éternité, nous inciter à ne pas nous presser afin de nous réjouir du simple fait d'exister, du fait même que les choses soient. Il faut avoir la mort en tête pour que le charme gratuit de l'existence nous apparaisse en tant que tel, pour que l'on puisse prendre plaisir au simple fait d'exister. Ces deux exigences, en apparence contradictoires, sont en fait indissociables et toutes deux dérivent de la conscience de la finitude. C'est parce qu'il y a urgence que nous ne laissons pas filer le temps, mais c'est aussi parce qu'il nous est compté, et que nous le savons, que nous pouvons parfois le laisser filer volontairement. Il faut tenir ensemble ces deux mouvements si l'on ne veut pas que la mort, déniée, s'empare subrepticement de la vie derrière notre dos.
Luc Ferry, L'anticonformiste - Une autobiographie intellectuelle / entretiens avec Alexandra Laignel-Lavastine (Denoël, 2012)
20:19 Écrit par Claude Amstutz dans Le monde comme il va, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; philosophie; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2012
Morceaux choisis - Katherine Pancol
Katherine Pancol
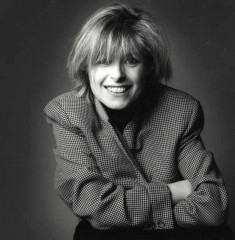
Le 5 mai 1998.
J'ai le coeur brisé, Jonathan... Et je ne suis pas sûre que les morceaux se soient recollés. Parce que j'ai eu si mal, si mal que j'ai cru en mourir... Parce qu'un autre que moi, mon semblable, mon même sang, mon même souffle, ma même peau, mes mêmes cheveux, mes mêmes dents, mon même sourire, en est mort tout debout, lui. Parce que, je vous l'ai dit, je veux aimer la vie, malgré tout.
Le soleil de printemps qui rebondit à mes pieds et me force à me lever... Les bains du petit matin quand la ville s'ébroue à peine. Les galets polis sur la plage que mes plantes de pied ont apprivoisés. Le bruit des vagues qui font chanter les galets quand elles se retirent. Ma peau toute salée que je lèche à grands coups de langue. Les fromages de Madame Marie. Les gâteaux de Monsieur Lainé. Les moules-frites de Laurent et Josepha. La présence tendre et bourrue de Nathalie. Les pinceaux blancs du phare, la nuit, ma seule compagnie.
Je chasse toutes les autres. Je les chasse tous. Je les désire, je les convoque, je me jette à leur cou, je leur fais des noeuds partout et... je les tranche. D'un seul coup. Sans avertissement. Ils durent ce que durent le désir physique, l'envie de frotter ma peau contre une autre, de se faire étreindre, entourer, fouiller, retourner... Comme le tracteur dans la terre... Ou plus doucement... Comme les lunettes cerclées embuées de tendresse.
Je hais la douceur, la tendresse, la passion quand elles ne viennent pas de lui... De cet homme qui s'est éloigné, un beau matin, en bateau sur le port. Que j'ai regardé partir en serrant la main d'un autre dans ma main. Un autre qui aimait aussi cet homme plus que tout. Cet homme qui nous abandonnait. Pour qui? Pour quoi? Pourquoi, Jonathan? Pourquoi est-il parti? Je n'ai jamais compris.
Alors je préfère rester seule. Dans ma chambrette, face à la mer. Avec mes livres, les mouettes qui me raillent, le vent et la tempête. Ces compagnons-là me vont bien. Ils ne me demandent rien. Je ne leur donne rien. Un amour commence à exister quand chacun offre à l'autre le fond de ses pensées, les secrets les plus verrouillés. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'échange de peaux, de désir immédiat, et l'on se retrouve, détroussé, comme après le passage d'un cambrioleur.
Gardez votre secret. Je garderai le mien. Souvenez-vous de la vieille femme et du curé, dans Maison des autres.* Les secrets ne sont pas faits pour être échangés avec des inconnus. Elle en est morte.
Qu'est-ce que je sais de vous? Et vous voulez me raconter votre vie! Sans façon, Jonathan! Restons-en au rayon des livres, prudemment. Il y en a plein d'autres magnifiques qui ne nous déchireront pas les entrailles, qui nous berceront d'illusions, ou nous infuseront dans des douleurs plus tièdes, plus lointaines.
Pein d'autres qui nous feront voler très haut, loin de nos pourquoi.
Si pouvoir - équivalait à vouloir -Ténu serait - le Critère -C'est l'ultime de la Parole -Que l'impuissance à dire. Emily DickinsonJe suis dans cette impuissance-là.
Kay
Katherine Pancol, Un homme à distance (coll. Livre de Poche, 2004)
07:28 Écrit par Claude Amstutz dans Katherine Pancol, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2012
Morceaux choisis - Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi, extrait du Chant 34 - Anthologie bilingue de la poésie italienne (Bibliothèque de la Pléiade/Gallimard, 1994)
image: dominique.decobecq.perso.neuf.fr/LegenetdeLeopardi.html
08:04 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2012
Morceaux choisis - Jean-Louis Kuffer
Jean-Louis Kuffer

Il n'y a pas de temps mort: voilà ce que me dit cette croix clouée en moi. Voici le jour se lever sur le monde des gens ordinaires, et nous allons tenter de vivre de nouveaux ou de nouvelles après-midi. Le passé nous attend dans la forêt de la ville où nous allons retourner tout à l'heure pour gagner notre vie en dignes gens ordinaires, et l'éternelle matinée sera aux affaires et ce seront ensuite de belles ou de beaux après-midi, ce sera selon, en attendant le retour des enfants...
Je vis, une fois de plus, à l'instant, l'émouvante beauté du lever du jour. L'émouvante beauté d'une aube d'automne aux verts passés et aux bleus tendres. L'émouvante beauté de l'or du temps qui ne rapporte rien. L'émouvante beauté des gens le matin. L'émouvante beauté d'une pensée douce flottant comme un nuage immobile sur le lac d'étain, tandis que le ciel vire au rose. L'émouvante beauté de ce que ne voit pas l'aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret.
Je me dis souvent qu'il n'y a rien de beau ni d'émouvant dans la vie de trop de gens piétinés, mais qu'en sais-je? Que savons-nous des gens me dis-je à l'instant en traversant le selva oscura de la ville aux affaires? Qu'aurais-je jamais su de Grossvater et qu'aurons-nous su de nos pères et de nos mères? Tout à l'heure ils vont se retrouver à leurs guichets de gens ordinaires. L'émouvante beauté de ces gens. Regarde ta mère traverser la rue du Temps. Regarde ton père la regarder, ce soir-là dans un bar. Regardez, les enfants: regardez voir...
Jean-Louis Kuffer, L'enfant prodigue (D'Autre Part, 2011)
image: Lucienne Kuffer, Peinture (2009)
00:35 Écrit par Claude Amstutz dans Jean-Louis Kuffer, Littérature francophone, Littérature suisse, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












