22/09/2011
Jacques Chessex
 Jacques Chessex, Revanche des purs (Grasset 2008)
Jacques Chessex, Revanche des purs (Grasset 2008)
On oublie trop souvent que Jacques Chessex - outre ses romans et récits – est aussi un des plus grands poètes d’expression française de son temps. Dans ce recueil, lisez Revanche des purs, Faire-part, Cours furet ou Le migrateur pour vous en persuader, sans oublier que l’un de ses plus beaux poèmes nous est donné dans son récit Pardon mère - paru au même moment chez Bernard Grasset également - page 190...
08:48 Écrit par Claude Amstutz dans Jacques Chessex, Littérature francophone, Littérature suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2011
Le poème de la semaine
Jean-Pierre Schlunegger
Ma plus douce lueur c'est ton corps de feuillageEt sa limpidité prise aux sources du ventOdeur de pomme brune et de renard filantQuand le poids d'une bouche incline vers l'orage Ma plus douce lueur ta peau fière et sauvagePays de l'innocence où ma main va rêvantMa plus douce lueur mon plus tendre sarmentQuand l'amour et la nuit me soufflent ton image Robe de mon amour marronnier du soleilEclair illuminant la voûte du sommeilEn grappes rouge-feu tu flambes sous la pluie Mais quand l'automne triste aux route de bois mortAbat ses herses de malheur nous sommes fortsMa plus douce lueur humaine mon amie Quelques traces de craie dans le ciel,Anthologie poétique francophone du XXe siècle
06:39 Écrit par Claude Amstutz dans Jean-Pierre Schlunegger, Littérature francophone, Littérature suisse, Quelques traces de craie dans le ciel - Anth | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; poésie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2011
Guido Ceronetti 1/2
Bloc-Notes, 18 septembre / Les Saules
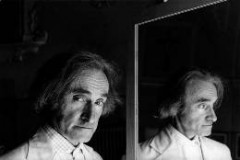
Guido Ceronetti est un écrivain tout à fait inclassable. A la fois poète, philosophe, singulier observateur du monde qui l'entoure, laissant surgir - quand il se peut - les flammes de la passion qui l'interrogent à travers les siècles, il signe, avec La patience du brûlé, une variation sur les thèmes abordés dans Albergo Italia et Le voyage en Italie, introduisant cependant des éléments nouveaux recueillis au fil de ses vagabondages: fragments de journal, carnets, graffitis, citations, tout un ensemble de perceptions qui élargissent davantage encore son ouverture au monde. Celui des idées, des arts, des hommes avec des instantanés que jamais ne traverse l'indifférence. Avec quelle hâte on fait les livres, à présent! Leur première idée est déjà mise en page, la première édition est déjà la seconde, avant même qu'ils ne soient reliés, les principaux journaux en reçoivent par fax les pages les plus caressantes. Je jette un cri dans ce naufrage car je tiens à me distinguer, en me noyant.
Une lecture superficielle tendrait à réduire Guido Ceronetti à un pessimiste grognon. Un peu facile car, de même que dans la plupart de ses autres oeuvres traduites en français - outre celles déjà citées: Le silence du corps, Ce n'est pas l'homme qui boit le thé mais le thé qui boit l'homme, Une poignée d'apparences, Le lorgnon mélancolique - on devrait plutôt parler d'un inquiet cherchant des traces d'amour dans l'art comme dans la vie, là où généralement, renouant avec un passé pas nécessairement lpintain, il n'y en a guère encore.
Ses impressions sur les villes d'Italie - Florence, Rome, Milan ou Bari - sont toujours aussi sévères: Ce n'est pas le smog qui perd les villes, qui les ronge, mais la haine. Généreux en revanche, il l'est pour Trévise et Urbino par exemple, dont il nous partage une vision bienheureuse: Ce que l'on voit du bourg par cette fenêtre équilibrée, arbres, briques anciennes bien disposées, tuiles rouges. Rien de sinistre, d'agressif, de brutalement matériel. (...) Les collines sortent du brouillard, plus belles encore vues à travers la grille. Paysage de peintres du XVIe, pour un instant, en fermant les yeux.
Au fil de ses carnets de voyage, toute sa passion souterraine émerge quand il évoque Eugenio Montale, Martin Heidegger, Egon Schiele. Deux portraits restent gravés dans ma mémoire: celui de Bernadette Soubirous et celui de Louis-Ferdinand Céline. Sur la première, il note: Chez Bernadette, il y a la sainteté profonde, la candeur absolue, une très haute qualité contemplative; elle fut un moyen de transmission authentique du divin, de sa vision jusqu'aux dernières gouttes de sa souffrance. A propos du second, j'apprécie l'angle de vue inhabituel: Céline a été le plus grand écrivain de notre époque, bien que les ténèbres aient été sur le point, entre 1937 et 1944, de l'engloutir et de le salir misérablement. L'attaque fut virulente, mais je vois, je reconnais dans son visage les années de Meudon la fatigue terrifiante d'un homme qui a traversé toutes les ténèbres en traînant derrière lui, dans une implorante boîte en fer-blanc, un peu de lumière sauvée, quelques éclats de pure compassion humaine. Sa faute sera, au Jugement, beaucoup plus légère que ce tabernacle roulant dans la nuit qu'il a endurée, et pour peu qu'il soit possible, vaincue.
Son état de révolte demeure terriblement présent face à la catastrophe de Tchernobyl ou l'impitoyable dégradation des vestiges de la mémoire: Je crie salauds, je m'en contrefous de votre Italie grande puissance industrielle qui plante des arbres de morts à travers le monde, une puissance imaginaire et vile, inventée par les délires des esclavagistes de la nécroéconomie! Ce que je ne peux pas supporter, c'est qu'à la place de cette péninsule qui dans la Méditerranée élevait des sanctuaires grecs étrusques chrétiens et gnostiques en les couvrant de mousses réparatrices, au bout d'un demi-siècle de paix aux frontières ne soit couché qu'un bourbier infect, de déshonneur et de crime.
Mais au coeur du scepticisme de Guido Ceronetti face à la modernité, quelques perles rares fondues au centre de l'homme, éclairent la route de sa clairvoyante émotion: Une silhouette de femme à San Marino dont la clarté persiste une fois la lumière éteinte, un aveugle qui pose son regard sur la condition humaine comme sur une mer immense et infiniment triste, un souvenir d'Arletty, un écrin de lumière... La paix retrouvée enfin, dans les églises qui, même vides, protègent des laideurs extérieures.
Pour en finir avec La patience du brûlé, je citerai l'épigraphe consolatrice que son auteur choisit pour entreprendre ses voyages et qui guide désormais mes propres pas: Emu par l'amour du pays natal, je rassemblai les feuilles éparses... (Dante, La Divine Comédie - L'enfer)
Inutile d'ajouter qu'immergé dans l'oeuvre toute entière de Guido Ceronetti qui me colle à la peau, il m'a fallu ajouter - avec joie - son nom à celui de mes écrivains préférés, dans Le questionnaire Marcel Proust. Y figure aussi, aujourd'hui, au rang des poètes, Giacomo Leopardi, que Guido Ceronetti m'a donné envie de relire avec davantage de ferveur et d'attention...
Guido Ceronetti, La patience du brûlé / Carnets de voyage 1983-1987 (Albin Michel, 1995)
17:00 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne, Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature: essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
Guido Ceronetti 2/2
Bloc-Notes, 18 septembre / Les Saules
Après avoir déjà publié un extrait de La patience du brûlé - dans la rubrique La citation du jour - je vous partage ci-dessous avec beaucoup de plaisir quelques facettes de Guido Ceronetti, glânées au fil d'une lecture jubilatoire:
La compassion pour le genre humain, que pourrais-je chercher d'autre? Le destin de l'humanité est en bonnes mains: sanguinaires, crétins, paranoïaques, universitaires, banquiers, tenanciers de tripots, médecins, optimistes, sous-traitants du crime, foreurs, pontifes; ils obéissent tous à un obscur, impénétrable maître. (p. 63)
*
Le livre est une nuit, le lecteur la lanterne, le porteur de lumière. La plupart des livres n'ont pas de belles endormies, ils n'ont pas de secret, ils servent à peu de choses, ils ont un usage limité et pratique; mais quelques-uns abritent le compagnon de la Vallée de l'Ombre; après les avoir lus, on les met là, pour les heures graves, pour les exercices de profondeur, et plus on les manie, plus on en comprend intimement quelque chose, moins on est seul, moins la mort sera dépourvue de mains qui nous orientent, avec sûreté, et qui veillent la peur. (p. 113-114)
*
Aucune musique de grand compositeur (en dehors de l'orgue d'une église) ne peut avoir des effets psychologiques aussi forts, aussi tendres que, parfois, la plus pauvre des chansons, s'il y a la voix, la maison, la rue. La femme qui chante fait toujours partie du mystère érotique, le sien est un appel et une attente, c'est pourquoi il ensorcelle, il donne envie de monter les escaliers à la hâte et d'ouvrir la porte derrière laquelle la voix se cache. Mais nous parlons du passé, aussi bien en Orient qu'en Occident. Elles ont été assassinées et jetées dans des tas d'ordures, comme un butin invendable, les chansons... (p. 165)
*
Un triste voile a recouvert les choses et ce n'est pas l'illusion fugitive d'une âme mélancolique: il y a quelque chose qui ressemble à une baisse d'imprégnation d'amour. On parle de tout d'une autre façon et si l'on n'apprend pas ce langage, notre prise sur le monde diminue. De quelle chose (une fenêtre, une arcade, une figure peinte, une femme, une idée...) parle-t-on encore, poussés par un attachement ému, par la passion de la profondeur, comme si on voulait la caresser en prononçant son nom, en poursuivant dans le langage le secret de sa manifestation? (p.167-168)
*
La poésie, qui était obscure, est devenue plus obscure encore: elle craint que l'on ne comprenne trop bien qu'à travers elle quelqu'un a aimé, que des lieux et des noms vivants ont brûlé de passion... (p. 168)
*
Je ne travaille pas, non, je ne fais absolument rien. Des envies de changement je n'en ai pas, je suis bien comme ça. Pour manger, une mouche par jour me suffit, et je pourrais même m'en passer. Je n'ai pas besoin de l'élever ni de l'attraper ni d'attendre qu'elle me tombe dans la bouche par hasard: une amie de la Caritas m'en laisse une chaque jour à sept heures, comme les laitières d'autrefois, vivante, sous un verre, près de ma clavicule. Son bourdonnement désespéré ne me réveille pas puisque je ne dors jamais, bien qu'il me soit facile de faire semblant de dormir, sans faire le moindre mouvement. Ce bourdonnement, au bout d'un moment, me fait pitié, il me rappelle trop les maisons, j'enfile une carte postale sous le verre et la mouche, reconnaissante, entre aussitôt dans ma bouche. Parfois je la reprends, je me la mets dans l'oeil et je la regarde vieillir. Une mouche, entre sept et dix-neuf heures, vieillit tellement qu'on peut la cracher sans la regretter. (p. 272)
*
J'ai aimé le mimosa, l'arbre du mimosa tout entier, dans sa brève floraison, j'aime toujours énormément les chrysanthèmes, que je dois m'acheter, personne ne m'offrirait de chrysanthèmes puisqu'une idée reçue d'une immense stupidité les associe honteusement à la mort et aux cimetières. (p. 276-277)
*
C'est un mal moderne: confier au livre tout ce que l'on a à répandre, en bien et en mal, de médiocre et de sublime. Même les plus crétins sentent la gravité de ce besoin et rêvent de publier, et quand ils y arrivent ils sont ivres comme la recrue qui, après la visite, croit avoir défloré le bordel. (p.337-338)
*
Colorés sont les poètes: Leopardi est rose pâle, Pétrarque blanc, Dante ocre, Montale jaune clairet comme un vin blanc, Campana est rouge et violet, Rimbaud est noir, Baudelaire or, Mallarmé vert et jaune, Valéry vert petit pois, Shakespeare est violet, Eschyle vert, Sophocle jaune, Pétrone est couleur de pourpre, Racine châtain clair... (p. 430)
*
J'ai l'impression d'être un pélerin sans pélerinage, un croisé sans croisade, une coque de bateau ensablé. (p. 452)
Guido Ceronetti, La patience du brûlé / Carnets de voyage 1983-1987 (Albin Michel, 1995)
17:00 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Charles Baudelaire, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne, Paul Valéry | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2011
La citation du jour 1b
Giacomo Leopardi
En complément à cette citation de Giacomo Leopardi, voici le magnifique poème A Silvia, lu par Vittorio Gassman. Vous pouvez en trouver le texte en traduction ci-dessous:
Quand la beauté brillait
Dans tes yeux fugitifs et riants,
Et que, pensive et gaie, tu gravissais
Le seuil de la jeunesse ?
Sonnaient les calmes
Voûtes, et les rues alentour,
À ta chanson sans fin,
Alors qu’assise à ton œuvre de femme
Tu t’appliquais, heureuse
De ce vague avenir que tu rêvais en toi.
C’était mai plein d’odeurs, et tu aimais
Passer ainsi le jour.
Parfois abandonnant
Les bien-aimées études, les pages fatiguées,
Où mon tout premier âge
Et le meilleur de moi se dissipaient,
Du haut des balcons du palais paternel
Je tendais mon oreille au son de ta voix
Et de ta main rapide
Qui parcourait l’âpre toile.
Je contemplais le ciel serein,
Les rues dorées et les vergers,
Là-bas la mer, au loin, et là les monts,
Langue mortelle ne dit pas
Ce qu’au sein j’éprouvais.
Quelles pensées de douceur,
Quels espoirs et quels cœurs, ma Silvia !
Tels alors nous paraissaient
La vie humaine et le destin !
Quand je revois une telle espérance,
Une passion m’oppresse,
Acerbe et désolée,
Et j’en reviens à souffrir de ma détresse.
O nature, nature,
Pourquoi ne tiens-tu pas
Ce que tu promettais alors ? Pourquoi
Te moques-tu de tes enfants ?
Avant que l’hiver même eût desséché les feuilles,
Toi, frappée, vaincue d’un mal obscur,
Tu périssais, fillette. Et tu n’as point connu
La fleur de tes années,
Ton cœur ne s’est ému
Sous la tendre louange de tes cheveux de jais,
De tes yeux amoureux et craintifs,
Et près de toi tes amies, aux jours de fête,
D’amour n’ont pas parlé.
Bientôt mourait aussi
Ma suave espérance : à mes années
Les destins refusèrent aussi
La jeunesse. Ah ! comme,
Comme tu t’es enfuie,
Chère compagne de mon jeune âge,
Mon espérance pleine de larmes !
C’est donc cela, le monde ? Cela, l’amour,
Et les plaisirs, les aventures, les travaux
Dont nous avions tant devisé ensemble ?
C’est là le sort du peuple des mortels ?
À peine parut le vrai
Que tu tombas, fragile; et de la main
La froide mort près d’un tombeau désert
Tu désignais au loin.
Giacomo Leopardi, Chants, in: Anthologie bilingue de la poésie italienne (Bibliothèque de La Pléiade/Gallimard, 1994)
sur: http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2006/03/_posie_dun_jour.html
08:10 Écrit par Claude Amstutz dans La citation du jour, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature; poésie; vidéo |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2011
Le poème de la semaine
René Char
Rivière trop tôt partie,d'une traite, sans compagnon,Donne aux enfants de mon paysle visage de ta passion. Rivière où l'éclair finitet où commence ma maison,Qui roule aux marches d'oublila rocaille de ma raison. Rivière, en toi terre est frisson,soleil anxiété.Que chaque pauvre dans sa nuitfasse son pain de ta moisson. Rivière souvent punie,rivière à l'abandon. Rivière des apprentisà la calleuse condition,Il n'est vent qui ne fléchisseà la crête de tes sillons. Rivière de l'âme vide,de la guenille et du soupçon,Du vieux malheur qui se dévide,de l'ormeau, de la compassion. Rivière des farfelus,des fiévreux, des équarrisseurs,Du soleil lâchant sa charruepour s'acoquiner au menteur. Rivière des meilleurs que soi,rivière des brouillards éclos,De la lampe qui désaltère l'angoisseautour de son chapeau. Rivière des égards au songe, rivière qui rouille le fer,Où les étoiles ont cette ombrequ'elles refusent à la mer. Rivière des pouvoirs transmiset du cri embouquant les eaux,De l'ouragan qui mord la vigneet annonce le vin nouveau. Rivière au coeur jamais détruitdans ce monde fou de prison,Garde-nous violentet ami des abeilles de l'horizon. Quelques traces de craie dans le ciel,Anthologie poétique francophone du XXe siècle
00:02 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Quelques traces de craie dans le ciel - Anth, René Char | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2011
La citation du jour 1b
Marco Lodoli

Je les observe les uns après les autres, et ils me font penser à des mains tendues autour d'un feu qui cherchent à le protéger du vent, qui cherchent à se réchauffer éternellement à ses braises. Ces êtres font partie de moi, ils sont mes caves et mes horizons, et pourtant ils ont leur dignité, ils sont capables de paroles et de gestes qui me surprennent, ils ont faim et soif, ils ont leur propre façon de rêver. Et qui sait si je ne suis pas moi-même en train de vivre dans un livre, dans la malheureuse notice d'un volume oublié sur l'étagère de l'infinie bibliothèque: et la bibliothèque engrange d'un côté de nouvelles acquisitions, elle refait à chaque seconde l'inventaire, elle s'agrandit, se complète; à l'autre bout elle croule et disparaît. Et si ça se trouve, toute la bibliothèque n'est que la virgule d'une feuille de journal pliée sur la caboche d'un clown.
Marco Lodoli, Les prétendants / Trilogie romanesque - Le vent (P.O.L., 2011)
00:07 Écrit par Claude Amstutz dans La citation du jour, Littérature étrangère, Littérature italienne, Marco Lodoli | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : citations; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2011
La citation du jour 1a
Marco Lodoli

Qui sait si sur la Terre, en un lieu que je n'ai pas encore traversé, il n'est pas en train de naître une civilisation exempte de tristesse, généreuse, immortelle... un univers d'enfants insouciants qui échangeront des tapes amicales et des baisers, qui entreront et sortiront en bande dans les rêves, comme dans les bars sur les avenues, et qui ne laisseront personne de côté, ne rejetteront personne, même celui qui a le coeur transi, les mains glacées et les pensées engourdies par la mort... Peut-être suis-je arrivé au bon moment, même si tout m'apparaît désert et plongé dans un silence sidéral, peut-être que devant moi ou au-dessus de moi, telle une pierre sera posée la première rose éternelle.
Marco Lodoli, Les prétendants / Trilogie romanesque - Le vent (P.O.L., 2011)
06:35 Écrit par Claude Amstutz dans La citation du jour, Littérature étrangère, Littérature italienne, Marco Lodoli | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : citations; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2011
Relire Supervielle 1b
Bloc-Notes, 8 septembre / Curio
En complément au roman Le voleur d'enfants de Jules Supervielle, voici un film d'animation en deux parties consacré à un autre de ses livres, L'enfant de la haute mer. Réalisé par Laetitia Gabrielli, Pierre Marteel, Mathieu Renoux, Max Tourret, en 2000. La musique est signée René Aubry.
Jules Supervielle, Le voleur d'enfants (coll. Folio/Gallimard, 1973)
Jules Supervielle, L'enfant de la haute mer (coll. Folio/Gallimard, 1972)
00:14 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Contes, Jules Supervielle, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; roman; conte; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
Relire Supervielle 1a
Bloc-Notes, 8 septembre / Curio

Le colonel Philémon Bigua n'est pas un homme comme tout le monde. Avec son épouse Desposoria, ils aiment les enfants, mais par un caprice malheureux de la nature, ce don précieux est refusé à leur couple. Alors, en plein Paris, le colonel vole ceux des autres, les invite dans sa demeure qui ressemble à une caverne d'Ali Baba, les installe et partage avec eux ses incroyables aventures vécues en Amérique du Sud, ses rêves, ses jeux, son affection forte et rassurante. Sont-ils effrayés, ces enfants? Pas le moins du monde, car ils sont soustraits à la pauvreté, aux situations familiales douloureuses ou à l'ennui. Leurs parents, par ailleurs ne s'en plaignent pas, une fois le premier étonnement surmonté. Antoine Charnelet, par exemple, est conquis par cet être exubérant, chaleureux, débordant d'imagination qui, de son léger accent étranger, lui a murmuré, avec beaucoup d'émotion dans la voix: N'aie pas peur, je suis déjà ton ami et tu vas voir que tu me connais.
Il éprouvait de la sympathie pour son ravisseur, à cause de la tendresse et des mystérieux égards que le colonel témoignait à l'enfant et à ses camarades. Comme il aimait aussi des objets exotiques qui les entouraient et dont chacun était un regard, un encouragement au caprice, un tournant de la géographie.
Et la magie opère, pour le bonheur de tous, jusqu'au jour où Bigua veut inviter tous ses amis pour leur montrer Antoine, son préféré. Desposoria le met en garde: Mon chéri, l'insouciance où tu vis de certains de tes actes, que j'admire mais qui sont punis par la loi, me paraît parfois effrayante. Tu vas et viens tranquillement, tu manges, bois avec des enfants volés. Ne vaudrait-il pas mieux quitter Paris? On te cherche certainement. Et si les petits te dénonçaient! Le danger est installé dans nos meubles.
Le colonel se laisse convaincre et projette de retourner en Amérique du Sud, à la seule condition d'emmener avec les enfants une jeune fille de Paris. Interpellé par Herbin - un père alcoolique que Philémon fera soigner dans une clinique - son rêve se concrétise avec sa fille Marcelle, pâle, sensible, tremblante, aux attaches très fines et, dans le regard, une douceur qui déborde l'enfance. Elle-même n'est pas insensible à Bigua, avec ses yeux noirs et chargés: Il représentait pour Marcelle tout ce qui lui avait manqué chez sa mère: Le luxe, la bienveillance et les pays étrangers. (...) Elle le trouvait beau avec son visage sans transitions, sa peau très blanche et ses cheveux très noirs, beaucoup plus beau et plus viril que tous les hommes qu'elle avait vu entrer chez sa mère, essouflés par une joie toute proche, et avec cette hâte dans le regard.
Mais Marcelle n'est plus tout à fait une petite fille, et son charme innocent va ravager le coeur du colonel tombé fou amoureux d'elle: Elle me regarde et je la regarde vivre et me regarder. Sa petite blouse est légère. Mon avenir y est contenu qui sommeille et parfois ouvre un oeil pour savoir où j'en suis et se refermer... La joie progressivement cède le pas à la jalousie, au tourment, à l'intolérance et tandis que les premiers émois de Marcelle marquent son passage à l'adolescence et la rapprochent des camarades de son âge tout en l'éloignant de ce second père auquel elle n'a plus rien à dire, Philémon au comble du désespoir réalise qu'il aime Marcelle plus que tout au monde, bien qu'elle lui échappe de plus en plus: Je me verrai condamné à une solitude infernale, même si je volais les uns après les autres tous les enfants de la terre.
Ce conte que Jules Supervielle publie en 1926, nous dit avec beaucoup de poésie le pouvoir de l'imagination, mais aussi combien le choc de la réalité peut, parfois cruellement, l'anéantir à tout jamais, tel notre malheureux colonel Bigua pour lequel l'impossibilité de cristalliser ses rêves aboutit à l'impossibilité de vivre, désormais...
Jules Supervielle, Le voleur d'enfants (coll. Folio/Gallimard, 1973)
00:00 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Contes, Jules Supervielle, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; roman; conte; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |













