08/02/2015
Morceaux choisis - Elio Vittorini
Elio Vittorini

Je sais ce que signifie être heureux dans la vie: la bonté de l'existence, la saveur de l'heure qui passe et des objets qui nous entourent, la volupté de les aimer, ces choses, immobile, tout en fumant, et une femme parmi elles. Je sais la joie de lire, étendu à demi nu sur une chaise longue, par un après-midi d'été. un livre d'aventures chez les cannibales devant une maison des collines, qui regarde la mer. Et beaucoup d'autres joies encore: dans un jardin épier le bruissement du vent qui fait à peine frémir les feuilles - les plus hautes - d'un arbre; ou, dans le sable, être un des grains infinis qui crissent et qui tombent; ou dans un monde peuplé de coqs se lever avant l'aube et nager, seul dans toute l'eau du monde, près d'une plage rose.
Et j'ignore la forme de mon visage dans tous ces bonheurs, lorsque je sens qu'il est si bon de vivre: douceur ensommeillée ou sourire? Mais quelle soif de posséder! Non la mer seulement, ni le soleil, ni une femme et son coeur à elle sous les lèvres. Terres aussi! Iles! Voilà: je peux me trouver à l'abri, calfeutré dans le silence de ma chambre dont la fenêtre est restée ouverte toute la nuit et soudainement m'éveiller au bruit du premier tramway du matin; ce n'est rien qu'un tramway, une voiture qui roule, mais le monde est désert autour et dans cet air à peine créé tout est différent d'hier, et une nouvelle terre m'assaille.
Elio Vittorini, Sardaigne comme enfance (Nous, 2012)
traduit de l'italien par Angélique Lévi
00:00 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
15/07/2012
Alberto Savinio
Bloc-Notes, 15 juillet / Genève

Alberto Savinio demeure méconnu auprès du public de langue française. De son vrai nom Andrea Francesco Alberto de Chirico, il naît en 1891 à Athènes et s'éteint à Rome en 1952. Ecrivain, peintre et compositeur italien, il est aussi le frère cadet du peintre Giorgio de Chirico. Auteur d'une trentaine d'ouvrages - dont près de la moitié ont été traduits - citons La boîte à musique (Fayard), L'intensité dramatique de Leopardi (Allia), Apologie du dilettante précédé de Epigrammes de Lucien (Gallimard), Capitaine Ulysse (Bourgois) et enfin Ville j'écoute ton coeur (Gallimard) qui vient de paraître au début de cette année.
Si un seul écrit devait attester de l'injustice faite à la ville de Milan - à laquelle sont toujours préférées Rome, Florence, Venise ou Naples - c'est bien celui-ci, même si à certains égards, ce tableau s'achève en 1943 et témoigne d'un passé révolu. Voyager avec Alberto Savinio s'avère aussi passionnant et instructif qu'en compagnie de Guido Ceronetti - en un autre temps - tout aussi méconnu que lui. Du Museo Poldi Pezzoli à la Pinacoteca di Brera, de la Scala de Milan à la maison rouge où vécut pendant une soixantaine d'années Alessandro Manzoni, c'est en quelque sorte une part infinie de tout le patrimoine et de l'âme italienne qui défile sous nos yeux: Giotto, Piero della Francesca, Gabriele D'Annunzio, Ambroise de Milan, Dante, Pétrarque ou Giuseppe Ungaretti parmi tant d'autres. Mais la qualité de son regard ne se borne pas qu'aux considérations artistiques ou historiques. C'est aussi la poésie et l'atmosphère de la ville qu'il nous restitue, par exemple devant le Dôme: Les mouvements de la foule sur cette place nette obéissaient à un ordre mystérieux, comme ces circuits qui font et défont les cristaux versicolores dans le rond mystérieux du kaléidoscope. Un noyau noir se formait au centre de la place, s'élargissait comme une rose qui s'ouvre à vue d'oeil, elle éclaboussait en étoile comme une tache d'encre mobile, puis se recomposait pour recommencer de nouveau à se décomposer; et ainsi jusqu'au soir, qui parfois tombait tout noir et sans lumière pour en contrecarrer l'obscurité.
Ailleurs, il consacre de superbes pages aux spécialités culinaires, à l'arbre des connaissances, aux poètes, à la pluie et au brouillard de Milan, ainsi qu'à la musique - voir les extraits déjà présentés dans Morceaux choisis, sur La scie rêveuse - dont Giuseppe Verdi - le Garibaldi de la musique - est la figure emblématique, évoquée surtout à travers Falstaff: Tandis que "Parsifal" est encore une peinture à l'huile, souvent de pâte opaque et étendue sur un gras enduit de craie et de colle, "Falstaff" est une détrempe au miel étendue en glacis sur un endroit compact et parfaitement lisse, une peinture sur marbre. A propos de la Traviata, il ose une approche insolite et pourtant fort pertinente: Pour mieux goûter, pour mieux comprendre les airs de "La Traviata", ces maigres papillons d'une soirée sans lendemain, il ne faut pas entendre "La Traviata" au théâtre, mais jouée par les orgues de Barbarie. Parce que "La Traviata" opère avec plus d'émotion dans le souvenir que dans le présent, et que l'orgue de Barbarie est le moulin des souvenirs; parce que l'orgue de Barbarie restitue cette musique de la tristesse citadine à son milieu naturel.
Dans ce merveilleux livre, aux côtés de Friedrich Nietzsche, Francesco Guardi et Isidora Duncan, vous ferez aussi halte à Venise, avant d'ouvrir votre fenêtre sur Padoue - les palmiers de Goethe - Sienne et Vicenza, ville pour promenades au soleil d'hiver. Entretemps Alberto Savinio vous aura invité à la mort de Richard Wagner, entraîné sur les pas de Tite-Live et éveillé à la freddura, dont je vous laisse découvrir la signification profonde au détour de ces pages.
Après la destruction de Milan - pages ajoutées par l'auteur - Alberto Savinio conclut: Je circule parmi les ruines de Milan. Pourquoi cette exaltation en moi? Je devrais être triste, au contraire je fourmille de joie. Je devrais ressasser des pensées de mort, et au contraire des pensées de vie me frappent au front, comme le souffle du plus pur et radieux matin. Pourquoi? Je sens que de cette mort naîtra une nouvelle vie. Je sens que de ces ruines surgira une ville plus forte, plus riche, plus belle. Ce fut alors, Milan, qu'en silence, entre moi et ton coeur, je te fis ma promesse. Revenir à toi. Clore en toi ma vie. Entre tes pierres, sous ton ciel, parmi tes jardins clos...
Ville j'écoute ton coeur est un ouvrage incontournable pour tout esprit curieux de l'intériorité italienne et de son art, outre une invitation à accepter de se laisser séduire par Milan, au plus vite!
Alberto Savinio, Ville j'écoute ton coeur (Gallimard, 2012)
image: Piazza Eleonora Duse, Milano (www.flickr.com)
12:51 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Giuseppe Verdi, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
05/07/2012
La citation du jour
Jean Paulhan

Quand le langage à la fois nous manque, et la sécurité, quand chaque détail est fait pour nous troubler et que les mots nous trompent, l'amour est à tout prendre la seule ressource qui nous reste.
Jean Paulhan, Petit avertissement au lecteur suisse, suivi de: Henri Calet, Rêver à la Suisse / 1948 (Pierre Horay, 1984)
09:06 Écrit par Claude Amstutz dans La citation du jour, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
04/07/2012
Morceaux choisis - Alberto Savinio
Alberto Savinio

Mais où sont les grands brouillards de Milan? Le brouillard meuble les villes, recueille les propos des hommes et les conserve; et quand vient le printemps, et que le soleil brille à nouveau dans les vitrines des magasins, et que les femmes s'élancent hors les noires entrées de leurs maisons, et comme faisanes dorées se répandent en battant des ailes dans la ville, les mots retenus des mois et des mois par le brouillard se libèrent en sonorités, et pleuvent du ciel scintillant. (...)
Le brouillard est commode. Il transforme la ville en une énorme bonbonnière, et ses habitants en autant de fruits candis. Le brouillard unit et invite à la vie domestique. L'amour aussi est favorisé par le brouillard, enclos et tendrement humain. Crois-nous-en lecteur, nous qui pour raisons de naissance et par ambitions poétiques avons soupiré après les amours parmi les myrtes, sous un ciel limpide, en face de la mer homérique: là-haut, sur cette terre sans dieux, on comprend combien les dieux, encore qu'invisibles et libres dans la lumière, sont des compagnons inutiles et des témoins fastidieux.
Dans le brouillard, passent des femmes et des jeunes filles encapuchonnées. Une légère fumée flotte autour de leurs narines et de leur bouche mi-close. Les yeux brillent sous le capuchon. Est-il revenu, le temps des nuits dansantes et des dominos? Je te connais joli masque! Suivre un de ces dominos à l'intérieur de la tiède habitation, se retrouver dans le prolongement des miroirs d'un salon, parmi les tapis moelleux et les meubles graves qui font famille, s'embrasser encore sentant bon le brouillard, tandis que le brouillard dehors se presse contre la fenêtre et, discret, silencieux, protecteur l'opacifie.
On comprend pourquoi dans le Nord la volonté de vivre est plus forte. La mort aussi est moins brutale dans les villes de brouillard, elle qui est d'une telle cruauté dans les villes de soleil. Les morts se détachent de nous mais ne nous abandonnent pas tout à fait. Ils vont habiter un peu plus loin, dans leur ville à peine plus petite, et le brouillard unit morts et vivants. Qui a l'oreille fine, entend respirer les morts tout doucement, sous l'épaisse couverture de brouillard, dans leurs confortables maisonnettes. Ne donnez pas le soleil aux morts: vous les rendriez malheureux et affamés de vie.
Alberto Savinio, Ville j'écoute ton coeur (Gallimard, 2012)
traduit de l'italien par Jean-Noël Schifano
image: Maurizio, Naviglio con nebbia / Milano 1945 (flickr.com)
02:08 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
02/07/2012
Morceaux choisis - Henri Calet
Henri Calet

(Cours de Géographie)
Le 14 juillet à Paris, le 1er août en Suisse: deux fêtes nationales coup sur coup, j'étais comblé. Les réjouissances commençèrent à la tombée du jour, au passage à niveau. C'est là que se groupa le cortège. Trois gendarmes en tête (ou ce que je pris pour des gendarmes) suivis par L'Instrumentale, bannière au vent - il n'y avait pas de vent -, après venaient quelques sapeurs-pompiers du genre dragons d'Alcala, puis ensuite un groupe de marins à pompons rouges, des gymnastes, les autorités civiles que j'allais oublier, le drapeau fédéral et sa garde d'honneur casquée, habillée de cet uniforme gris qui ne me plaît pas beaucoup, enfin des dames et demoiselles en costumes vaudois et une ribambelle de gosses portant des lampions. L'ensemble était pittoresque.
Et nous partîmes, au pas, en musique, en direction du château de Chillon tandis que je sentais grandir en moi un patriotisme tout nouveau. A notre approche, le boucher fit éclater deux pétards. Plus loin, le fruitier embrasa sa devanture. On déboucha devant le château, où des guirlandes électriques multicolores avaient été tirées entre les arbres. Une tenture rouge marquée à la croix blanche formait toile de fond.
Un monsieur monta dans une sorte de chaire pour nous lire le programme. Une intense émotion rendait son élocution des plus particulières. En outre, il coupait son discours de pauses inexplicables. Il me sembla que deux mots revenaient assez souvent: ... croissants chauds... croissants chauds... On allait bénéficier d'une distribution de croissants chauds. Une vieille coutume suisse, possiblement.
Là-dessus, L'Instrumentaliste joua Au Drapeau et puis un pot-pourri. Bonne soirée. Un des musiciens s'affaissa soudain, sans bruit. On le porta à l'écart, en bordure de la voie ferrée. Nous nous dîmes qu'il avait trop bu et la fête continua. Un autre monsieur était en chaire; il allait nous faire l'allocution patriotique attendue. Il s'exprimait bien. Nous écoutâmes une longue harangue dans laquelle il fut question d'une conférence importante qui se tenait à Paris, de l'industrie hôtelière, de l'armée suisse, et de bien d'autres sujets. Pendant ce temps, le musicien se roulait par terre en se griffant la poitrine. Il paraissait souffrir. Le monsieur arrivait à la péroraison...
- Tous pour un, un pour tous! s'écria-t-il.
Personne ne s'inquiétait du musicien toujours occupé à se contorsionner dans l'herbe. Une courte phrase pour conclure:
- J'ai dit!
Nous applaudîmes sans excès de chaleur. Après cela, des adolescents firent des mouvements de gymnastique rythmique et des sauts aux barres parallèles... On se décida à transporter le musicien hors de la foule. C'était un homme assez grand, jeune encore, très pâle; il fermait les yeux, comme s'il allait mourir. Je me demande quel effet cela produit en soi d'avoir très mal ainsi parmi une cohue joyeuse, au grand air. L'Instrumentale exécuta le Cantique suisse. Et nous nous séparâmes sans qu'il y eût aucune distribution de croissants chauds. J'avais du mal à comprendre.
Le musicien était étendu sur un matelas, entouré de petits enfants curieux. Il est mort là, une nuit de fête nationale, sans faire de bruit, et sans même que l'on s'en aperçut, en grande tenue à brandebourgs de trombone de L'Instrumentale. Certes, nul ne choisit son instant ni son coin pour cela. Qui sait où et quand il nous adviendra de nous mettre à agoniser et à mourir. Il n'est pas certain que nous nous y prenions aussi simplement, aussi dignement que le trombone ni que nous ayons des enfants tout autour de notre lit - si, par chance, nous avons un lit - ni que l'on joue le Cantique suisse à notre intention, ni que l'on éclaire le ciel de fusées roses et vertes...
Henri Calet, Rêver à la Suisse / 1948 (Pierre Horay, 1984)
image: François Boçion, La promenade devant Chillon /1868 (www.huma3.com)
11:08 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2012
Jean-Louis Hue
 Jean-Louis Hue, L'apprentissage de la marche (Grasset, 2010)
Jean-Louis Hue, L'apprentissage de la marche (Grasset, 2010)
Hors de la sphère romanesque, difficile d'être à la fois original, érudit et agréable à lire. Tel est pourtant le pari réussi par le discret Jean-Louis Hue qui nous invite à une promenade poétique avec les écrivains qui ont foulé la terre avant nous: A chaque pas le marcheur décèle des traces dans lesquelles il lit le passage de ceux qui l'ont devancé. (...) La terre par ses rides et ses cicatrices, raconte une histoire.
Il nous présente ainsi le poète William Wordsworth qui, déjà à son époque, égratignait ceux qui confondent la nature avec un parc d'attractions. Plus loin, c'est au tour de Robert Walser et de Carl Seelig - on guette, on observe, on tend l'oreille - de nous apprendre à voir le paysage comme un retour au monde ou au contraire tel un éloignement bienvenu pour saisir et mesurer l'ordre des choses. La randonnée se poursuit dans les Alpes avec Jean-Jacques Rousseau - qui observe davantage qu'il ne transpire, selon l'auteur - H.B. de Saussure ou Rodolphe Toepffer, avant de retrouver Jacques Lacarrière célébrant, au Mont Athos, le temps immobile. Cet essai n'est pourtant pas un catalogue de personnages, mais une vraie (re)création littéraire, un glissement imperceptible vers cet art de vivre qui habitait Nicolas Bouvier dans le sens de ses premiers pas réfléchis par Lao Tseu, ou Friedrich Nietzsche qui trouvait l'inspiration en marchant, précisément!
Semelles au vent, ce livre est le compagnon idéal de tout promeneur solitaire (ou bien accompagné) et libre...
22:37 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
18/02/2012
Morceaux choisis - Piero Calamandrei
Piero Calamandrei

Que vous arriviez de Bologne, surtout des tunnels de l'Apennin en direction de Florence, ou que vous arriviez du sud par la ligne qui vient de Rome, mettez-vous à la fenêtre et cherchez au sommet des collines: et quand vous verrez se dresser là-haut, près du toit rougeâtre d'une maison paysanne ou au beau milieu des oliviers argentés, la flèche d'un cyprès, soyez sûr que Florence est proche. Ce sont eux qui marquent non seulement les limites entre les champs et entre les fermes, mais aussi la frontière entre la Toscane et les autres régions. Ce qu'on peut reconnaître avec une précision absolue quand on vient de Rome. Jusqu'à la moitié du trajet, c'est le Latium qu'on voit: les lents méandres du Tibre, et, sur les hauteurs, les bois de chênes. Mais quand vous arrivez à Chiusi, la cité de Porsenna, voilà le cyprès, là-haut, comme un index tendu, qui vous avertit que vous avez pénétré en terre étrusque - car il y a une chose singulière: c'est qu'il semble que dans tous les lieux où ils se sont arrêtés en Italie, les Etrusques aient voulu laisser une trace de leur passage en plantant sur ces collines les lances des cyprès, comme un signe de leur emprise; lesquels ne sont pas réunis, ici, en bouquets touffus, mais épars comme des annotations au paysage, ornant d'une frange la crête d'un coteau qui se détache sur le ciel, accompagnant de leur alignement le chemin qui mène à une villa ou à un cimetière, protégeant les meules sur l'aire ou, au milieu des oliviers, la fumée d'une maison.
Je pense que pour les Etrusques, le cyprès était un arbre sacré, un symbole magique: une espèce de dieu Terminus, peut-être une conjuration contre la grêle et la foudre. Pure fantaisie de ma part... Reste que je considère le cyprès isolé parmi les oliviers comme la signature des Etrusques. Dans les douces périodes des collines toscanes dont les oliviers sont les mots, les cyprès sont les ponctuations. Et dans la sobriété où se mêlent des tonalités feutrées et discrètes, l'argent des oliviers et le vert sombre des cyprès sont la couleur du paysage toscan: ce n'est pas d'abord un paysage peint, mais un paysage dessiné, sculpté, buriné; un paysage aux contours précis, qu'il faut voir en hiver pour le bien comprendre, quand les autres arbres ont perdu leurs feuilles, ou à la rigueur au début du printemps, entre mars et avril, lorsque apparaissent entre les oliviers les taches roses des pêchers en fleurs, et qu'au bord des rivières il n'y a encore qu'une caresse de vert pâle sur les branches nues des peupliers.
C'est à ce moment-là, avant que le bouillonnement de mai n'en ait caché les lignes, que se découvrent bien visibles toutes les nervures de cette terre construite comme une architecture, où l'on peut reconnaître une à une les différentes qualités de pierres qui ont servi au cours des siècles à construire la ville: les rayures blanches des carrières de marbre où Michel-Ange allait choisir lui-même les blocs pour ses statues, ou plus bas, entre les champs, le brun de la pietra forte utilisée pour la tour du Palazzo Vecchio, ou le gris bleuté de la pietra serena, encadrement préféré des intérieurs de Brunelleschi.
Piero Calamandrei, Parler de Florence - bilingue (Collection Lettres d'Italie/Edition de la revue Conférence, 2010)
Illustrations: Gérard de Palézieux et de Piero Calamandrei
Traduction: Christophe Carraud
image: Florence - http://photos.linternaute.com/cypres/
00:43 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2011
Quasi une fantasia 3/3
Bloc-Notes, 28 avril / Les Saules
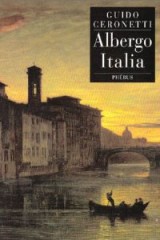
Le livre de Guido Ceronetti est bien plus qu'un compagnon de voyage. D'une humanité sous-jacente à tous ces billets d'humeur, il s'y exprime souvent avec un humour féroce - voir Du nouveau dans la mendicité ou Que sauver d'Italoshima? - mais parfois aussi avec une nostalgie tendre et rageuse, par exemple dans un chapitre émouvant intitulé L'Italie à une lire: La perte des chansons à une lire n'est pas la perte d'une lire. On n'accorde jamais un minimum de perte d'âme à ce qui ne correspond pas à une avancée du front entier des ténèbres. (...) Ce n'est pas la perte d'une lire, parce que la voix humaine qui chante exclut, brise prodigieusement le fini. D'un seul coup le poids qui nous écrase devient moins terrible, moins intolérable; en quelques notes l'infini a fait levier, il soulève le monde, le trop grand mal du monde.
Dans Lettre à une prostituée, je vous partage aussi cette belle réflexion sur l'amour: Il suffit d'une certaine idée de la beauté pour réprimer ce qu'il est nécessaire de réprimer. S'il manque cette idée universelle et la conscience de la douleur, on ne peut sentir le battement revivifiant de l'éventail sublime, de la fraîcheur incomparable de l'amour. Vouloir que tout soit libre est la folie du monde actuel, et la vie n'en devient que plus sombre, plus désespérée.
Un art de vivre et une conscience qui ne peuvent laisser indifférent - surtout de nos jours - quand Guido Ceronetti croque la mort des rizières ou le sens du patriotisme. Le plus beau visage de Albergo Italia est sans doute celui de l'un de ces Iraniens qui vend le journal de ceux qui combattent les crimes du régime, un message jailli de la profondeur de l'océan des douleurs: Je vais vous dire ce que vous perdez en n'achetant pas le feuillet illisible. Moi qui l'achète, je le sais... Non, ce n'est pas pour la lire... C'est pour le sourire. Si vous leur mettez dans la main, avec à peine un signe muet de solidarité, ces mille cinq cents lires, les Iraniens vous en récompensent d'un sourire si rayonnant de sympathie et de douceur, si débordant de reconnaissance, qu'il vous fait rougir à l'idée du peu d'effort qu'il vous en a coûté pour l'obtenir. Le sourire de l'Iranien vous rassure: non, vous n'êtes pas de ces charognes égoïstes, même si vous êtes conscients d'en faire partie. Alors, si vous vous sentez seuls, si l'absence d'âme de la coulée humaine qui vous heurte et vous bouscule vous accable, ne perdez pas cette occasion (...) et vous verrez à chaque fois pointer cette fleur rare, absurde, ce sourire d'humanité vive, massacrée mais vivante, ni pétrifiée, ni vitrifiée, ni éteinte.
Hymne à la beauté autant que croisade désespérée contre l'abrutissement, la vulgarité et le profit, Albergo Italia est précédé, chronologiquement, par Voyage en Italie, paru chez Albin Michel en 1996. Guido Ceronetti, né en 1927 à Andezeno, dans la province de Turin, est à la fois poète, penseur, journaliste, dramaturge, traducteur d'oeuvres latines et marionnettiste. Parmi ses écrits traduits en langue française - outre les deux précédentes - peuvent être cités Le silence du corps, Une poignée d'apparences et La patience du brûlé - carnets de voyage 1983-1987, tous les trois publiés par Albin Michel.
Un mot encore: Un jour peut-être, vous vous hasarderez dans la librairie où je butine depuis de nombreuses années. Derrière mes traits pâles et tirés, vous devinerez que, malheureusement pour vous, ce n'est ni le jour ni l'heure propice aux échanges, aux épanchements, aux sourires. De l'électricité dans l'air? De l'exaspération? De la colère? Ne rebroussez pas chemin, mais ne me parlez pas, ne me demandez rien... Cherchez simplement du regard la section des essais littéraires. Sous la lettre C vous trouverez le livre Albergo Italia de Guido Ceronetti. Achetez-le, lisez-le. Ensuite - et ce sera votre revanche - vous pourrez à votre tour rédiger un billet d'humeur dont les premiers traits de plume diront à peu près ceci: Tout avait pourtant mal commencé, dans une librairie nyonnaise...
Mais je plaisante, bien sûr!
Guido Ceronetti, Albergo Italia (Phébus, 2003)
Guido Ceronetti, Voyage en Italie (Albin Michel, 1996)
00:01 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2011
Quasi une fantasia 2/3
Bloc-Notes, 26 avril / Les Saules

Outre mon attirance naturelle pour tout ce qui concerne l'Italie, ce qui me touche d'emblée dans Albergo Italia de Guido Ceronetti, c'est la mise en perspective de deux mille ans et plus d'art, de culture, d'histoire, de valeurs revisitées dans ces années 80, avec une liberté de pensée et un sens critique très aiguisé devenus si rares en littérature, où les auteurs communément, tantôt font preuve d'une admiration sans discernement, tantôt se livrent à une entreprise de démolition sans fondement. Rien de tel dans cet ouvrage dont il vaut la peine - même si l'extrait peut sembler long - de se laisser imprégner par les premières lignes de ces billets d'humeur publiés à l'origine dans les colonnes de la Stampa, donnant toute la mesure de la tonalité de ces promenades attachantes et érudites à travers l'Italie:
L'Albergo Italia est un hôtel de malaise, de l'ennui et de l'insomnie avec, ici ou là, toujours plus d'anxiété et de peur. Mais il conserve l'attrait des grands hôtels déchus où des plaques commémorent des séjours d'empereurs ou de musiciens. Et c'est aussi le mien... On me connaît et, si je ne suis pas vraiment une personnalité, je n'y suis pas non plus personne. S'il m'arrive de crier dans la nuit, une main se tend. J'occupe une bonne chambre, toujours la même; elle a des rideaux pour voir ou ne pas voir, mais ce qu'il est possible d'apercevoir de la fenêtre a perdu peu à peu une grande partie de sa beauté. Une chose qui change, touchée chaque jour davantage par l'inexplicable. Une colline disparaît et à sa place on ne voit plus que fumée et acier. Une cour et ses cariatides chantantes se sont tues pour devenir un columbarium pour défunts coûteux. Un oratoire pour la Madone est maintenant un dépôt de motocyclettes. Aux bonnes odeurs de cuisine et de jardin ont succédé des miasmes qui brûlent la gorge. Pourtant, si j'ouvre les volets, je me dis qu'il est encore bon de sentir ces odeurs âcres auxquelles nous avons fini par nous habituer, de crainte qu'il nous arrive pis.
Pessimiste, Guido Ceronetti? On le serait à moins, mais contrairement à ce que suggère le quatrième de couverture de Albergo Italia, il n'y pas seulement de l'amertume ou de la nostalgie dans les évocations de son pays pour qui sait - ou veut - savourer, au détour d'une phrase ou d'une citation, l'enchantement certes lézardé, mais encore suffisamment séduisant pour conduire le lecteur attentif à prendre son bâton de pèlerin et le suivre en toute confiance, hors des sentiers battus.
J'aspire à redécouvrir, dans son ombre, certains lieux mal visités autrefois, tels Mantoue dont il dit demeurer surpris de voir que l'âme lombarde - ce qui est aimable, généreux, tolérant, peu enclin à la fatuité, attentif, virgilien - survit encore dans cette ville des brumes; il n'est pas moins généreux avec Trieste - une intense couleur de noblesse morale, une agitation nerveuse venue non des limbes vulgaires, mais d'âmes vivantes en révolte - ou Gubbio - qui a vu Gubbio une seule fois ne peut plus jamais l'oublier - mais se montre sévère avec d'autres lieux.
Naples, par exemple: Une ville de philosophes désormais réduite à un parfait télescopage de vulgarités, à un choc désespéré de grincements qui étouffent toute idée d'une cohabitation humaine décente. (...) Le golfe entier est désormais un véritable cloaque: urbain, administratif, touristique, alimentaire, moral; aucune beauté ne subsiste; le vitriol des camorras a défiguré partout la droiture; s'il vous reste encore un coeur et des yeux, vous pouvez seulement vous en servir pour pleurer. Il n'est pas plus tendre avec Rome: On n'y rêve pas, on n'y prie pas, on prend seulement des autobus dont on descend toujours avant d'être arrivé, en détestant le visage humain.
Pourtant, même en ces deux villes, sa curiosité nous attire dans quelques recoins secrets où vacille encore une faible lumière, comme il le fait avec Assise - qu'un vent inimitable ne parvient pas à blesser (...) Intoxiquée par la foule, elle reste solitaire. Elle s'est avilie, mais l'air la soutient - ou Venise - il y a des coffres enfouis dans les épaves coulées - qu'il n'apprécie guère.
Si je ne partage pas son appréhension de cette dernière, à laquelle j'ai toujours été sensible hors saison - tôt le matin ou tard le soir, longeant des canaux méconnus de l'étranger ou entrant dans une église où je ne rencontrais personne - avec Guido Ceronetti j'ai plaisir à me laisser bousculer, à priori toujours tenté d'idéaliser ce qui parfois ne le mérite pas ou d'effleurer seulement ce qu'il vaudrait la peine de creuser ou d'apprendre.
Mais Albergo Italia, ce n'est pas que cela...
A suivre...
Guido Ceronetti, Albergo Italia (Phébus, 2003)
00:02 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Guido Ceronetti, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












