23/03/2013
César Aira
Bloc-Notes, 23 mars / Thonon-les-Bains

Le 31 décembre au matin, les Pagalday visitèrent en couple l'appartement, qui leur appartenait déjà, sur le chantier de la rue José-Bonifacio, au numéro 2161, en compagnie de Bartolo Sacristan Olmedo, le paysagiste qu'ils avaient engagé afin de disposer les plantes sur les deux vastes balcons de l'appartement, en façade et côté cour.
Ainsi commence cet étonnant roman de César Aira où, passées ces premières lignes de facture classique, nous allons être constamment surpris - dans la forme et dans le style - par cette histoire qui nous met en présence des propriétaires, de leurs enfants, des ouvriers de chantier, du concierge de cet immeuble de luxe inachevé, au sommet duquel, sur la terrasse, ils ont décidé de fêter ensemble, le passage à la nouvelle année. Aucun de ces personnages, à l'exception de Patri, la fille aînée des Vinas, ne s'impose durablement au récit. Nous suivons les instants saisis au vif de leurs rencontres imprévues: un lot de situations, de plaisanteries, de réflexions, de banalités puisées dans leur existence ordinaire.
Mais où donc César Aira a-t-il décidé de nous embarquer avec cette histoire sans véritable point d'ancrage, dépourvue d'intentions, de signes, d'arrières-pensées? Le titre du roman, Les fantômes, en livre la clef principale, car cet immeuble de la rue José-Bonifacio est habité... par des fantômes, entièrement nus, que seuls les membres de la famille Vinas peuvent voir!
Et voici que ces fantômes, facétieux, s'invitent à la fête - peut-être même en sont-ils les instigateurs? - trouvant en la personne de Patri, un écho, sinon un courant de sympathie: Arrêtez-vous! hurlait son âme, ne partez jamais plus! Elle voulait les voir ainsi pour l'éternité, même si l'éternité devait durer un instant, et surtout si elle durait un instant. Elle ne concevait pas l'éternité d'une autre façon. Viens, éternité, viens, et sois l'instant de ma vie! s'exclamait-elle pour elle-même... Un monde dont il lui semble faire partie, au contraire de celui des siens. Et cette aventure, jusqu'où la conduira-t-elle? A attirer les fantômes dans sa propre réalité ou, au contraire, les rejoindre dans une irréalité apparente et inexpliquée, par un de ces caprices du destin?
Elle mettait la meilleure volonté du monde, appelait l'imagination à son secours, à ses dons de créatrice sauvage, naïve si l'on veut, et elle parvenait toujours à la même conclusion: un sourire mystérieux que dessinaient les lèvres des fantômes. C'était une espèce de fatalité qui surgissait du fond d'elle-même, de son scepticisme: le sourire mystérieux comme fin, comme barrière infranchissable.
Comme les auteurs argentins excellent souvent à cet exercice - chez Ernesto Sabato, par exemple - nous naviguons constamment entre le réel et le fantastique dans Les fantômes, sans véritables repères. Une démarche délibérée de César Aira qui, au détour de ces êtres transparents et familiers à la fois, nous parle des classes moyennes, de l'argent - cette seule virilité qui compte en Argentine -, du rêve, de littérature ou de philosophie. Un roman qui ressemble à une route inachevée dont chaque segment, ainsi que dans l'immeuble de la rue José-Bonifacio, interpelle, désarçonne, interroge nos certitudes en péril: Une personne peut n'avoir jamais pensé, pas une seule fois dans sa vie, elle peut sembler être un ensemble désorganisé de tremblements et de passions futiles, passagères, et cependant à n'importe quel moment, sur demande, peuvent naître en elle les idées les plus subtiles qu'ont eues un jour les plus grands philosophes. Ce qui semble si paradoxal se passe tous les jours.
Ne cherchez pas dans ce livre une explication aux fantômes: vous n'en trouverez pas. Pour les uns, ils seront sans doute le fruit de notre imagination; pour d'autres, les témoins de nos vies minuscules dans un univers de béton dissocié du passé ou les silhouettes mélancoliques d'un espace - la proximité? l'éternité? - qui n'a plus cours. Et vous, qu'en direz-vous?
Les fantômes de César Aira, est l'un des romans les plus singuliers de ce printemps, comme un miroir qui saurait, à l'envers des 155 pages de ce livre, modifier notre centre de gravité.
Il est faux que, comme on le disait, les morts se transformaient en étoiles: c'était le contraire...
César Aira est né en 1949 dans la province de Buenos Aires. Après la disparition de Roberto Bolano, il est considéré comme l'un des écrivains sud-américains les plus importants. Les fantômes est le seixième de ses ouvrages traduits en langue française. Parmi ses oeuvres majeures, peuvent être cités Un épisode dans la vie du peintre voyageur (André Dimanche, 2000), Varamo (Bourgois, 2002), La preuve (Bourgois, 2008) et Anniversaire (coll. Titres/Bourgois, 2011).
César Aira, Les fantômes (Bourgois, 2013)
traduit de l'argentin par Serge Mestre
00:05 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature étrangère, Littérature sud-américaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
12/03/2013
Sarah Hall 1a
Bloc-Notes, 12 mars / Les Saules

Connaissez-vous Sarah Hall? Si tel n'est pas le cas, lisez de toute urgence, aux éditions Bourgois, Le Michel-Ange électrique, son premier roman traduit en français (2004) ou mieux encore, son chef d'oeuvre, Comment peindre un homme mort (2010) qui a été présenté dans ces colonnes au moment de sa sortie en librairie. Mais pourquoi ne pas tenter votre chance avec sa dernière parution, La belle indifférence, un recueil de nouvelles, de quoi vous familiariser avec son style et son univers?
Sept nouvelles donc, qui ont pour cadre la Cumbrie - au nord-ouest de l'Angleterre -, l'Afrique et la Finlande, dont le personnage principal est, à chacun de ces récits extrêmement diversifiés, une femme. Mais quels traits communs peut-on trouver entre la redoutée Mandy qui ressemble à un chien enchaîné et rudoyé dans Le parfum du boucher, l'infirmière qui attend son amant et ne parvient pas à franchir le mur de l'indicible dans La belle indifférence, ou Dolly convertie à la chasse afin de confectionner une pélerine de vison pour son amie Magda, gravement malade dans La rivière de la nuit?
Ces nouvelles qui peuvent être comprises à des niveaux de lecture différents - comme ses deux précédents romans - fournissent un début de réponse, ici: une femme, à chaque fois, dans toute son intériorité charnelle et multiple, se trouve confrontée à l'autre - homme ou animal - ainsi qu'aux éléments naturels, à même de révéler en elle des zones d'ombre, des dysfonctionnements, des désirs enfouis, des pulsions instinctives.
Si la tonalité change d'une histoire à l'autre, les mêmes défis pour survivre à un monde émotionnel qui s'atrophie et bascule dans le néant habite ces personnages: le besoin de sexe sans connection aucune avec le vernis quotidien dans L'Agence; le culte sauvage et familial des chevaux dans Le parfum du boucher; les coups d'aviron pour déjouer la peur d'un paysage silencieux et crépusculaire dans Vuotjäarvi; ou la forme blanche et blessée sur la plage, reflet peut-être de la bête - incontrôlée et fragile - qui se tapit en chacun de nous dans Elle l'assassina, lui qui était mortel. Une plongée vertigineuse dans l'inconscient féminin, envahissante comme un parfum obsédant qui ne nous lâche plus.
La vérité de la mort est chose singulière. Car quand ils nous quittent, les êtres chers sont comme s'ils n'avaient jamais été. En disparaissant de cette terre ils disparaissent de l'air même. Ne restent que les landes et les montagnes, le monde matériel sur lequel nous nous trouvons et sur lequel nous régnons. Nous sommes les loups. Nous sommes les lions. L'ultime défi - ou déni? - dans La rivière dans la nuit...
Avant de devenir romancière, Sarah Hall aspirait à la poésie, et cela est tout particulièrement perceptible dans l'écriture de Les abeilles, Elle l'assassina, lui qui était mortel, et Vuotjärvi, la plus angoissante de ces nouvelles dont la fin ne lève pas tous les voiles!
Une lecture à recommander à tous les écrivains en herbe, pour leur apprendre comment se construit un texte capable de donner l'impression de glisser à la surface des choses et de finalement presque tout révéler, sans tabous ni esbroufe, tel un torrent d'une sensualité envoûtante, dans une progression dramatique constante, hors du commun. Leila Sanai, dans les colonnes de The Independent note que, dans La belle indifférence, on se noie comme dans une peinture de Rothko.
Et comme elle a raison!
Sarah Hall, La belle indifférence (Bourgois, 2013)
traduit de l'anglais par Eric Chédaille
00:11 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature étrangère, Sarah Hall | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; nouvelles; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2013
Ginevra Bompiani
Bloc-Notes, 16 février / Thonon-les-Bains

La première scène du roman de Ginevra Bompiani, nous introduit par la voix de Lucy, une fillette accompagnant sa tante, dans l'hôtel d'une station thermale qui pourrait ressembler à n'importe quel autre, sauf que celui-ci se trouve être le plus laid de tous et ressemble à un hôpital pour personnes en bonne santé. Quatre personnes vont s'y côtoyer. Outre la petite qui s'ennuie et tante Emma joyeuse dès qu'elle voit quelqu'un, Lucy nous présente Lucia et Giuseppina, deux femmes dont l'une boite tandis que l'autre tangue!
Au cours de ce séjour dans la station, elles vont apprendre à se connaître toutes les quatre, livrant peu à peu quelques secrets de leur existence et - qui sait - en échafauderont d'autres... Présenté en quelques phrases ou extraits de dialogues, on serait tenté de décréter que nous sommes au coeur d'une sempiternelle comédie à l'italienne. Pas si sûr, car une fois le décor planté et les personnages fondus dans le quotidien, une gravité mélancolique les couvrira de son aile dans ce lieu de cures magiques où on soigne dans le corps ce qui est malade dans l'âme et qui donne l'impression de faire un petit pas en arrière pour que le présent trébuche de nouveau dans le futur.
Ginevra Bompiani cerne avec beaucoup d'acuité, dans Une station thermale, cet univers de bien-être qui consiste à s'enfermer dans un cocon et faire semblant que le monde n'existe pas: C'est bizarre que cette chose que tout le monde fait, une chose si commune, personne n'y arrive... Vieillir. Et, derrière les masques qui se lézardent, perce l'anxiété commune déclenchée par la solitude affective, la résistance au changement, la crainte de la maladie et pire, peut-être. Ce qui n'effleure pas Lucy qui, pour tromper la monotonie des jours, espère bien ne pas s'en aller sans avoir percé les secrets des unes et des autres - ce serait comme jeter un roman policier qu'on n'a lu qu'à moitié - et confié au lecteur les siens.
Dans ce petit monde frivole en apparence, exclusivement féminin - à l'exception de quelques pages consacrées à l'autrefois séduisant Stefano - Ginevra Bompiani, comme seule une femme sait le faire, appréhende à merveille ce mystère du corps où, derrière la faiblesse, la fragilité et les fissures de la vie se nichent en révélateurs, ces signes qui peuvent, au-delà de la beauté formelle, dissoudre les blessures intimes et réserver des moments de fête, de tendresse - voire d'amour - innatendus.
Et le désespoir, on s'en passe, conclut Lucia...
Fille de l'éditeur Valentino Bompiani, Ginevra Bompiani, née en 1939 à Milan, est écrivain, éditrice chez Nottetempo à Rome, enseignante et traductrice: entre autres de Antonin Artaud, Louis-Ferdinand Céline, Marguerite Yourcenar et Gilles Deleuze. Parmi ses oeuvres traduites en langue française, mentionnons Les règles du sommeil (Verdier, 1986), Ciel ancien, terre nouvelle (L'Arpenteur, 1990) et Le grand ours (Stock, 1995).
Ginevra Bompiani, La station thermale (Liana Levi, 2013)
23:05 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature étrangère, Littérature italienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2013
Clémence Boulouque 1a
Bloc-Notes, 5 février / Les Saules

Trois ans après le suicide de son père, le juge Gilles Boulouque - qui est à l'origine de son premier livre, Mort d'un silence, Clémence Boulouque affronte une autre tragédie: le suicide de sa meilleure amie de lycée, Julie, dans les années 90, marquant comme une mélodie douloureuse et secrète son adolescence.
Tel est le thème de Je n'emporte rien du monde. Court, bouleversant dans sa retenue et sa sincérité, ce récit qui s'ouvre comme une boîte à musique, dépasse - de loin - le cadre strict du témoignage autobiographique, pour nous interroger sur le sens de l'écriture qui veut dire la vie, là où se déploient les ombres énigmatiques de la mort. Des pages de toute beauté jalonnent son livre sur ce sujet intime et délicat, amorcé avec le deuil du père qui lui a donné à connaître la compagnie des disparus, cette façon de lire leurs traces comme du braille, de passer la main sur du vide, de continuer d'entendre leurs voix. (...) Je voudrais croire que les disparus viennent nous retrouver, dans nos fragilités. Leur présence se fait plus intense quand nous aurons bientôt besoin d'eux. Ils le devinent. J'ai compris, une nuit, qu'ils m'empêchent d'être seule quand tout déferle. Parce que trébucher n'est rien, les coups ne peuvent rien, leur trace est une inflexion de vie.
Dans les yeux des endeuillés, pour Clémence Boulouque, se prolonge invisible, l'histoire sans fin de ceux qui nous ont quitté, nous interpellent, nous réconfortent: Je leur dois le bonheur qui a glissé entre mes mains. Eux, me filent. Je les suis, je suis eux, et ils m'ont donné leur procuration, leur énergie, et ils murmurent une envie de continuer à vivre ou, peut-être, leur regrets ne n'avoir pas assez aimé ce qu'ils quittaient.
Ainsi de Julie, l'amie inséparable, dans ce monde de titubants solitaires. La part manquante, ce fragment de vie arraché à la vie de l'auteur à laquelle répond celle de la disparue qui par des voies mystérieuses insuffle sa force aux vivants. Pourtant, avec une infinie douceur, Clémence Boulouque n'esquive pas, dans ce travail du deuil et de la résilience, la vision peut-être déformée ou mythifiée de la mémoire, prélude à la guérision, mais non à l'oubli: Le monde est fait pour qu'on s'en échappe. Alors je le fixe puis je ferme les yeux. Et je te retrouve. Et je referme un cahier sans fleurs, notre livre, le livre de deux mortes, dont l'une écrit pour l'autre.
Sans aucune morbidité mélodramatique, elle conclut son récit avec ces mots de la douleur qui s'éteint: Laisser les morts nous quitter. S'en séparer. Le temps est passé. Alors le temps est venu. Je n'emporte rien du monde peut alors résolument s'ouvrir à nouveau, sur la vie, tel un livre à venir...
Parmi tant d'ouvrages complaisants, bavards et interminables, la brieveté de Je n'emporte rien du monde, sans un mot superflu, amplifie le trouble du lecteur et laisse au coeur une trace indélébile: celle de l'un des plus beaux livres de cette rentrée littéraire!
Née en 1977, Clémence Boulouque, écrivain, journaliste et critique littéraire, notamment au Figaro et à France Culture, vit aujourd'hui aux Etats-Unis et enseigne à la New York University. Parmi ses publications antérieures, ont déjà été présentés sur La scie rêveuse: Chasse à courre (coll. Folio/Gallimard, 2007), Au pays des macarons (coll. Le Petit Mercure/Mercure de France, 2005), Nuit ouverte (Flammarion, 2007), Survivre et vivre - Entretiens avec Denise Epstein (Denoël, 2008) et L'amour et des poussières (Gallimard, 2011).
Clémence Boulouque, Je n'emporte rien du monde (Gallimard 2013)
Clémence Boulouque, Mort d'un silence (coll. Folio/Gallimard, 2004)
00:10 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Clémence Boulouque, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
21/01/2013
Jean Echenoz 1a
Bloc-Notes, 21 janvier / Les Saules

Dans un entretien accordé à Eléonore Sulser, dans Le Temps du 10 octobre 2012, voici ce que Jean Echenoz confie à propos de 14, son dernier livre: J'avais envie de revenir à la fiction, à un projet de roman que j'ai depuis quatre ou cinq ans. Mais un incident s'est produit. Je suis tombé sur des carnets de guerre en aidant quelqu'un qui m'est très proche à ranger des papiers de famille: six petits cahiers, carnets de guerre d'un grand-oncle, parti le jour de la mobilisation et resté soldat jusqu'en 19. J’ai commencé à les lire, puis à les transcrire. Il fallait déchiffrer tout cela, j’ai travaillé sur des cartes, pour vérifier des orthographes de lieux, des parcours, etc. Puis je me suis demandé ce qui se passait au juste pendant ce temps-là, sur le plan de la guerre elle-même et de la politique internationale. J’ai lu des travaux d’historiens, d’autres carnets, des romans sur la Grande Guerre; j’ai regardé des archives filmées. Les six carnets, eux, parlaient surtout du temps qu’il fait – ce qui compte quand on est à la guerre –, des corvées, très peu des combats sans doute par pudeur ou par peur de la censure, je ne sais pas. A partir du point de vue très humble d’un homme parmi des millions plongés dans cette affaire, je me suis immergé dans la Grande Guerre. Et est arrivé un moment où j’ai eu envie d’inventer des personnages et de revenir à la fiction par ce biais-là.
Toute l'histoire commence avec Anthime - le personnage central de ce roman - quand, une certaine journée d'août, il entend les cloches qui, tout alentour sonnent à l'unisson dans un désordre grave. Le tocsin, pour être plus précis, signe de la mobilisation. Le voici parti sous les drapeaux, avec Charles - son frère aîné et fiancé de Blanche -, Bossis, Arcenel et Padioleau. Cinq hommes et une femme, Blanche, qui attend le retour de deux d'entre eux, Charles et Anthime, conservant dans son bureau les lettres et cartes postales qu'ils lui envoient régulièrement, rangées en piles serrées par des rubans aux couleurs opposées dans des tiroirs distincts.
Jean Echenoz a le souci de ne pas vouloir réécrire l'histoire, mais de souligner le quotidien de ces hommes, accablés de faim, de froid, de fatigue, de peur, au point d'espérer une blessure de guerre honorable ou choisir la désertion pour être soustraits à l'horreur sous ces pluies de bombes mêlées aux gerbes de sang qui les entoure. Tout a été décrit mille fois, peut-être n'est-il pas la peine de s'attarder encore sur cet opéra sordide et puant. Peut-être n'est-il d'ailleurs pas bien utile non plus, ni très pertinent, de comparer la guerre à un opéra, d'autant moins quand on n'aime pas tellement l'opéra, même si comme lui c'est grandiose, emphatique, excessif, plein de longueurs pénibles, comme lui cela fait beaucoup de bruit et souvent, à la longue, c'est assez ennuyeux.
Un récit fulgurant dont le style épuré, semblable à un film de Robert Bresson, évite toute pesanteur, tout excès. Et quand tout pourrait basculer dans le mélodrame, Jean Echenoz parfois, d'une pirouette, nous en éloigne par un humour de situation particulier qui articule ces épargnés au jour le jour, dont le rire extravagant ou dérisoire résonne tel un entr'acte avant l'appel des manquants.
Pendant ce temps, au village où ne demeurent que les femmes, les enfants et les vieillards, Blanche, qui a donné naissance à une fille prénommée Juliette, fruit de son amour partagé avec Charles, attend. Qui donc, le moment venu, lui reviendra?
Si vous ne l'avez déjà fait, lisez vite 14 de Jean Echenoz, car à une émotion sourde qui agrafe le lecteur dès les premières lignes pour ne plus le quitter, s'ajoute le plaisir de lire un roman sobre, abouti, dont la langue précise et chaleureuse malgré la gravité du temps, traduit une sincère empathie de l'auteur pour ces anonymes de la Grande Guerre.
Comme je l'ai mentionné autrefois à propos du livre de Philippe Claudel, Le rapport de Brodeck - dont la toile de fond est la seconde guerre mondiale - le propos de Jean Echenoz touche à l'universel, et à ce titre, son roman mériterait, lui aussi, d'être inscrit au programme des lectures scolaires...
Jean Echenoz, 14 (Minuit, 2012)
Philippe Claudel, Le rapport de Brodeck (coll. Livre de poche/LGF, 2009)
Eléonore Sulser, Article et entretien avec Jean Echenoz / 10 octobre 2012 (letemps.ch)
03:55 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone, Philippe Claudel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
01/01/2013
Angelin Preljocaj
Bloc-Notes, 1er janvier / Les Saules

C'est en 2008 que Angelin Preljocaj créé le ballet Blanche-Neige, d'après le conte des frères Grimm. Voici que qu'en dit le chorégraphe: J'avais très envie de raconter une histoire, d'ouvrir une parenthèse féerique et enchantée. Pour ne pas tomber dans mes propres ornières sans doute. Et aussi parce que, comme tout le monde, j’adore les histoires. Je suis fidèle à la version des frères Grimm, à quelques variations personnelles près, fondées sur mon analyse des symboles du conte. Bettelheim décrit Blanche Neige comme le lieu d’un œdipe inversé. La marâtre est sans doute le personnage central du conte. C'est elle aussi que j'interroge à travers sa volonté narcissique de ne pas renoncer à la séduction et à sa place de femme, quitte à sacrifier sa belle fille. L’intelligence des symboles appartient aux adultes autant qu'aux enfants, elle parle à tous et c’est pour cela que j'aime les contes.
Blanche Neige est un ballet narratif, avec une dramaturgie. Les lieux sont représentés par les décors de Thierry Leproust. Les danseurs de la compagnie incarnent les personnages dans des costumes de Jean Paul Gaultier. La musique - pour l'essentiel - est extraite des symphonies de Gustav Mahler. La première a eu lieu le 25 septembre 2008 à la Biennale de la danse de Lyon, et ce ballet a été primé aux Globes de Cristal en 2009.
Et maintenant, bienvenue au pays des rêves, avec les 26 danseurs de la Compagnie Angelin Preljocaj...
image: Rita Antonioli, Angelin Preljocaj (telerama.fr)
sources: www.preljocaj.org
00:50 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Contes, Gustav Mahler | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique classique; danse |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2012
Mes 12 étoiles de la littérature 2012
Bloc-Notes, 29 décembre / Les Saules

C''est aujourd'hui un plaisir de revisiter les passions partagées autour de tant de livres découverts au fil de l'année: ceux qui m'ont ému, surpris, étonné; ceux qui m'ont enrichi; ceux qui m'ont distrait. Et cela sans souci de hiérarchie ou de genre.
Bien que parus fin 2011, les deux premiers volumes des Oeuvres complètes de Charles-Albert Cingria (L'Age d'Homme) ont largement mérité d'obtenir l'étoile d'or, car ils nourrissent mes moments de lecture au quotidien, depuis leur parution et sans jamais me lasser. De courts récits semblables à des esquisses de tableaux - Fribourg, Lausanne, Ouchy, Paris ou Ravenne - auxquels se mêlent un sens de l'observation, une réflexion personnelle sur le temps, l'histoire et l'auteur, non dénuée d'humour.
Si les onze titres suivants obtiennent le même rang - ex-aequo, avec une étoile d'argent - je suis heureux de poursuivre ce voyage rétrospectif avec deux autres auteurs suisses que sont Douna Loup et Jean-Louis Kuffer: le premier avec Les lignes de ta paume (Mercure de France), un récit à deux voix transposé du réel - qui est à la fois une traversée du siècle et une exploration pertinente sur la liberté qu'attise la création artistique, en l'occurence la peinture - servi par une écriture chatoyante à la frontière de la poésie; pour le second, ses Chemins de traverse - Lectures du monde 2000-2005 (Olivier Morattel) m'ont accompagné comme les écrits de Charles-Albert Cingria, à tout heure du jour et de la nuit, par sa célébration de la vie, de l'amour et des arts dont son auteur me comble par sa générosité, son humour et son regard libertaire sur le monde.
Parmi les romans, je choisis trois récits plutôt intimistes. Les impurs de Caroline Boidé (Serge Safran) est ainsi une agréable surprise - une histoire d'amour avec en toile de fond l'Algérie des années 50 - de même que Je suis la marquise de Carabas de Lucile Bordes (Liana Lévi) - une plongée dans l'histoire de sa famille, la saga du Grand Théâtre Pitou et leur monde qui s'éteint - sans oublier Marie-Hélène Lafon qui, avec Les pays (Buchet-Chastel), conte l'histoire d'une fille du Cantal qui monte à Paris pour entreprendre des études, apprivoise pas à pas la réalité fragile de la ville, sans pour autant renier ses tendres campagnes.
Un seul roman policier - bien qu'il soit davantage que cela - m'a enchanté: Prison avec piscine (Liana Levi) de Luigi Carletti, situé à la Villa Magnolia, dans un quartier résidentiel de Rome, et dont le héros a été victime d'un accident de moto dans sa jeunesse, le laissant invalide, pour toujours. Une atmosphère typiquement italienne et une intrigue originale autour de ce personnage attachant qui, en pleine conscience déclenche un mécanisme mortel bien au-delà de ses projets.
Autre orientation avec Alphabets (L'Arpenteur) de Claudio Magris, regroupant environ 80 chroniques parues dans le Corriere della Sera, à propos de littérature, de philosophie, des périodes charnières de l'histoire. Avec lui, à chaque page j'apprends quelque chose, sans pesanteur, reliant mon petit monde à l'universel. La poésie n'est pas oubliée avec Où vont les arbres de Vénus Khoury-Ghata, que le grand public append enfin à connaître, par le biais de ce prix Goncourt de la Poésie 2012 tout à fait mérité!
Enfin, comme vous l'avez remarqué, la musique occupe une place importante dans mes loisirs. Aussi, ce n'est pas un hasard si je retiens trois titres en relation avec elle. Les grands violonistes du XXe siècle / vol. 1: de Kreisler à Kremer, 1875-1947 (Buchet-Chastel) signé Alain Lompech, est un trésor inestimable qui comble mes lacunes d'autodidacte, en texte et musique: 16 heures d'écoute! Une étrange histoire d'amour de Luigi Guarnieri (Actes Sud) est en revanche un roman - un récit serait plus juste - autour de Johannes Brahms et les époux Clara et Robert Schumann: une immersion fascinante dans leur univers. Pour en finir avec ce rapide survol, Sauver Mozart - Le journal d'Otto J. Steiner (Actes Sud) de Raphaël Jérusalmy, m'a séduit par cette fiction pure autour d'une supercherie - un manuscrit retrouvé du compositeur - servant de prétexte à raviver la mémoire de disparus, en pleine seconde guerre mondiale.
Il n'y a pas, dans ce coup d'oeil dans le rétroviseur, d'étoiles de bronze qui représentent, dans mon imaginaire, de plaisantes lectures, mais dont le parfum s'est rapidement altéré...
Par la fonction Recherche sur La scie rêveuse - vous pouvez retrouver tous ces ouvrages auquels j'ai consacré quelques lignes ou davantage, ainsi que des extraits, tout au long de cette année.
Belles heures de lecture à tous!

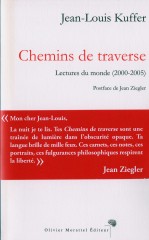
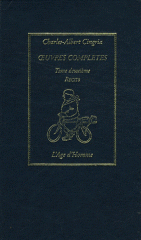
image: girlparker.com
00:03 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Charles-Albert Cingria, Douna Loup, Jean-Louis Kuffer, Littérature étrangère, Littérature francophone, Littérature italienne, Littérature policière, Littérature suisse, Musique classique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; musique; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
27/12/2012
Frédéric Pajak
Bloc-Notes, 27 décembre / Les Saules

En sa qualité d'écrivain, Frédéric Pajak ne ressemble vraiment à personne, et son dernier livre, Manifeste incertain, en est une démonstration supplémentaire. Récit autobiographique, poème, cahier de dessins, pamphlet, souvenirs, reportages, ou plutôt tout cela à la fois? Le fil conducteur de ce texte est Walter Benjamin auquel s'ajoutent quelques pages consacrées à Samuel Beckett, comme dans d'autres de ses précédents ouvrages, ont été placés sous son projecteur Friedrich Nietzsche, Cesar Pavese, Martin Luther et James Joyce.
Pourquoi ce Manifeste incertain? En préambule, Frédéric Pajak nous en livre la clef: La génération de l'après-guerre a perdu le fil de l'Histoire à force de reconstruire le monde. Et c'est vrai qu'elle l'a reconstruit et qu'elle a su faire règner la paix, comme un long soupir, en oubliant les temps mauvais. Maintenant nous vivons dans les restes de cette paix, et c'est avec ces restes que nous improvisons une société, une société qui efface les sociétés précédentes, une société sans mémoire. Il ajoute à sa réflexion: Evocation de l'Histoire effacée et et de la guerre du temps, tel est, exprimé de façon désarticulée, le propos du Manifeste. Ecrire contre l'oubli, tracer l'éphémère, l'incruster dans le papier comme l'image d'une lumineuse mélancolie.
Avec Walter Benjamin, Frédéric Pajak situe la responsabilité de l'écrivain et déborde de ce cadre trop strict pour lui afin d'ouvrir son champ de vision à la création toute entière: La création humaine surgit de la pénombre de nous-mêmes, de cette moiteur que l'on sent entre les doigts, entre les muscles entortillés sur le dessus de nos entrailles, cette pénombre plus épaisse que la purée des cailloux. Dans cette pénombre, on plonge par le soupirail. On y nage. On s'y enterre. La création du monde vient du fond de la terre, contrairement au travail qui vient du ciel. La création humaine est étrangère au labeur, aux tâches moitié domestiques moitié mécaniques. Elle n'a ni poids ni mesure, mais elle a tout le temps pour elle. Tout le temps? Peut-être. Pour l'heure, elle s'y étire, parfois sauvagement. Un mot chasse l'autre, une image en efface une autre, une pensée cesse de penser.
Dans cet enchevêtrement de miroirs entre histoire, imagination et réalité, il n'est pas certain que le lien entre les différents chapitres soit tout à fait évident pour le lecteur, mais à trop réfléchir, en lisant, n'échappe-t-on pas au gré des incertitudes de son auteur, à l'essentiel, à la trace brute et sauvage, pas encore polie, lissée par l'intelligence? Les plus beaux passages du Manifeste incertain touchent à la pensée propre et fissurée de Frédéric Pajak, davantage qu'à ses épisodes consacrés à Walter Benjamin, Rainer-Maria Rilke ou Samuel Beckett, bien que l'ensemble soit à prendre en considération. Ainsi - outre un extrait que vous pouvez retrouver sur La scie rêveuse, dans Morceaux choisis - le point culminant de son art est atteint avec les Esprits: Les Esprits, enfouis au plus profond de la terre, décident de revenir au monde. Ils ne sont ni des immortels ni des fantômes, mais simplement des Esprits. Ils forment une espèce de cohorte, portent chacun le nom d'un sentiment puissant. Ily a le Bonheur, le Désespoir, l'Appétit. Et puis la Fatigue, longue femme amaigrie, les yeux rougis de larmes, la coiffure comme une botte de foin brûlé. Dans la cohorte, il y a encore la Douleur, la Joie, la Peur, le Chagrin et d'autres encore...
Pour la suite de ce texte, je vous laisse en poursuivre la lecture dans le Manifeste incertain, premier volume d'un nouveau cycle, aux Editions Noir sur Blanc: un ouvrage singulier tantôt visuel et provocateur comme un film de Jean-Luc Godard, tantôt dépouillé à l'extrême comme un monologue de Samuel Beckett... Original, à vous d'en juger!
A ce jour, Frédéric Pajak, néà Suresnes en 1955, est l'auteur d'une vingtaine de livres, patrmi lesquels Le bon larron (Campiche, 1987), Martin Luther - l'inventeur de la solitude (L'aire, 1997), L'immense solitude - avec Friedrich Nietzsche et Cesar Pavese (Presses Universitaires de France, 1999), L'étrange beauté du monde (Noir sur Blanc, 2008 - avec Léa Lund) et En souvenir du monde (Noir sur Blanc, 2010 - avec Léa Lund).
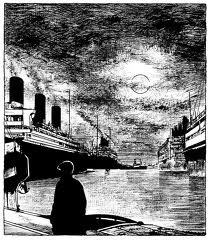

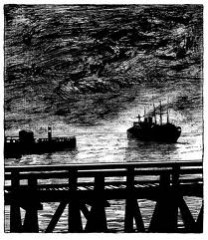
Frédéric Pajak, Manifeste incertain, Volume 1 (Noir sur Blanc, 2012)
images: Frédéric Pajak, Dessins illustrant le texte : Manifeste incertain
07:38 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2012
Sur un air de fête
Bloc-Notes, 23 décembre / Les Saules
A l'approche de ce temps des fêtes, vous êtes toutes et tous, chers amis fidèles ou de passage, présents à mon coeur. Vous êtes une part importante de ma joie intérieure, par votre présence, vos témoignages, vos signes d'amitié, vos commentaires ou suggestions: semblables à l'olivier, symbole de sagesse, de générosité et d'éternité...
A votre manière - inconsciemment, j'en suis sûr - vous me faites grandir, chaque jour. Au contraire, je m'en veux parfois de ne pas naviguer autant que je le voudrais sur les pages de vos sites et blogs, ou prends parfois un temps certain pour répondre à votre courrier: la faute à une balance inconstante du temps réparti entre mes proches, les tâches ingrates du quotidien, les plaisirs du jardin, la passion de la lecture et de la musique, enfin La scie rêveuse et Facebook.
J'espère néanmoins faire mieux l'année prochaine et vous embrasse très fort, comme si vous étiez là, sous ma fenêtre...

images: Les Saules, Cologny (2011/2012)
10:04 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Le monde comme il va | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la scie rêveuse; facebook |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2012
Bruno Le Maire 1c
Bloc-Notes, 15 décembre / Les Saules
Voici trois exemples de l'art de Carlos Kleiber, soit la Symphonie No 4, Op 98 de Johannes Brahms (avec le Wiener Philharmoniker), Le Freischütz / Ouverture, Op 77 - de Carl Maria von Weber (avec le Südfunk-Sinfonieorchester, et pour finir les Symphonies No 4, Op 60 et 7, Op 92 de Ludwig van Beethoven...
Bruno Lemaire, Musique absolue – Une répétition avec Carlos Kleiber (Gallimard, 2012)
16:44 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Carlos Kleiber, Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Musique classique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique classique |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |













