30/09/2010
Robert Bober
Bloc-Notes, 30 septembre / Les Saules

Connaissez-vous cet auteur aussi discret que ses personnages, Robert Bober? Il est né à Berlin en 1931 de parents juifs, d'origine polonaise. Fuyant le nazisme, sa famille se réfugie en France. En juillet 1942, prévenus par des amis, ils parviennent à échapper à la rafle du Vel d'Hiv. Quelques années plus tard, il entreprend un apprentissage de tailleur, métier qu'il exercera jusqu'à l'âge de 22 ans, pour se tourner ensuite vers la poterie. Par la suite, il dispense l'été des cours dans des résidences secondaires et mène parallèlement des projets thérapeutiques avec des enfants malades. Il aidera notamment des enfants ayant perdu tout lien social à la suite de la guerre.
Dans les années 50, il rencontre François Truffaut et devient son assistant sur les films Les Quatre Cents Coups, Tirez sur le pianiste et Jules et Jim. En 1967, il réalise son premier documentaire pour la télévision, Cholem Aleichem: un écrivain de langue yiddish. Dans les années 60 et 70, ses documentaires pour la télévision explorent pour l'essentiel la période de l'après-guerre et les conséquences de l'Holocauste.
A partir des années 80, en collaboration avec Pierre Dumayet, il réalise des portraits d'auteurs tels que Paul Valéry, Gustave Flaubert ou encore Georges Perec, avec lequel il était également ami. Son premier roman, Quoi de neuf sur la guerre ? est publié en 1993. L'auteur est alors âgé de soixante ans et reçoit pour ce livre, le Prix du Livre Inter. L'histoire se déroule lors de la première année d'après-guerre et met en scène un atelier de confection pour dames de la rue de Turenne, à Paris. Robert Bober nous raconte, d'un ton en apparence léger, presque réjoui, la manière dont les différents personnages mis en scène ont été épargnés, survivant ainsi à la guerre.
Suit Berg et Beck en 1999 - l'auteur nous y raconte la vie d'enfants juifs après la déportation de leurs parents ainsi que leur survie à la perte de ces êtres chers - et Laissées-pour-compte en 2005, une des créations les plus originales de ces dernières années - sur un thème plus léger que celui des titres précédents - et déjà évoquée dans ces colonnes.
Il nous revient aujourd'hui avec On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux, titre emprunté à l'auteur de La plupart du temps, Pierre Reverdy. Avec son style magique de conteur, il nous entraîne cette fois-ci sur le plateau du tournage de Jules et Jim où le personnage central du roman, Bernard - un double de son ami Robert, à la fois inventé et bien réel - se voit confier un rôle de figurant. Cet événement sert de prétexte à décrire, de Belleville à Ménilmontant, le Paris des années 60, ses cafés, ses artistes, les chansons d'Aristide Bruant, les films de Marcel Ophüls, de Jacques Becker et bien sûr de François Truffaut. A la manière d'un Robert Doisneau, le regard de Robert Bober nous entraîne avec beaucoup de tendresse, d'humour et de nostalgie, dans ce récit truffé d'anecdotes pittoresques, qui n'en est pourtant qu'à ses balbutiements.
A la fin du tournage, en effet, Bernard tout fier d'apparaître dans le film, invite sa mère au cinéma pour partager avec elle ce moment de bonheur. A la sortie de la salle, sa mère bouleversée, s'accroche à son bras et lui confie que Jules et Jim - un ménage à trois, disait François Truffaut - c'est son histoire... Il va ainsi plonger dans le passé, sur la trace de son père qu'il a perdu trop jeune - mort en déportation - et de son beau-père - disparu dans l'avion qui coûta la vie à Marcel Cerdan - tous deux amoureux de la même femme, sa mère, amis depuis leur jeunesse en Pologne. La correspondance avec sa tante des Amériques, Esther - la soeur de son père, nous immerge une fois encore dans le monde du cinéma, des Ziegfeld Follies à Harpo Marx, renouant par ce biais les liens familiaux qui, pour un temps, s'étaient malencontreusement interrompus.
Au dernier chapitre de ce livre, le narrateur entreprend un voyage à Auschwitz, pour rejoindre son père, une dernière fois: Je n'ai pas noté le numéro du block consacré aux déportés venant de France. Celui où naturellement on nous conduisit d'abord. Je n'ai pas entendu ce que dans ce lieu le guide nous disait. Il y avait là, devant moi, la photographie de mon père. Celle que je connaissais et que j'avais toujours vue dans son cadre de cuir brun posée sur le buffet de la salle à manger. Sur cette photo, considérablement agrandie, mon père avait retrouvé sa dimension d'homme. Nous étions là, ensemble, debout, tout près, l'un en face de l'autre, dans la même immobilité. Nous avions le même âge. Il me souriait.
Beaucoup d'émotion contenue, de délicatesse et de pudeur dans ce roman de Robert Bober qui évite soigneusement les pièges du mélodrame, avec cette infinie douceur d'un funambule qui foule la neige, atténuant les rumeurs alentour, les yeux tendus vers le ciel et les étoiles.
Robert Bober, On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux (P.O.L., 2010)
sources biographiques: Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bober
00:09 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2010
Le poème de la semaine
Philippe Soupault
Je ne dors pas Georgia
Je lance des flèches dans la nuit Georgia
j'attends Georgia
Le feu est comme la neige Georgia
La nuit est ma voisine Georgia J'écoute les bruits tous sans exception Georgia
je vois la fumée qui monte et qui fuit Georgia
je marche à pas de loup dans l'ombre Georgia
je cours voici la rue les faubourgs Georgia
Voici une ville qui est la même
et que je ne connais pas Georgia
je me hâte voici le vent Georgia
et le froid et le silence et la peur Georgia
je fuis Georgia
je cours Georgia
Les nuages sont bas il vont tomber Georgia
j'étends les bras Georgia
je ne ferme pas les yeux Georgia
j'appelle Georgia
je t'appelle Georgia
Est-ce que tu viendras Georgia
bientôt Georgia
Georgia Georgia Georgia
Georgia
je ne dors pas Georgia
je t'attends Georgia
Quelques traces de craie dans le ciel,
Anthologie poétique francophone du XXe siècle
00:04 Écrit par Claude Amstutz dans Quelques traces de craie dans le ciel - Anth | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; poésie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2010
Philippe Claudel 1b
En complément au roman de Philippe Claudel, L'enquête, voici le texte de Franz Kafka, Devant la loi, lu par Orson Welles, en introduction à son film Le procès, réalisé en 1962, avec pour interprètes principaux Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Akim Tamiroff, Madeleine Robinson et Orson Welles. A la suite de ce document, vous pouvez découvrir le texte en langue française.
Devant la loi se dresse le gardien de la porte. Un homme de la campagne se présente et demande à entrer dans la loi. Mais le gardien dit que pour l'instant il ne peut pas lui accorder l'entrée. L'homme réfléchit, puis demande s'il lui sera permis d'entrer plus tard. «C'est possible», dit le gardien, «mais pas maintenant». Le gardien s'efface devant la porte, ouverte comme toujours, et l'homme se baisse pour regarder à l'intérieur. Le gardien s'en aperçoit, et rit. «Si cela t'attire tellement», dit-il, «essaie donc d'entrer malgré ma défense. Mais retiens ceci: je suis puissant. Et je ne suis que le dernier des gardiens. Devant chaque salle il y a des gardiens de plus en plus puissants, je ne puis même pas supporter l'aspect du troisième après moi.» L'homme de la campagne ne s'attendait pas à de telles difficultés; la loi ne doit-elle pas être accessible à tous et toujours, mais comme il regarde maintenant de plus près le gardien dans son manteau de fourrure, avec son nez pointu, sa barbe de Tartare longue et maigre et noire, il en arrive à préférer d'attendre, jusqu'à ce qu'on lui accorde la permission d'entrer. Le gardien lui donne un tabouret et le fait asseoir auprès de la porte, un peu à l'écart. Là, il reste assis des jours, des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être admis à l'intérieur, et fatigue le gardien de ses prières. Parfois, le gardien fait subir à l'homme de petits interrogatoires, il le questionne sur sa patrie et sur beaucoup d'autres choses, mais ce sont là questions posées avec indifférence à la manière des grands seigneurs. Et il finit par lui répéter qu'il ne peut pas encore le faire entrer. L'homme, qui s'était bien équipé pour le voyage, emploie tous les moyens, si coûteux soient-ils, afin de corrompre le gardien. Celui-ci accepte tout, c'est vrai, mais il ajoute: «J'accepte seulement afin que tu sois bien persuadé que tu n'as rien omis». Des années et des années durant, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Il oublie les autres gardiens. Le premier lui semble être le seul obstacle. Les premières années, il maudit sa malchance sans égard et à haute voix. Plus tard, se faisant vieux, il se borne à grommeler entre les dents. Il tombe en enfance et comme, à force d'examiner le gardien pendant des années, il a fini par connaître jusqu'aux puces de sa fourrure, il prie les puces de lui venir en aide et de changer l'humeur du gardien; enfin sa vue faiblit et il ne sait vraiment pas s'il fait plus sombre autour de lui ou si ses yeux le trompent. Mais il reconnaît bien maintenant dans l'obscurité une glorieuse lueur qui jaillit éternellement de la porte de la loi. À présent, il n'a plus longtemps à vivre. Avant sa mort toutes les expériences de tant d'années, accumulées dans sa tête, vont aboutir à une question que jusqu'alors il n'a pas encore posée au gardien. Il lui fait signe, parce qu'il ne peut plus redresser son corps roidi. Le gardien de la porte doit se pencher bien bas, car la différence de taille s'est modifiée à l'entier désavantage de l'homme de la campagne. «Que veux-tu donc savoir encore?» demande le gardien. «Tu es insatiable.» «Si chacun aspire à la loi», dit l'homme, «comment se fait-il que durant toutes ces années personne autre que moi n'ait demandé à entrer?» Le gardien de la porte, sentant venir la fin de l'homme, lui rugit à l'oreille pour mieux atteindre son tympan presque inerte: «Ici nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, je m'en vais et je ferme la porte.»
Franz Kafka, Devant la loi - Le procès (coll. Folio/Gallimard, 1998)
00:15 Écrit par Claude Amstutz dans Films inoubliables, Franz Kafka, Littérature étrangère, Littérature francophone, Philippe Claudel | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : auteurs; littérature; film; livres; |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
Philippe Claudel 1a
Bloc-Notes, 23 septembre / Les Saules

Un des thèmes majeurs de l'oeuvre de Philippe Claudel, repose sur la conscience de l'individu confronté à celle de la société, habile à le blesser, le broyer, le détruire. Il nous l'a brillamment démontré avec Les âmes grises et, plus récemment, avec Le rapport de Brodeck. Il en va de même pour L'enquête, sauf que l'auteur n'interroge plus le passé - les horreurs des guerres de 14-18 et 39-45 - mais le monde d'aujourd'hui ou, pour les plus optimistes, celui d'un futur proche.
Dès les premières lignes de ce roman exceptionnel, on songe à Franz Kafka et son court texte intitulé Devant la loi: Un homme est envoyé dans une ville inconnue - par qui, nous ne le saurons jamais - afin d'enquêter au sein d'une Entreprise sur une vague de suicides inexpliqués. A peine parvenu à destination, il réalise que tout concourt à l'empêcher de mener à bien sa mission. Aucun interlocuteur ne répond à ses questions, tantôt le menaçant, tantôt lui prodiguant une sympathie déconcertante. Les lieux eux-mêmes lui semblent inquiétants, hostiles ou irréels.
Toute la ville paraissait se résumer dans l'Entreprise, comme si celle-ci, peu à peu, dans un processus d'expansion que rien n'avait pu freiner, s'était étendue au-delà de ses limites premières, avalant ses périphéries, les digérant, les assimilant en leur instillant sa propre identité. Il se dégageait de tout cela une force mystérieuse qui donna un bref vertige à l'Enquêteur. Lui qui depuis très longtemps avait conscience que sa place dans le monde et la société relevait de l'échelle microscopique découvrait, face à ce paysage de la démesure de l'Entreprise, une autre forme de malaise, celui de son anonymat. En plus de savoir qu'il n'était rien, il se rendait compte soudain qu'il n'était personne.
Avec la désagréable impression d'être constamment épié par des yeux invisibles, d'être transparent pour tous ceux qu'il côtoie, en proie à des cauchemars dont il se demande s'ils sont le fruit de son imagination ou le reflet de la réalité, notre Enquêteur va, avec l'énergie du désespoir, s'obstiner à vouloir lever le voile de cette pieuvre qui absorbe tout - jusqu'aux âmes - et le fait ressembler à une souris de laboratoire qui s'égare de plus en plus loin - jusqu'à la perte de son identité - dans un monde qui l'écrase. Notre monde? Il n'est plus temps de descendre dans les rues et de couper la tête aux rois. Il n'y a plus de rois depuis bien longtemps. Les monarques aujourd'hui n'ont plus ni tête ni visage.
Voyage au coeur de l'absurde, de l'aliénation et du doute, cette histoire se lit comme une fable cruelle et terrifiante sur l'individu incapable désormais de tirer la moindre des ficelles à son avantage, à force de ne plus chercher un sens à sa vie, de n'oser dire non à l'intolérable, à l'humiliation, à l'indifférence, devenu un robot à la voix synthétique tel celui que nous entendons chaque matin dans les autobus, les gares ou les aéroports.
On l'aime bien, cet Enquêteur pourtant ordinaire, mais consciencieux, honnête. On s'accroche à lui, seul contre tous semble-t-il capable encore d'éprouver de la compassion ou un sursaut de révolte malgré tous les obstacles qui lui sont tendus, soucieux d'accomplir sa mission: Son unique raison de vivre. Mais pour lui aussi, n'est-il pas déjà trop tard? Avez-vous conscience que vous ne parlez que par fonction depuis le début de notre entretien? Vous êtes l'Enquêteur, vous évoquez le Policier, le Guide, le Veilleur, le Serveur, le Garde, le Responsable, le Vigile, le Fondateur. Vous n'employez jamais de noms propres, ni pour vous, ni pour les autres. (...) Vous déniez toute humanité, en vous et autour de vous. Vous regardez les hommes et le monde comme un système impersonnel et asexué de fonctions, de rouages, un grand mécanisme sans intelligence...
Un dernier personnage, l'Ombre, délivrera la clef à notre homme, mais à quel prix? Chapitre manquant au meilleur des mondes possibles, ce livre à peine refermé, on s'interroge: Avons-nous traversé un mauvais rêve ou nos pieds foulent-ils les eaux immobiles d'une réalité qui nous colle à la peau et se révèle à nous dans toute sa monstruosité? Certains chapitres, dont celui consacré aux Déplacés, ne laissent planer aucun doute...
Philippe Claudel, L'enquête (Stock, 2010)
00:15 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Franz Kafka, Littérature francophone, Philippe Claudel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2010
Le poème de la semaine
René de Obaldia
Une jeune fille au fond de mon coeur
Lave mes péchés, lave mes péchés.
Une jeune fille morte de bonheur
Et qui vit en moi pour l'éternité.
Lave mes péchés dans une eau si claire
Que tous les aveugles pourraient y boire.
Le loup et l'agneau sont maintenant frères,
Qu'il fait bon trouver cet heureux lavoir!
Deux colombes d'or forment sa poitrine,
Sa bouche est le temple où souffle l'Esprit
Son ventre est plus doux que celui des tombes
Dans ses mains de neige un feu se nourrit.
Parfois je m'endors contre sa poitrine.
Et tous mes péchés qui s'en vont à l'eau
Feraient de mon âme une âme orpheline
Mais la jeune fille l'habille d'oiseaux.
Un soleil m'éclaire qui vient de très loin
Un soleil de chair que je peux toucher
Et la joie est là comme un fin clocher
Et le ciel a pris une odeur de foin.
Jeune fille pure ô ma belle épée
Riant aux éclats devant la douleur,
Je te porterai le long des années
Plus loin que la mer où sombrent nos coeurs.
Le long des années qui deviennent blanches
Et la neige tombe aux mains des enfants
Je te porterai mon premier Dimanche
Plus loin que la mer et la fin des temps.
Quelques traces de craie dans le ciel,
Anthologie poétique francophone du XXe siècle
00:03 Écrit par Claude Amstutz dans Quelques traces de craie dans le ciel - Anth | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; poésie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2010
La citation du jour
Christian Bobin

Un homme arrive au paradis. Il demande à un ange de lui montrer le chemin qu'ont dessiné ses pas su terre. Par curiosité. Par enfantin désir de voir et de savoir. Rien de plus simple, dit l'ange, allez vers cette fenêtre et regardez. L'homme approche son visage de la vitre et contemple la trace de ses pas sur la terre, depuis son enfance jusqu'à son dernier souffle. Quelque chose l'étonne: parfois il n'y a plus de traces. Parfois le chemin s'interrompt et ne reprend que bien plus loin. Ces absences, dit l'ange, correspondent à ces jours où votre vie était trop lourde pour que vous puissiez la porter. Je vous prenais donc dans mes bras, jusqu'au jour suivant, où la joie vous revenait et vos forces avec elle. Si je dispose cette fable au seuil de ce livre, c'est que je n'ai jamais écrit qu'ainsi: porté par plus léger que moi, dans les bras - non pas de l'ange - mais de la vie passante, de l'étincelante rumeur de vivre.
Christian Bobin, La vie passante (Fata Morgana, 1990)
00:06 Écrit par Claude Amstutz dans La citation du jour | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : citations; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2010
Le poème de la semaine
Louis Calaferte
Si vous êtes raisonnables toute la semaine
Si vous faites bien vos devoirs
Si vous apprenez bien vos leçons
Si vous ne vous battez pas avec vos camarades
Si vous ne tirez pas la queue du chien
Si vous mangez bien votre soupe
Si vous ne faites pas crier votre grand-mère
Si vous vous lavez les mains avant de vous mettre à table
Si vous vous brossez bien les dents
Si vous allez vous coucher sans pleurer
Si vous faites votre prière tout seuls
Si vous êtes bien sages avec maman
Dimanche on ira voir papa à l'asile
Je vous laisse tomber. Je ne marche pas dans vos conneries d'avenir idyllique.
Quelques traces de craie dans le ciel,
Anthologie poétique francophone du XXe siècle
06:01 Écrit par Claude Amstutz dans Quelques traces de craie dans le ciel - Anth | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; poésie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2010
La citation du jour
Charles Baudelaire

On dirait encore une de ces robes étranges de danseuses, où une gaze transparente et sombre laisse entrevoir les splendeurs amorties d'une jupe éclatante, comme sous le noir présent transperce le délicieux passé; et les étoiles vacillantes d'or et d'argent, dont elle est semée, représentent ces feux de la fantaisie qui ne s'allument bien que sous le deuil profond de la nuit.
Charles Baudelaire, Le crépuscule du soir / Le spleen de Paris (coll. Poésie/Gallimard, 2006)
00:21 Écrit par Claude Amstutz dans Charles Baudelaire, La citation du jour | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : citations; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2010
Le poème de la semaine
Andrée Chedid
Nos jours sont éphémères
Plus rapides que le temps
La clarté nous surprend
Déjà c'est crépuscule
C'est si court
Un seul jour
Mais si vaste à la fois
Chaque journée est une fête
Une vraie épiphanie
Pleine de tous les rêves
De toutes les panoplies
Dont le futur est maître
Retenant nos mémoires
Et chroniques du temps
Si longue est notre vie
Ces journées éphémères
Pas le temps
De les perdre
Si brève est notre vie!
Quelques traces de craie dans le ciel,
Anthologie poétique francophone du XXe siècle
00:22 Écrit par Claude Amstutz dans Andrée Chedid, Quelques traces de craie dans le ciel - Anth | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2010
Jean d'Ormesson
Bloc-Notes, 9 septembre / Les Saules
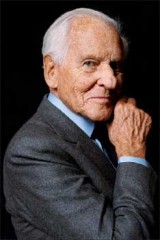
Je ne me suis jamais ennuyé avec Jean d'Ormesson, parce qu'il aime la vie, parce qu'il aime le monde et que je partage bon nombre de ses valeurs: l'insolence, l'ironie, la gratitude, l'ordre, l'admiration, la gaieté, le présent, les contradictions de l'existence, les commencements, la Méditerranée, Saint Augustin, Ernst Lubitsch, George Cukor...
Il en parle avec ardeur, passion et humour, souvent: Je mourrai. J'aurais vécu. Je me suis souvent demandé ce que j'avais fait de ma vie. La réponse était assez claire: je l'ai aimée. J'ai beaucoup aimé ce monde. (...) Je sais que j'y ai été heureux. Intarissable, dans son dernier ouvrage, C'est une chose étrange à la fin que le monde, il embarque ses lecteurs pour un formidable tour du monde de la pensée qui s'étend des origines de l'univers à nos jours, croisant la route des philosophes, des religieux, des scientifiques, des bâtisseurs, des conquérants, des écrivains, dans ce labyrinthe du réel qui prétend tout expliquer mais échoue devant le mystère de la vie, de la raison d'être, du sens de tous ces bouillonnements de la création. Sous l'oeil parfois amusé du Vieux - dans son livre - c'est-à-dire Dieu en personne.
Vallée de larmes et de roses - selon sa propre expression - il réserve à la vie des pages éblouissantes: Le présent est une prison sans barreaux, un filet invisible, sans odeur et sans masse, qui nous enveloppe de partout. Il n'a ni apparence ni existence, et nous n'en sortons jamais. Aucun corps, jamais, n'a vécu ailleurs que dans le présent, aucun esprit, jamais, n'a rien pensé qu'au présent. C'est dans le présent que nous nous souvenons du passé, c'est dans le présent que nous nous projetons dans l'avenir. Le présent change tout le temps et il ne cesse jamais d'être là. Et nous en sommes prisonniers. Passagère et précaire, affreusement temporaire, coincée entre un avenir qui l'envahit et un passé qui la ronge, notre vie ne cesse jamais de se dérouler dans un présent éternel - ou quasi éternel - toujours en train de s'évanouir et toujours en train de renaître.
Le Temps, comme dans la plupart de ses écrits, occupe une place prépondérante, mais par une approche à la fois ingénieuse et légère, un style épuré qui se concentre sur l'essentiel de ses interrogations: Tout ce qui est né mourra. Tout ce qui est apparu dans le temps disparaîtra dans le temps. Au commencement des choses, il y a un peu moins de quatorze milliards d'années, il n'y avait que de l'avenir. A la fin de ce monde et du temps, il n'y aura plus que du passé. Toute l'espérance des hommes se sera changée en souvenir. En souvenir pour qui?
Un bon livre, ce Jean d'Ormesson? Le meilleur - à mon avis - depuis C'était bien (Gallimard 2003) car pour paraphraser son auteur, j'en sors changé, bousculé et moins égaré, conscient de ma chance inouïe d'être vivant, de connaître des fragments d'espérance, de bonheur et de confiance.
Pour terminer, une anecdote un peu caustique du Vieux à qui il fait dire: Il n'y a que les Suisses dont j'aurais un peu de mal à raconter quoique ce soit. Ils sont heureux dans leurs montagnes où ils passent leur temps à élever des vaches et des comptes en banque. Dieu est un peu sévère! Cela dit, Jean d'Ormesson se rachète une conduite en citant L'usage du monde de Nicolas Bouvier, que plus jeune, il emportait avec lui...
Jean d'Ormesson, C'est une chose étrange à la fin que le monde (Laffont, 2010)
00:05 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Jean d'Ormesson, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












