15/02/2013
Morceaux choisis - Carlos Liscano
Carlos Liscano

Un jour on fait une fête. On annonce à l'un de nos camarades de cellule que sa femme, détenue ailleurs, vient de mettre au monde une petite fille. La mère et l'enfant se portent bien. Les yeux du père se remplissent de larmes. Nous le serrons sur notre coeur, nous chantons en son honneur, nous plaisantons.
Alors le père, plein de décision, fait quelque chose que personne ne peut croire. Il trouve une aiguille et du fil, ôte sa chemise et commence à la couper en morceaux. Puis il prend un marqueur. Il est merveilleusement adroit de ses mains. En une demi-heure il a fabriqué une poupée, à grands yeux, longs cils, lèvres rouges. C'est son cadeau pour la petite qui vient de naître. La poupée a l'air belle. C'est la première fois, et jusqu'ici la seule, que je vois naître une poupée. Une poupée unique, née des mains d'un homme, parmi des hommes.
Carlos Liscano, Le fourgon des fous (coll. 10-18/UGE, 2008
traduit du sud-américain par Jean-Marie Saint-Lu
07:37 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature sud-américaine, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2013
Clémence Boulouque 1b
Morceaux choisis

Kippour 20... Jour du Grand Pardon.
Onze heures du matin. Il me reste neuf heures et trente-trois minutes de migraine. Dans une salle de concert, transformée en synagogue, je tourne les pages du Mahzor, le livre de liturgie. Je me demande pourquoi obéir à ces commandements. Vingt-cinq heures de jeûne et de soif au terme desquelles résonnera la bénédiction: Shana tova. Gmar hatima tova. Bonne année. Bonne inscription.
Inscris-moi, Seigneur, dans le livre de la vie, est l'une des prières répétées plusieurs fois pendant onze heures d'affilée, au long de cette journée d'affliction. Je regarde autour de moi, articule des mots sans penser à ce que murmurent mes lèvres, et essaie de sourire pour me donner des forces, et je me révolte, décide que je ne sais plus pourquoi je m'affame, après tout, c'est Dieu qui devrait jeûner pour nous, il a tout l'univers à se faire pardonner. Je doute d'arriver au bout de la journée, comme chaque année.
Et soudain, mes yeux replongent vers le livre et voient: je n'emporte rien du monde, une citation d'Isaïe, la phrase qui me relie à elle, celle que je cherchais depuis des années, et j'entends la voix de Julie, surgir un jour d'expiation. Venue m'escorter dans la faiblesse, dans le jour où tout est vain et essentiel, où tout s'efface, flotte, où le monde se suspend, consigné à la sortie de cette assemblée. Où il nous est enjoint de trouver de nouvelles définitions de soi, se redessiner. Les étymologies hébraïques m'étourdissent. Baharut signifie adolescence. Harut signifie graver. Herut veut dire liberté.
Tu n'as rien emporté, non. Tu m'a laissé cette adolescence. Quelque chose d'une liberté à graver. Un retrait, maladif, peut-être. Je regarde le monde s'agiter, blesser, me blesser parfois, et je pense que la vie est ailleurs.
Dans le baiser que tu m'as volé, et que je t'aurais abandonné, si tu me l'avais demandé.
Clémence Boulouque, Je n'emporte rien du monde (Gallimard 2013)
image: Marc Chagall, L'ange au chandelier (ipaintingsforsale.com)
00:39 Écrit par Claude Amstutz dans Clémence Boulouque, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
01/01/2013
Morceaux choisis - Jean-Michel Maulpoix
Jean-Michel Maulpoix

Tu voudrais marcher sur la neige à pas de vair, entendre la blancheur crisser, palper la fourrure tiède des contes, t'abandonner à leur sommeil comme à un oreiller où blottir la tête quand quelqu'un raconte une histoire. Chaque fois que ton coeur craque. tu prends ton dé, ta trousse et tes aiguilles: des mots encore avec des mots, bouts de bois, cabanes d'enfants, excès, accès de ciel, fièvres d'encre, une convoitise de bleu, sa mélancolie de jupes claires; tu es l'ouvrier de l'amour.
Jean-Michel Maulpoix, Une histoire de bleu (Mercure de France, 1992)
image: vergson.canalblog.com
09:46 Écrit par Claude Amstutz dans Jean-Michel Maulpoix, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2012
Morceaux choisis - Colette Fellous
Colette Fellous

Longtemps, j'ai fait ce rêve. Je dois le raconter ici avant de le perdre. Je sais surtout qu'il a sa place dans ce récit d'Amor. C'est peut-être bien à Venise, peut-être bien à Babylone ou à Midoun, peut-être bien aussi à Roquefort que la scène se passe. Peu importe, c'est un vrai rêve.
Je suis morte et je marche avec les autres, les amis, les voisins, les gens du village, derrière le cercueil. C'est mon cercueil, je dois être enfermée là-dedans, mais je n'y pense même pas, je marche, je me sens bien, j'ai confiance, presque heureuse. Je ne sais pas comment je suis morte. Ils n'en parlent pas, ils sont là, c'est tout, le ciel est bleu, tout va bien, le cortège remonte la rue du village, quelques curieux se sont amassés sur le bord du trottoir, les mains au dos. Je reste sur le côté pour ne pas me faire remarquer. Je m'amuse, à les regarder, tiens, lui, je n'aurais pas pensé et elle, là-bas, c'est gentil d'être venue, je me dis que, vu d'ici, ce n'est pas si grave finalement de disparaître, il flotte un petit air de fête avant le bal, une façon d'être ensemble, de partager quelque chose, une douce odeur d'après-midi.
Après, justement, il y a un bal, vous y viendrez, j'espère? Oui, oui, bien sûr, je n'y manquerai pas. Un très beau bal masqué, avec des grenades, des figues, des mûres et des friandises posées sur une grande table à côté, mais dans le rêve je ne les vois pas, je sais simplement que les grandes coupes blanches et bleues sont à l'intérieur de la maison. Elles appartiennent à mes ancêtres, on ne les sort que pour les fêtes. Je les suis en silence, les invités, je vais avec eux vers ma maison d'ocre, au bout du village, cette maison qui sent toujours si doux le santal. De l'autre côté, derrière le jardin, on sait qu'il y a la mer, une baie vitrée donne directement sur la plage. Ils se sont tous déguisés pour l'occasion. Ils dansent dans le petit patio, un jasmin découpe le ciel au-dessus, quelques branches d'un bougainvillier retombent sur le mur. Je me suis cachée sous la toile rayée d'un transat posé dans un coin du patio et je les regarde tous, j'admire les costumes, j'apprécie la gaieté de la soirée, j'ai le vertige.
Tout à coup, la pluie. Tellement inattendue. Comment faire? J'ai peur d'être découverte, mon coeur hurle, la musique heureusement recouvre ma peur, le rêve s'emballe, accordéon, piano et violoncelle, bruits de chaises qu'on déplace. Comme prévu, la toile du transat se mouille bien vite et dessine peu à peu la forme de mon corps. Je suis perdue, ils vont me reconnaître et voir que je ne suis pas vraiment morte. Alors, tant pis, je décide de ne plus me cacher, après tout je suis là, je ne vais pas mentir simplement pour ne pas les gêner, allez, je me montre, je cours au centre du patio et je me mets à danser avec les autres. Une vraie danse, joyeuse, libre, vivante. Tout le monde applaudit, bravo, bravo, c'est le plus beau costume de la soirée, elle a osé mettre le masque de la morte.
Je me réveille d'un coup, je touche mon visage, vite, un verre d'eau bien fraîche, c'est si beau alors d'aller dans le noir vers le robinet, dans cette maison qui sent encore le santal.
Colette Fellous, Amor (Gallimard, 1997)
image: Jean-Léon Gérôme, Suites d'un bal masqué / Musée Condé, Chantilly (www.photo.rmn.fr)
18:28 Écrit par Claude Amstutz dans Colette Fellous, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
09/10/2012
Morceaux choisis - Henri Cueco 1a
Henri Cueco

- La salade monte. Il fait trop chaud. Et puis, ce peu de pluie d'hier... Il te faut la ramasser. Dans deux jours, elle fera un mètre de haut. Et c'est pas bon. Tu en as de bonnes au fond de ton carreau. Tiens, regarde ici.
- On peut pas manger quatre-vingt pieds de salade à la fois.
- Eh non, mais demain elle sera foutue.
- J'en veux bien deux pieds pour midi, et toi prends-en.
- J'en ai dans mon jardin, au bord de la rivière, peut-être deux cents pieds hauts comme ça.
- On est trop riches.
- Et les courgettes? Tu n'aimes pas les courgettes?
- Pas trop. Bouillies, c'est un peu... Et toi?
- Ca n'a pas de goût, mais j'aime les voir pousser. Elles ont profité depuis la dernière fois. Les courgettes, ça me fait rire. Je ris de voir pousser les courgettes. Elles ont l'air de faire des blagues à pousser comme ça. C'est comme des bigoudis sur la tête des femmes le dimanche matin. T'en vois qui passent en courant sur les balcons des HLM. Elles se croient nues parce qu'elles ont leur papillotes. Elles galopent d'une porte à l'autre. Eh bien, les courgettes, tu dirais des bigoudis.
- Et les choux?
- C'est beau, un beau chou.
- Pourquoi c'est beau?
- C'est beau parce que c'est beau...
- En voilà un raisonnement...
- Je voulais dire... Mais dis donc, chaque fois qu'on parle de ce qui est beau, tu me demandes ce que ça veut dire. Pour un chou, c'est la couleur, le dessin des côtes, la forme ronde. C'est comme si ça allait exploser. Quand j'étais gosse, on disait que les enfants venaient dans les choux.
- Maintenant on voit la photo du bébé dans le ventre de sa mère.
- Autrefois, le ciel, l'orage, la neige, une fleur, un oiseau, ce qu'on mange, tout racontait des histoires. L'orage, c'était le bon Dieu qui remue des barriques ou qui se fâche; la neige, c'était le bon Dieu qui plume ses oies. Un oiseau annonçait la saison ou le temps qu'il va faire. Les choses comme ça, avaient un sens. Maintenant, tu comprends rien de ce qui t'arrive, tu sais plus ni quoi ni qu'est-ce. Un légume,c'est qu'un légume. Enfin, ce qui se voit quand c'est emballé. Et un homme aussi, c'est de la marchandise emballée...
- Tu es un vrai philosophe.
- Dis, tant qu'on est au jardin, tu devrais regarder ces haricots. C'est des "beurre", ils sont à cueillir maintenant, après ils auront des fils que tu dirais de l'étoupe. Maintenant ils sont bons. Si tu veux, je les arrache et tu les cueilleras sur pied.
- C'est toi qui commandes.
- Les citrouilles, tu as vu les citrouilles? Celle-là qui a traversé le grillage, elle deviendra grosse... Le tuyau qui la remplit n'est pas coupé, c'est l'essentiel... Il faut pas couper le cordon, pas encore, sinon elle sera perdue.
- Tu crois qu'il y a des enfants dans les citrouilles?
- Des enfants, non, mais un carrosse, oui... Je trouve que ce jardin, ici, il est pas mal, mais il le faudrait plus grand, on pourrait faire plus de pommes de terre, de poireaux...
- Ah, les poireaux!
- Oui, eh bien j'alignerai des poireaux...
- Oui, on ferait des allées de poireaux. Les allées du parc du Prince des Poireaux... Et le coin des petites herbes de cuisine?
- Je t'en avait fait un. Où est-il?
- Il s'est perdu.
- Il y avait du thym, où c'est qu'il est passé, fils de loup! Et la ciboulette?
- Je voudrais l'année prochaine que tu fasses...
- Des petits pois mange-tout, je parie!
- Des petitspois et des mange-tout.
- J'en ai jamais vu. Tu m'en as parlé déjà, j'en ai jamais mangé. Trouve-moi la graine, je t'en ferai. C'est pas difficile si ça veut venir par ici.
- C'était comme ça dans le jardin de mon grand-père: des allées bien propres.
- Il faudrait les tasser, les allées, que la terre y soit dure. C'est plus beau.
- C'est quoi, que le jardin soit beau?
- Que les légumes y poussent bien et qu'il y ait de l'ordre.
- Ah, l'ordre... C'est comme les défilés militaires, alors. Tu trouves que c'est beau, les défilés?
- Je te parle du jardin.
- Tu parlais d'ordre.
- Peut-être. Quand tu fais tes peintures, tu fais bien de l'ordre; dans la pagaille de ce que tu vois, tu choisis. Tu fais du rangement et ça fait beau quand on a plaisir à s'y reconnaître, à retrouver son chemin. Ton jardin, c'est pas moi qui mange tes légumes, eh bien il est beau quand il me remercie d'avoir bien fait mon travail. S'il y avait de la broussaille, ça serait ma défaite. C'est comme une robe à une femme: ça la fait belle et c'est pas obligé que tu en profites avec elle... Elle est comme ça, en cadeau, pour rien, pour elle peut-être. C'est en plus...
Henri Cueco, Dialogue avec mon jardinier (coll. Points/Seuil, 2004)
image: Jardin, Gland (VD/Suisse, 2012)
10:58 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2012
Douna Loup 1c - Morceaux choisis
Douna Loup

Je suis née Nelly Machat.
Je mourrai Linda Breuse.
Grand écart, petit pas de côté. J'aime toutes les transfigurations.
Je déguise mes peines en rires, maquille des blessures à la bombe, je tague ma vie comme une jeune blonde qui va bientôt frôler les quatre-vingt-six ans. Le temps n'y changera rien. Je suis née au-delà des frontières. Je mourrai transfrontalière.
Je ne sais me tenir qu'aux lisières. Aux passages, toujours sidérée par la puissance du vil, par la prépondérance des forts, la loi de la jungle a soumis mon corps, je ne me débattrai pas, je saurai bien mourir quand le temps sera là, mais mon esprit n'abdiquera jamais, je suis une insurgée.
La vie me révolte. A bras-le-corps je la révolutionne. Je n'y ai jamais rien gagné mais, en bafouant ses codes, je me serai au moins brûlée de près au rêve de ma liberté.
Douna Loup, La paume de tes mains (Mercure de France, 2012)
image: Linda Naeff, Sculpture (http://wizzz.telerama.fr)
06:34 Écrit par Claude Amstutz dans Douna Loup, Littérature francophone, Littérature suisse, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2012
Morceaux choisis - Christian Bobin
Christian Bobin

merci à Claudine R
Il y a quelque chose de terrible dans chaque vie. Il y a, dans le fond de chaque vie, une chose terriblement lourde, dure et âpre. Comme un dépôt, un plomb, une tache. Un dépôt de tristesse, un plomb de tristesse, une tache de tristesse. À part les saints et quelques chiens errants, nous sommes tous plus ou moins contaminés par la maladie de la tristesse. Plus ou moins. Même dans nos fêtes elle peut se voir.
La joie est la matière la plus rare dans ce monde. Elle n'a rien à voir avec l'euphorie, l'optimisme ou l'enthousiasme. Elle n'est pas un sentiment. Tous nos sentiments sont soupçonnables. La joie ne vient pas du dedans, elle surgit du dehors — une chose de rien, circulante, aérienne, volante. On lui accorde beaucoup moins de crédit qu'à la tristesse qui, elle, fait valoir ses antécédents, son poids, sa profondeur. La joie n'a aucun antécédent, aucun poids, aucune profondeur. Elle est toute en commencements, en envols, en vibrations d'alouette.
C'est la chose la plus précieuse et la plus pauvre du monde. Il n'y a guère que les enfants pour la voir. Les enfants, les saints, les chiens errants. Et toi. Tu l'attrapes au vol, tu la redonnes aussitôt, il n'y a rien d'autre à en faire. Et tu ris, tu ne sais que rire devant tant de richesse donnée, reçue.
Tu as pourtant affaire, comme chacun, à cette chose terrible dans ta vie, à cette ombre terriblement lourde, dure, âpre. Tu lui fais place comme au reste. Tu ouvres la porte à la tristesse si aimablement qu'elle en est perdue, qu'elle en perd ses manières sombres et qu'on ne la reconnaît plus.
La grâce se paie toujours au prix fort. Une joie infinie ne va pas sans un courage également infini. Dans tes rires c'est ton courage que j'entendais: un amour de la vie si puissant que même la vie ne pouvait plus l'assombrir.
Christian Boblin, La plus que vive (coll. Folio/Gallimard, 1999)
image: http://www.photos-album.net
02:35 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2012
Morceaux choisis - Ananda Devi
Ananda Devi

Le bruit de la serrure est une blessure au milieu de la nuit. La porte s'ouvre. Une barre de lumière jaune crisse sur le plancher et rampe jusqu'à moi. Une voix lointaine et méprisée tente de me rassurer - soja rajkumari, soja - dors, dors, dors, ma princesse...
Tu vas te taire! Cette folle va réveiller tout le monde! Silence!
Oui, silence. En moi, en lui, dans les profondeurs du monde. Silence jusqu'au bout de mon silence, alors que seule, la grosse bouche qui flotte dans l'air au-dessus de moi parle. Elle a l'air de n'appartenir à aucun visage, mais, petit à petit, une forme se précise. Je sais qu'une masse de chair et de muscles l'accompagne et que je vais la rencontrer et la connaître, comme chaque soir, dans la plus secrète des souffrances. Les murs pâlissent comme à chaque fois qu'ils reçoivent les éclaboussures de sa haine. (...)
La forme masculine se déploie au-dessus de moi. Je regarde de haut mon corps étoilé sur lequel rôde l'ombre de ma faim et de ma peur. Je vois la stridence de mes yeux écarquillés, je vois mes mains qui offrent leur paume percée, je vois ma bouche qui s'ouvre pour avaler une goulée d'espoir, mais n'avale qu'une salive amère. Tout autour de moi, les murs sont peints en vert, sauf auprès du plafond, où la peinture s'est écaillée en fleurs de rouille. Une nuée de carias voltige autour de l'unique ampoule nue. Non loin du lit de fer, une cuvette pour mes besoins. Et ce corps balbutié, c'est moi. C'est ainsi. Les aliénés ne peuvent pas se plaindre, il n'y a personne pour les écouter.
Le murmure de l'homme m'atteint. Ses gestes et sa violence n'ont pas de limites. Mais je parviens encore une fois à m'échapper, à m'éloigner de tout cela. Je suis partie dans un coin de ma mémoire. J'écoute le chant de ma grand-mère grenier. Je respire l'odeur de son sari de coton blanc. Je l'entends qui me berce, longuement, longuement - soja rajkumari, soja -, je suis sa princesse recroquevillée dans le pan du sari tendu en berceau entre ses jambes inutiles, elle me masse les jambes et les bras avec de l'huile parfumée. Ton corps est parfait, me répète-t-elle sans cesse, comme sentant mon désarroi. Elle me regarde droit dans les yeux, elle ne détourne pas le regard de la fissure de ma bouche. Un jour il te viendra un prince qui t'aimera pour ce corps-là et aussi pour la beauté de tes yeux et puis encore pour la beauté qu'il verra en toi, à l'intérieur de ton corps, là.
Là. Elle pose la main à plat sur ma poitrine, jusqu'à l'endroit du coeur. Ce sera ton Prince Bahadour à toi.
Je ne veux pas rentrer en moi. Je veux encore écouter ses contes, ses histoires, ses rêves. Je veux faire partie de sa vie absente. C'est la seule façon de poursuivre. S'échapper, se diluer dans des songes incohérents et fous. C'est ce que nous faisons tous. Sans cela, les murs capitonnés ne cesseraient pas de se refermer sur nous. L'homme est parti, ayant terminé sa besogne. Je suis seule. Je peux redescendre et habiter mon corps, retrouver la floraison des brûlures qui me rattachent à la vie. La porte s'est refermée, ravalant la lumière et le monde. La solitude caresse mes orteils absents. Je fais silence en moi et je n'écoute pas les protestations de ma chair. A quoi cela servirait-il? Je n'ai pas d'auditoire. La vie m'épuise.
Le moindre bruit - cri de souris, grésillement d'insectes, frôlement des corps en marche - m'interpelle. Je l'écoute de tous mes sens. Je n'ai plus que cela pour me persuader que je vis encore, après la mise à mort répétée de chaque nuit. De nouveau dans le trou. Dans le noir vif de l'inconscience. Mais je ne dors pas. Mon regard est une lumière qui éclaire l'intérieur de mon sommeil, ces marées molles et lentes qui se déroulent sans hâte et sans raison en moi. Il s'est allumé un soir lointain où j'ai entendu pleurer un enfant, et ce pleur m'a éclaté l'esprit.
Pour le faire taire, j'ai plongé dans l'eau sa tête bouclée. Je l'ai regardé s'assoupir doucement, le chant de l'eau était sa berceuse. L'ombre de l'eau était sa couverture. La mare a eu un bruit sanglant, et l'enfant s'est tu.
L'amour, c'est aussi cela.
Ananda Devi, Moi l'interdite (Editions Dapper, 2000)
00:04 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
09/08/2012
Morceaux choisis - Vincenzo Consolo
Vincenzo Consolo
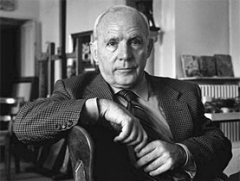
Alors toi, les vains présents des hôtes moqueurs, la tromperie du viatique, la hantise du but (tu as enfermé tes remords dans la cage de l'eau, dans la volière du vent) et moi, voix rauque dans l'air retentissant, gauche rapporteur de ton long voyage, allons. Le navire laboure l'étendue plate, le courant blafard, il fait lentement voile vers le port sûr, le rivage certain, vers les spectres du temps. L'histoire est toujours la même.
La tempête s'est apaisée, dans la grotte la nappe de l'écume se fige sur la jarre enfouie. Tu espères que le cercle - stigmates, taches et mousses fiévreuses - se refermera dans le calme. Ignore le présage, le doute philologique, qu'il puisse t'arriver de loin ou de la mer. Tu ne sais à qui dévoiler le secret qui gît dans les racines, dans le tronc de cet arbre, ta maison est vide, ton appel se perd en traversant les chambres. Tu avances en des couloirs d'ombre, tu te retournes et ne vois que tes traces. Une poussière tomba sur tes yeux, un sommeil dans l'absence. Que la fumée du soufre serve à ta conscience. Que le calme t'aide à présent à retrouver ton nom d'antan, le point de départ.
In my beginning is my end.
Et pourtant, des sirènes hurlent dans cette anse, des carcasses remontent à la surface, des navires clandestins abordent, l'aube ouvre leur vol aux oiseaux de passage. Par deux, gendarmes et artificiers avancent, en groupes, les âmes dissoutes, parfois les voix, les visages, les rues, les portes d'entrée et de sortie se confondent.
Recherche dans le grenier catalogues et cartes, recommence à partir de pâles traces - le désert est angoisse - la piste que le sable a recouverte. Que l'ermite, l'exilé, le reclus t'assistent, que la flamme d'une lampe, les sonorités du soir te guident, que ta peine, ta détresse t'absolvent.
Vincenzo Consolo, Le palmier de Palerme (Seuil, 2000)
traduit de l'italien par Jean-Paul Manganaro
07:21 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2012
Morceaux choisis - Raphaël Jerusalmy
Raphaël Jerusalmy

Après le rituel des accordements, des partitions qu'on pince sur les pupitres, des ultimes toussotements, Böhm a fait son entrée de maestro. Stefan a failli se lever pour se mettre au garde-à-vous. J'ai dû le retenir par la manche. Le pauvre était trop tendu pour profiter de l'ambiance magique qui règne dans une salle juste avant la représentation. Mais dès que la musique a commencé il a été envoûté, hypnotisé même. Pas moi. Jerger m'exaspère. Quelle lourdeur! Quel kitsch! Du lyrisme de boulevard, sans élan, du baroque de pâtisserie viennoise à la crème.
Et puis ça a été le tour de Mozart. J'ai pleuré. De joie. De colère. Notre Mozart! Pas le leur. Böhm s'est bien défendu et Schneiderhan était en pleine forme. Inspiré. Son violon menait l'orchestre avec assurance. Böhm a eu l'élégance de s'effacer, de laisser le jeune virtuose donner libre cours à son enthousiasme. Ce n'était pas splendide, non, mais convaincant. Bien maîtrisé. A prendre ou à laisser. J'ai pris. J'ai applaudi bien fort avec tout le monde. Et Stefan a hurlé des bravos comme seul un gars des montagnes sait le faire. A en décrocher les lustres.
Quel n'a pas été mon étonnement quand Schneiderhan est revenu sur scène, sans Böhm et, ayant demandé le silence, a annoncé qu'il allait jouer une courte pièce en solo. Hans avait donc lu la partition et le comité accepté qu'elle soit interprétée comme je l'avais suggéré. Pour marquer la fin du concerto moins abruptement, pour prolonger un peu la sauce avant l'entracte, avant Tchaïkovski. Pour sauver Mozart!
Dès les premiers accords, entraînants, immédiatement vivaces, sans aucun prélude, l'auditoire a semblé ravi. Sauf Stefan qui tendait le cou comme s'il avait du mal à entendre Schneiderhan, lui, était en train de gagner son pari. Le public, au début un peu surpris, un peu désemparé par ce morceau inconnu, a tout d'abord cherché un repère. Un arrangement, une improvisation, une première? Et puis Schneiderhan a emporté la salle d'un coup, tout souriant. Il a lancé un clin d'oeil charmeur à l'assistance et s'est mis à taper du pied. Invités à ce moment de licence, les officiers se sont aussitôt joints à lui, frappant le sol de leurs bottes. Les autres claquaient des mains en cadence. Le Mozarteum résonnait de gaieté, d'amour simple et pur pour la musique. Un hommage! Et pas seulement à Mozart.
Stefan s'est raidi de tout le corps. Il s'est tourné vers moi, choqué, incrédule. Il avait reconnu la mélodie dès les premières notes, la ritournelle du vieux, le vieil air yiddish. Les juifs n'étaient plus là, ni à Salzbourg, ni dans sa campagne. On s'en était débarrassé, comme il avait dit. Mais leur musique tonnait maintenant en plein Festspiele, au Mozarteum, tournant les nazis en bourrique. Je me suis levé, me montrant fort exalté par le talent de Schneiderhan, emballé. Alors,petit à petit, rangée par rangée, ils se sont tous mis debout, applaudissant, reprenant le refrain. Dans tout ce vacarme, j'ai murmuré les paroles, tant bien que mal, en yiddish. Comme une prière. Pour demander pardon à ceux qui les avaient chantées jadis, dans les mariages, les fêtes de communion. Pour m'excuser de cette fraude.
Ne suis-je pas moi-même comme cette chanson? Une contrefaçon. Un pot-pourri. Pas tout à fait juif, pas vraiment athée, mi-autrichien, mi-silésien, pas encore mort et pourtant déjà banni du monde des vivants.
Ils n'y ont vu que du feu. Même Hans à qui j'ai fait croire que cet air était une ancienne mélodie du Tyrol. Une perle du folklore germanique. Mozart l'aurait tournée à sa manière, en sonate. Elle a maintenu le vieux de la clinique en vie, pour un temps. Désormais, c'est à moi qu'elle offre un sursis, une sorte de rémission. Et maintenant, elle va aussi trotter dans la tête de quelques soldats allemands, de quelques SS, tel un écho lointain. Un fantôme.
Stefan n'a pas trouvé cela amusant. Il n'a pas ri, même quand la salle s'est mise à accompagner Schneiderhan. Il m'a ramené au sanatorium sans piper mot. Tout renfrogné. Je crains qu'il ne me dénonce. Mais n'est-il pas complice? Il a fourni l'encre, le papier, m'a escorté au concert. Et Hans? Et Schneiderhan? Le comité du Festspiele n'admettra jamais une telle bavure.
Tu vois, Dieter, ce geste un peu idiot, ce canular d'étudiant aura été mon seul acte de résistance. Je n'ai pas tué Hitler. Ni sauvé Mozart. J'ai pourtant le sentiment d'avoir accompli mon devoir. J'ai juste voulu empêcher qu'une voix soit tue. Une seule voix parmi des milliers d'autres mais qui, si elle avait été étouffée, aurait éteint la musique en moi. Et toute musique.
Un oratorio entier se ressent de l'absence d'un unique choriste. Il sonne faux malgré le retentissement de l'orchestre, la résonance du ténor. Cette lacune crie. Cette absence se fait entendre malgré tout. Comme un piano auquel il manque une touche. Il n'y a pas de musique par défaut.
Le Talmud dit que celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé le monde. Je n'ai sauvé l'âme de personne. Ai-je seulement sauvé la mienne?
Raphaël Jerusalmy, Sauver Mozart - Le Journal d'Otto J. Steiner (Actes Sud, 2012)
image: Salzburger Festspiele, 1938
11:16 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












